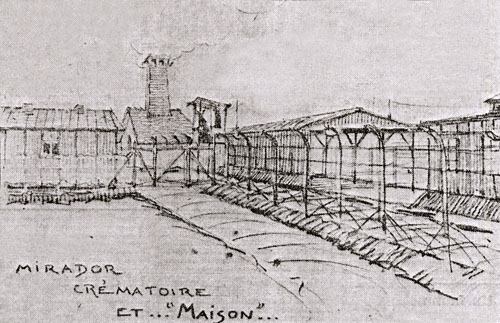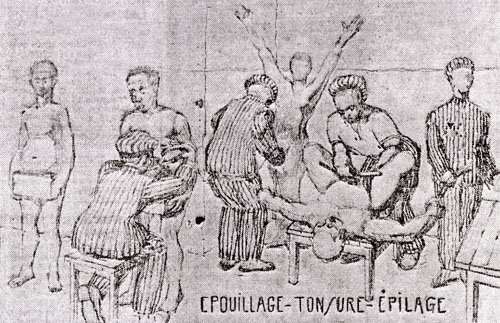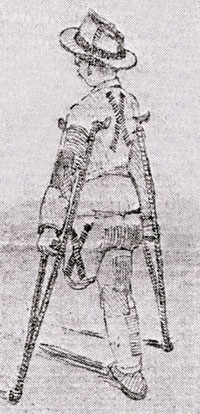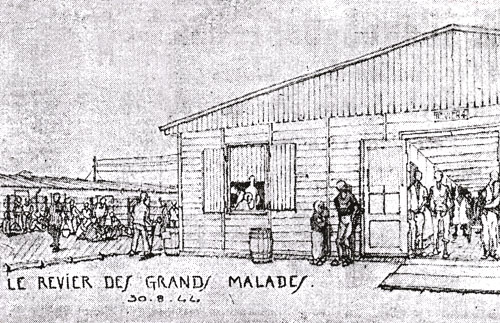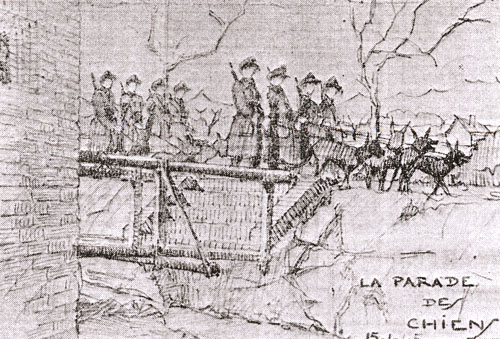|
Le camp de Compiègne
Le
départ de Reims
Le
8 mai 1944, par une belle journée ensoleillée, deux autocars
du CBR emportaient une cinquantaine de patriotes français de
la Marne, au camp de Compiègne.
Quatre boches dans chaque voiture montaient la garde,
l'arme à la main.
Une automobile avec trois officiers de la Gestapo,
munis d'armes automatiques, fait la navette le long du parcours, d'un
car à l'autre. C'était bon de pouvoir respirer l'air de
nos champs.
Qu'elle était belle notre Champagne, pour nous,
après six mois passés en cellule.
Nous étions joyeux. Il nous semblait que même
prisonniers, nous éloigner de Reims, c'était échapper
à nos tortionnaires.
Nous sommes tous des amis de la Résistance,
des copains liés par des souffrances qu'ensemble nous avons endurées
depuis des mois à Robespierre, prison de Reims.
LACOMBE, sous-chef du dépôt SNCF est
tout heureux d'avoir vu l'abbé DRESCH, au moment du départ,
qui lui a remis des cigarettes et des casse-croûtes.
DOCQ, secrétaire de la Bourse du travail de
Reims et GOUSSIEZ, agent d'affaires, discutent sur l'avenir de la France
; GARITAN, instituteur à Villers-Allerand et son beau-frère
FLORION, employé des PTT sont assis sur un tas d'armes prises
dans un dépôt de la Résistance.
La présence de ces armes est l'occasion de
nombreux commentaires.
Certains camarades sont persuadés que, si les
instructions données par le Comité national de la Résistance
avaient été respectées, ces mitraillettes ne seraient
pas aux mains des boches, mais au pouvoir des patriotes.
D'autres estiment qu'elles peuvent nous servir pour
nous évader.
La crainte que l'ennemi se venge sur nos femmes et
nos enfants ne permit pas de mettre cette bonne idée à
exécution.
L'espérance que juillet verrait la fin de la
guerre fut aussi une des raisons qui nous fit nous laisser emmener comme
des agneaux.
MILLINAIRE, représentant, et MASSÉ,
entrepreneur à Givry-en-Argonne, ne trouvent pas le temps long
dans la voiture. Ils s'amusent avec des histoires de chasse.
GOGUEL, directeur départemental des centres
d'apprentissage, avec NEYRAUD, directeur commercial aux pneus Dunlop,
fument pipe sur pipe.
MENU, secrétaire, et ESTEVA, comptable, se
font des confidences. Les bruyants éclats de rire de l'un étaient
accompagnés d'un doux et calme sourire de l'autre.
BORDELAIS, cimentier, et CHANTERENNE, se donnent des
leçons sur la fabrication des fausses cartes d'identités.
Le lieutenant PAYARD me raconte son plaisir de faire de
la radio.
Une douce atmosphère d'amitié et de joie
règne dans le car qui nous emmène vers les camps de la
mort. Mais la véritable épreuve de lutte n'était
pas encore commencée, et pour beaucoup de ces braves, ce fut
leur dernier beau jour de la vie, ce fut leur dernier sourire. Tous,
nous allons faire connaissance avec la nation qui, par ses crimes, est
à tout jamais déshonorée dans l'Histoire.
Les autres camarades étaient dans la deuxième
voiture.
L'arrivée
à Compiègne
Nous
arrivons à Compiègne, et pénétrons dans
le camp. C'est un ancien quartier de cavalerie avec une grande cour
entourée de bâtiments. Les immeubles de droite forment
le camp A, ceux de gauche le camp B, au fond le camp C.
Une haute palissade contourne le camp avec plusieurs
réseaux de barbelés. De nombreux miradors, munis de mitrailleuses
et de puissants phares, permettent aux sentinelles de semer la mort
dans tous les coins du camp.
À notre descente de voiture, nous entrons dans
cette cour où des milliers de détenus se promènent.
Un officier français nous conduit au camp C,
où l'on nous prend nos papiers et toute somme d'argent au dessus
de 500 francs.
Nos bagages sont fouillés et, après quelques
explications du chef de camp sur le règlement intérieur,
nous sommes conduits au camp B.
Le chef de camp, qui est un détenu, avait une mauvaise
presse. Toujours bien ganté, bien « fringué »,
il fume cigare sur cigare.
Aucune chambre n'ayant assez de lits libres pour loger
les 50 Marnais, nous dûmes nous scinder en trois groupes.
La vie du camp était supportable.
La nourriture était améliorée par
les soupes et les colis de la Croix-Rouge.
Il y avait des livres et l'on pouvait organiser des conférences.
Il y avait même un vieux piano sur lequel notre ami
ESTEVA joua quelques morceaux choisis.
La journée est calme, mais, nous apprenons que le
soir, des boches ivres lançaient leurs chiens-loups contre les
détenus, rentraient dans les chambres et nous matraquaient pour
se distraire.
Si les Rémois avaient largement à manger,
grâce aux provisions que nous avions dans nos bagages, il n'en
était pas de même des camarades communistes, qui, depuis
plusieurs années étaient traînés de prison
en prison pour finalement être livrés aux boches. Ils crevaient
de faim et étaient réduits à ramasser les déchets
de la cuisine.
L'annonce
du départ pour l'Allemagne
Une
semaine après notre arrivée, on annonce un départ
pour l'Allemagne. L'appel des partants se fait dans
la cour en présence de tous les détenus.
Le camarade PATÉ, de Reims, fait partie de
ce convoi.
Depuis que nous sommes ici, nous avons fait la connaissance
de nombreux patriotes de toutes les régions de France.
Ce sont des militants syndicalistes, socialistes,
communistes, des prêtres, des généraux, des officiers,
des aristocrates. Toutes les couches sociales de la nation sont représentées.
La nuit qui précéda le départ
de nos nouveaux amis, fut très agitée.
Les chants de La Marseillaise, de L'Internationale,
s'élevèrent dans toutes les chambrées. Le chant
le plus lugubre était À Compiègne, émouvante
complainte chantée par les victimes dans le calme de la nuit.
Les boches furieux nous menacent. Puis c'est le « tac-tac »
de la mitrailleuse qui couvre les chants. Sur qui ? Pourquoi cette mitraille
? On ne peut aller aux renseignements. Toute personne qui sort la nuit
est certaine d'être abattue. Ce fut le cas d'un juge d'instruction
et d'un Italien tués quelques jours auparavant, en sortant du
block, le soir.

La déportation en l'Allemagne
L'heure
du départ
Voici
le jour. Voici l'heure du départ. La séparation est douloureuse
bien qu'il n'y ait que quelques jours que l'on se connaisse.
Nous profitons des places rendues libres dans notre chambre
pour regrouper les Marnais.
Nous nommons GOUSSIEZ chef de chambrée.
D'autre part, MARTIN et NEYRAUD sont nommés coiffeurs
du bâtiment.
Chaque jour arrivent de nouveaux convois de détenus
de tous les coins de France.
Les membres de certains convois sont couverts de
vermine, exténués de fatigue et meurent de faim.
Nous
partons
Le
18 mai 1944, nouvel appel. Notre tour de partir est arrivé.
D'oreille en oreille, de bouche en bouche, on colporte
le conseil de bien regarder la liste en émargeant nos noms pour
voir le nombre de croix qui figurent devant.
Pas de croix, c'est devenir travailleur libre ; une
croix, travailleur surveillé ; deux croix, camp de concentration
; trois croix, forteresse.
Vous pensez si chacun ouvrait ses «mirettes »
pour tâcher de deviner le sort qui lui était réservé.
Mais en fait, c'était une mise en scène pour
nous diviser.
L'important était de laisser espérer que
la plupart seraient travailleurs libres en Allemagne et leur enlever
toute envie de s'évader au cours du voyage.
Des Rémois, il y en avait trois : PAYARD, LACOMBE
et moi avec trois croix.
Pour le voyage nous n'avons pas le droit de prendre
des bagages.
On fait des colis avec nos réserves, qui soit-disant
doivent nous suivre, mais c'est simplement une façon de nous
voler la nourriture et les vêtements que, par des privations et
des sacrifices, nos familles avaient pu nous envoyer.
Jamais nous n'avons reçu nos paquets.
Les boches se sont régalés pendant que nous
crevions de faim.
Le 21 mai 1944, nous quittons le camp.
Seul, notre camarade DOCQ doit rester, ayant plus de 60
ans.
Pour moi, cette séparation est pénible, car
je quitte mon vieux camarade de combat.
Dans
le wagon
Entassés
80 à 100 par wagon à bestiaux, notre convoi, qui comprend
2 400 hommes, part de Compiègne vers une destination inconnue.
Nous passons à Laon, Charleville, Sedan, Metz.
Le long du parcours, nous écrivons des messages
qu'au passage des gares nous lançons aux civils, en les priant
de les faire parvenir à nos familles.
J'ai eu de la chance. Grâce à une personne
dévouée ( je crois que c'est un garde-barrière
près de Charleville ), mon petit mot est arrivé à
ma famille.
À la tombée de la nuit, nous passons
à Sedan.
La frontière approche, le moment est décisif.
Nous sommes une dizaine décidés à nous évader.
Un camarade a pu soustraire à la fouille un couteau. La lame
entaille le bois, déjà la scie entre en action. Ce travail
ne s'est pas fait sans bruit. L'alerte est donnée dans le wagon.
Des consultations se font à voix basse.
Les boches avaient déclaré au moment
du départ que toute tentative d'évasion serait sévèrement
réprimandée ; ceux de la voiture qui n'auraient pu
fuir seraient fusillés.
Un homme se fraie un passage pour parvenir à notre
groupe et nous déclare que la grande majorité du wagon
s'oppose à notre évasion.
Nos camarade croient devenir des travailleurs libres et
estiment que bientôt la guerre sera finie.
Ils ont des gosses et pensent qu'il est inutile de risquer
leur peau.
Protestation de notre groupe : nous estimons que s'évader
est le droit le plus élémentaire d'un prisonnier. Les
poings se ferment, les visages se crispent, l'atmosphère est
lourde. Va-t-on se battre ? Allons-nous à une douzaine, faire
face aux assaillants ?, non.
Le train ralentit. «Tac-tac-tac-tac ».
Les mitrailleuses crépitent. Dans le wagon voisin, la tentative
d'évasion est réussie, mais trop tôt découverte.
Un noir anglais avait pris le commandement de l'expédition :
40 camarades ont pu prendre la fuite.
Les sentinelles allemandes courent d'une voiture à
l'autre, découvrent la brèche dans le wagon, font descendre
les détenus qui n'ont pas eu le temps de fuir, les rouent de
coups de matraque, les mettent à nu et les entassent dans un
autre wagon. C'est fini, on ne pourra plus se sauver.
La
frontière
À
l'aube, nous passons la « frontière ».
Le train s'arrête. La porte s'ouvre. Devant nous,
une douzaine de gradés boches. Deux de ces brutes montent et
sans une parole, à coup de matraque, entassent les cent détenus
dans une moitié du wagon. C'est pour nous compter, paraît-il.
La Gestapo de Compiègne livre le troupeau humain
au Grand Reich.
La réception est brutale, les dernières illusions
s'envolent au premier contact avec l'Allemagne hitlérienne.
La deuxième nuit, nous entrons en gare de Metz
au moment où les sirènes de la ville sonnent l'alerte.
Nous commençons à respirer difficilement,
car depuis Compiègne nous n'avons rien eu à boire.
Puis, dans la matinée, nous passons à Sierck,
et longeons la Moselle.
En gare de Coblenz, le train s'arrête. Nous sommes
tous souffrants, nous étouffons. Sur le quai de la gare, des
jeunes filles de la Croix-Rouge ravitaillent nos gardiens. Dans notre
wagon, un vieux prêtre, qui connaissait un peu l'allemand, implore
un peu d'eau. Pour toute réponse, la jeune fille se met à
rire. Le prêtre lui fait remarquer que nous avons des agonisants.
L'Allemande prend un quart d'eau, le répand à terre et
dit : « Tu n'en auras pas, cochon ».
Le train repart. Il ne devait s'arrêter que
quelques heures plus tard.
Dans toutes les voitures ce ne sont que plaintes, prières,
pleurs et ces cris : « À boire par pitié ».
Enfin les portes s'ouvrent. Le long de la voie, une
tranchée est pleine d'eau. Deux hommes par
wagon sont autorisés à aller chercher de cette boisson
pour l'ensemble des prisonniers. Cette eau imbuvable est sale. Elle
est chaude, en boire est dangereux, mais peu importe, nous ne sommes
plus en état de raisonner : crever pour crever, nous buvons.

Le camp de Neuengamme
L'arrivée
à Neuengamme
Le
quatrième jour de ce supplice nous arrivons à Neuengamme
dans un état d'inconscience et d'abrutissement.
Nous avons des morts, des agonisants, des fous.
Les Marnais sont tous vivants. GOBERT, boulanger à
Fismes, a terriblement souffert. Il sera admis à l'infirmerie
du camp.
Dans la cour du camp, nous sommes mis en colonnes
par cent.
Après nous avoir compté une dizaine de fois,
une grosse brute, habillée en bagnard avec un brassard noir où
deux lettres en blanc sont inscrites : " LA " ( c'est
le chef de camp, le Lager Altster ), hurle quelques mots que
l'interprète, un communiste belge, nous traduit : « Les
Juifs, les Noirs et les Prêtres, sortez des rangs ».
Un petit groupe se forme, composé de prêtres
et de trois noirs. Les Juifs que rien ne distingue de l'ensemble des
détenus, restent dans les rangs.
Dans les rangs des camarades tombent évanouis.
Ce camp est lugubre : une cour immense, cimentée,
avec des baraquements en bois peint en vert de chaque côté.
Au fond, se dressent d'imposantes habitations toutes neuves. À
l'entrée, des immeubles semblables sont en construction.
Les maisons de droite sont réservées
à l'infirmerie, autour de laquelle sont allongés au soleil
des cadavres vivants, vêtus seulement d'une chemise.
Les baraques de gauche servent de réfectoire
aux détenus qui travaillent dans les usines proches du camp.
Une musique grotesque se fait entendre ; ce sont des
camarades qui, leurs douze heures de travail terminées, rentrent
au camp, au pas cadencé. Ils défilent devant nous... Qu'ils
sont maigres et mal habillés. Leurs vêtements en loques
sont marqués par des « X » de couleur jaune
ou rouge.
Sur leur poitrine, un matricule et un losange, rouge pour
les politiques, vert pour les « Droits communs »,
noir pour les asociaux et violet pour les homosexuels.
Voici deux heures que nous sommes descendus du train et nous sommes
toujours debout, immobiles dans la cour. Les rangs s'éclaircissent,
les copains tombent et nul n'a le droit de les secourir.
Enfin on nous dirige vers les bâtiments du fond
pour nous entasser dans des caves. Pour y pénétrer, il
faut passer par une porte de chaque côté de laquelle deux
Kapos frappent à tour de bras en criant : « Schnell
! ».
C'est la bousculade, les forts poussent, les faibles
tombent sous les coups de trique et sont piétinés par
cette masse d'hommes affolés par les menaces et abrutis par les
quatre journées de jeûne et de souffrances.
La
fouille
Dans
ce sous-sol, la poussière et le manque d'ouvertures, rendent
l'air irrespirable.
Trois ou quatre Kapos commencent à nous distribuer
une boisson fade. Chacun se précipite. C'est
tout de même bon, on a soif depuis si longtemps. Nos
serveurs se disent communistes et les Français qui se déclarent
leurs amis politiques reçoivent des cigarettes et double ration
de ce breuvage.
Dans un coin, un prêtre, dont la soutane blanche
brille dans l'obscurité, semble dormir debout. Il paraît
jeune, mais les traits de son visage expriment la souffrance et sa maigreur
fait pitié. Le boche, qui me servait un quart d'eau chaude, l'ayant
aperçu, fonce furieux sur le malheureux et le terrasse à
coups de pieds et à coups de poings. Satisfait de son héroïque
action, la brute revient vers nous, la poitrine bombée. Il est
surpris de ne rencontrer autour de lui que des regards hostiles. Ce
salopard se trouvait pour la première fois en face de l'unité
française contre la bestialité allemande.
C'est par petits groupes que nous devons évacuer
le sous-sol, d'où l'on nous emmène à la dégradation
totale de notre personnalité.
Mon tour est arrivé. Il est quatre heures du matin.
C'est la dernière fois que je regarderai ma montre.
ESTEVA et MENU m'accompagnent.
Nous passons dans une pièce, où l'on nous
dépouille de tout ce que nous avons : montres, bagues, portefeuille,
habits, etc.
On doit sortir nu comme un ver.
Que de tristes scènes dans ce lieu : c'est
le petit gars qui veut conserver la bague de sa fiancée, le papa
une petite photo de ses enfants, le jeune patriote celle de sa maman.
C'est tout ce qui nous reste : ce petit bout de papier
dans le creux de la main, c'est notre raison de vivre, c'est notre bonheur.
Mais la brute hitlérienne veille. Il faut ouvrir
les mains, les nerfs de bœuf frappent les échines nues.
La gorge se serre, les larmes jaillissent. Ce ne sont pas les coups
qui nous font souffrir, c'est la prise du dernier objet qui nous rattachait
à l'être cher resté en France.
« Les vaches, pas même une photo ! »",
déclarent certains d'entre nous.
Une cordelette avec une plaque immatriculée
nous est passée au cou. ESTEVA, MENU et moi
avons successivement les numéros 31 270, 31 271 et 31 272.
Dans la pièce voisine, une douzaine de coiffeurs
nous tondent tout ce qui est poil. Là, un camarade est à
genoux pour se faire couper les cheveux, un autre se fait raser la barbe
et la moustache, le suivant est rasé sous les bras et sur la
poitrine puis sur le dos, un autre, jambes écartées, est
savonné entre les cuisses.
Depuis 24 heures, nos figaros n'ont pas eu un moment
de repos, ils tombent de fatigue et ont parfois un coup de rasoir malheureux.
Alors c'est la verge ou les parties qui en souffrent. Cette blessure
s'envenimera dans quelques jours et pourra entraîner la mort (
Nous avons connu le cas ).
Après une bonne douche, nous sommes habillés
avec des défroques de civils ( des Russes assassinés
par les Allemands ).
Pour finir, nous passons dans un bureau pour remplir
une fiche : je serai en peine de vous dire de quoi il était question.
Un seul mot m'est resté dans la mémoire : « Gaulliste
? ». « Oui ! ».
Quatre
dans un lit
Il
est huit heures du matin. Nous pouvons enfin nous allonger à
quatre dans un lit de 1 mètre de large. Mais peu importe, c'est
la première fois depuis une semaine que nous allons dormir.
Au réveil les amis se cherchent. On se regarde,
on ne se reconnaît pas, tellement les misérables tenues
que nous portons nous ont transformés.
Enfin, les Champenois sont réunis.
GOBERT de Fismes, qui est à l'infirmerie, nous inquiète.
Le lieutenant DUCRISIER décline à vue d'œil.
Il est diabétique et les boches lui ont volé ses médicaments.
Il est courageux et sait que sans soins, il va mourir, mais il veut
rester avec nous. Quelques jours après il tombe et nous devons
le porter à l'infirmerie.
GOBERT et DUCRISIER seront les premières victimes
de notre groupe.
Nous avons du mal à voir DERVIN de Fismes ;
les nazis lui ont pris ses béquilles. Pauvre ami ! Lui qui aimait
tant, malgré son infirmité voyager de groupe en groupe.
Il avait toujours quelques mots désobligeants à l'égard
des nazis, qui déridaient les plus aigris. Faute de béquilles
il est contraint de solliciter le secours de deux camarades pour se
déplacer, en s'appuyant sur leurs épaules. Nombreux étaient
les infirmes dans cette situation.
Chaque jour, nous restons pendant des heures debout
et immobiles dans la cour, où se fait le triage pour le départ
en kommando. Les boches recherchent des métallurgistes et des
ouvriers du bâtiment.
Pour rester ensemble et ne pas travailler pour le Grand
Reich nous déclarons être sans profession ou être
fonctionnaires. C'est d'autant plus facile que les boches ont confiance
dans nos déclarations.
Pour ma part, je me déclare employé du bureau
d'architecture de Reims.
Notre combinaison ne réussit qu'à moitié.
Un matin nos camarades CHANTERENNE et MARTIN sont coupés du gros
de notre groupe et désignés pour le premier départ
en kommando.
C'est fini, nous ne pouvons même pas faire nos adieux
à ces deux bons camarades et nous ne les reverrons plus vivants.
CHANTERENNE disparut vers la fin des hostilités mystérieusement,
comme ont disparu des milliers des nôtres. MARTIN, ramené
en France, dut être hospitalisé à Paris où
il succomba le 22 août 1945.
La
visite médicale
Ce
matin notre colonne est coupée de l'ensemble des détenus
et nous sommes conduits à la visite médicale. C'est dire
que notre tour pour le départ dans les camps de travaux forcés
est arrivé.
Complètement nus dans la cour du camp, sous la pluie
et le vent, nous attendons durant des heures pour passer devant le toubib.
Cette situation devient inquiétante et fait que MENU, le plus
chétif d'entre nous, s'énerve et rouspète : « Les
vaches, ils veulent nous faire crever ! ».
Depuis quelques instants un Allemand, détenu
politique, nous regardait avec bienveillance. Il s'approche de nous
et nous raconte sa triste histoire. : « Je suis
le député communiste d'Hannover, arrêté en
1933. Avec 10 000 de mes camarades, nous avons construit ce camp.
C'était autrefois un vaste marais. Nous n'avions même pas
une baraque pour dormir. Nous nous reposions à même la
terre humide. Sur dix mille nous restons quelques centaines de survivants.
Voyez la-bas cette construction, c'est le four crématoire. Cette
fumée, c'est tout ce qu'il reste des vôtres qui sont morts
ces jours derniers. C'est par la même cheminée que sont
parties en fumée les meilleures intelligences, les meilleures
volontés allemandes. Mais à présent c'est fini.
L'hitlérisme va succomber. Il faut tenir bon encore une année
et nous serons libres ».
Une année ! Il est fou, le frère. Pour
le 14 juillet la guerre sera finie !
À cette réponse, il oppose un doux sourire,
tout de pitié et de doute. Il ne veut pas nous contredire. Il
en a tellement vu. À présent il entrevoit la fin, même
si cela devait durer encore quelques années, cette fin qu'il
n'entrevoyait pas avant la guerre. Mais nous ne pouvons admettre de
souffrir encore une année, car c'est la mort qui nous attend.
Cependant nous avions tous raison : la guerre dure
encore une année et la plupart des nôtres sont morts.

Le Kommando de Fallersleben
Losange
rouge, bande blanche
Nous
partons en kommando.
Notre groupe est composé de 800 détenus :
400 Français, 200 Russes, 150 Espagnols et quelques Belges, Italiens,
Yougoslaves, Hollandais, Anglais, etc.
Pour le départ nous portons la tenue rayée
avec sur la poitrine un losange rouge et une bande blanche portant notre
numéro.
Dans le losange, une lettre indique notre nationalité
: pour nous le F « Français ».
Cette nouvelle tenue nous plaît mieux. Elle est propre
et souvent neuve.
Le 31 mai 1944, nous embarquons pour Fallersleben.
Cette ville industrielle possède une usine
très moderne construite en 1936 avec les actions imposées
aux travailleurs pour fabriquer les fameuses autos populaires. Pour
le moment il n'en sort que du matériel de guerre. Cet immeuble
de deux kilomètres de long, cinq cents mètres de profondeur,
haut de plusieurs étages, occupe 18 000 ouvriers dont 15 000
étrangers. La cuisine de cette fabrique fournit 120 000 repas
par jour.
Dès notre descente du wagon, nous sommes encadrés
par une forte garde de SS.
Parmi les civils que nous croisons en chemin, il se trouve
plus de Français, d'Italiens ou de Polonais que d'indigènes.
Est-ce la honte ou la pitié qui fait baisser la tête à
ces gens lors de notre passage ?
Nous traversons la ville et passons devant les camps
de prisonniers de guerre anglais et français qui nous font des
signes d'amitié.
Notre kommando se trouve à quatre kilomètres
de la ville et n'est pas encore terminé au moment de notre arrivée.
Il se compose de quatre blocks ( bâtiments
), entourés de fils électrifiés. Cinq
miradors dominent l'enceinte.
Un lieutenant SS nous souhaite la bienvenue et nous fait
distribuer, une demi-heure plus tard, des coups de trique avec le couvert
et deux couvertures.
Au
travail !
Chaque
block comprend 8 chambres.
Dans chacune desquelles habitent 24 hommes, divisés
en demi-chambrée.
Les premiers jours, notre travail consiste à
aplanir la cour, arracher l'herbe et faire des allées autour
des bâtiments.
Pour ce travail, nous n'avons pas d'outils, chacun doit
se débrouiller. On se sert d'une planchette, d'un rondin de bois.
Ceux qui n'ont rien trouvé doivent labourer la terre avec leurs
mains et encourir le risque d'un coup de gourdin au passage d'un gardien.
Quelques jours plus tard nous sommes sélectionnés
et répartis dans des colonnes de travail. Nous devons construire
150 maisons provisoires avec routes, trottoirs, jardins, etc.
Pendant 11 mois nous allons vivre dans des conditions inoubliables.
Nos
gardiens
Nous
avions à faire à deux sortes de gardiens : les SS et les
Kapos.
Les premiers, au nombre d'une cinquantaine, étaient
des jeunes hitlériens qui préféraient frapper des
hommes sans défense, appuyer sur la gâchette pour abattre
un homme comme un lapin, plutôt que d'aller au front.
Les Kapos étaient des boches de droit commun qui
avaient été condamnés aux travaux forcés
pour crimes ou vols. Ils couchaient dans nos « blocks »
et avaient droit de vie et de mort sur les détenus. Il arrivait
que la cruauté de ces bandits dépassât de beaucoup
celle des SS.
Le
travail forcé
Dans
les équipes de maçons, nous étions encadrés
par des civils italiens et allemands qui étaient nos moniteurs.
En Allemagne, on apprenait vite le métier : un marteau,
une truelle et en route. On empile les agglomérés et les
briques, on monte des murs, des cheminées, on fait du dallage.
Chacun fait de son mieux, car c'était dans ce travail que l'on
était le moins frappé.
C'est ainsi, qu'après quelques semaines, nos
camarades ESTEVA et GOGUEL auraient pu rivaliser avec les meilleurs
maçons.
Les équipes de terrassement étaient
les plus à plaindre. Les Kapos étaient terribles, la terre,
fort argileuse dans la région, collait à la pelle.
Ces déportés, qui pour la plupart n'avaient
jamais eu un instrument de travail entre les mains ( cette colonne comprenait
ceux qui n'avaient pas de professions manuelles : officiers, professeurs,
instituteurs, ingénieurs, etc. ) étaient fatigués
après quelques heures de travail. Dès qu'ils voulaient
souffler un peu les « Los, Los » du « Chleu »
retentissaient accompagnés du bruit sourd des coups sur les échines.
La colonne de transport amenait les matériaux
sur le chantier. Il fallait pousser les wagonnets jusqu'à la
gare qui était à deux kilomètres, décharger
les wagons, charger les wagonnets et revenir avec le bois, le ciment,
le sable.
Ces allers et retours usaient rapidement les sabots
de bois qui nous chaussaient, et, comme l'article de remplacement manquait,
on voyait nos camarades les pieds nus, en sang, dans la boue et la neige.
Notre camarade MENU, qui a fait ce travail un moment, en pleurait tous
les soirs.
La colonne des peintres, celle du bois, étaient
moins frappées.
La
faim - La soif
Au
mois de juin, nous n'avions pas d'eau au camp, la chaleur était
vive et l'on voyait de pauvres copains chercher des flaques d'eau, se
coucher sur le ventre et boire cette boue à même la terre,
cela malgré les coups distribués par les SS qui avaient
peur d'être contaminés, si des maladies contagieuses venaient
à se déclarer dans le camp.
Pour douze heures de travail, nous touchions 300 grammes
de pain fabriqué avec un mélange de céréales.
Souvent la terre et la pierre croquaient sous la dent :
20 grammes de margarine et une rondelle de pâté, venu plutôt
d'un laboratoire que d'une charcuterie, un litre de soupe à midi
et un demi-litre le soir.
Le plus souvent, la soupe était de l'eau avec des
rutabagas. Parfois, on y ajoutait de la farine avariée. Elle
devenait alors amère et sentait le moisi, souvent même
la m....
Dès le mois de juillet 1944, les grands mangeurs
commencèrent à souffrir, on sortait de table pour entendre
dire : « Cette maudite soupe m'a excité l'appétit,
j'ai plus faim qu'avant de manger ». Le matin, le copain,
en guise de bonjour, vous disait : « J'ai faim »
et c'était la même plainte jusqu'au coucher.
La nuit la faim nous tiraillait l'estomac. Alors nous
rêvions de tables abondamment servies, de mets délicieux
et de boissons rafraîchissantes.
Quelle désillusion au réveil !
La
tragédie du partage des vivres
Lentement
nous nous affaiblissions, nous arrivions à l'entrée de
l'hiver, il nous aurait fallu plus de matières grasses, plus
de calories et c'est à ce moment que les boches diminuèrent
de 50 % notre nourriture déjà insuffisante.
Nous avions compris : c'était la mort lente mais
certaine, si nous n'étions pas délivrés dans le
plus bref délai.
Mais l'instinct de conservation dominait. Nous ne voulions
pas mourir, nous voulions tenir le plus longtemps possible. Chaque journée
était une victoire.
Les scènes pénibles commencèrent.
Les meilleurs amis se volaient la pain.
On rendait souvent visite aux malades pour leur voler ou
leur mendier leur pauvre nourriture, : « Ne te
force pas à manger si tu as de la fièvre, ça ne
te vaut rien ami. On est de la même région, surtout ne
donne rien aux autres, etc. ». Le camarade mourrait s'il
écoutait le conseil, mais peu importait, le quémandeur,
lui, voulait vivre.
Dans les blocks, le partage des vivres devenait
une véritable tragédie. Les parts étaient discutées,
chacun se trouvant lésé.
On ne peut se rendre compte, à moins d'y être
passé, du bonheur que l'on ressent lorsque, affaibli, crevant
de faim, le caractère aigri, on peut fumer une cigarette.
Nous touchions dix cigarettes par semaine. Certains les
fumaient le premier jour et les jours suivants souffraient énormément.
Il leur fallait fumer à tout prix, et ils vendaient leur ration
de pain et leur soupe, ils allaient au suicide.
Nous essayions de faire la morale à ces copains,
puisque même les meilleurs d'entre nous se laissaient tenter et
achetaient contre leur tabac le pain de ces malheureux.
C'était la lutte pour la vie. Il fallait que les
uns meurent pour que les autres puissent vivre un peu plus longtemps.
« Tu fumes et tu vas mourir, tu ne fumes
pas et tu mangeras pour vivre plus longtemps » était
la devise du camp.
Le
premier crime
L'équipe
de terrassement travaillait le long d'un bois.
Profitant d'un moment d'inattention des gardiens, un jeune
Russe tenta de s'évader.
Les SS l'ayant aperçu, foncèrent sur lui.
Se voyant pris, il leva les bras en l'air.
À une demi-douzaine, les brutes le frappèrent
à coup de crosse de mousqueton et lui défoncèrent
le crâne.
Le cadavre fut ramené au camp et le docteur MONS,
d'Amiens, dut ouvrir la boite crânienne pour en extraire la cervelle
et l'étaler sur la poitrine du corps nu, qui fut allongé
au milieu de la cour.
Un par un, nous dûmes passer devant cette dépouille
mutilée.
Les Russes passèrent les premiers ; les Français,
qui suivaient, se découvrant respectueusement devant le mort,
tombèrent aussitôt sous les coups des SS. Notre
camarade BORDELAIS, de Villers-Allerand, fut une des victimes.
Mais les Français ne sont pas des lâches ;
bien des fois, ils l'ont montré, et une fois de plus le montrèrent
aux boches.
Malgré les coups, courageusement, les suivants
se découvrent et tombent à leur tour. Une douzaine des
nôtres sont déjà assommés,
Nos bourreaux sont déconcertés. Ils
nous font dire alors qu'on pouvait saluer le mort, mais qu'au passage
nous devions bien regarder le corps, car c'était le sort qui
attendait tous ceux qui tenteraient de s'évader.
Nous avons regardé le cadavre mutilé
de notre jeune camarade, et l'horrible vision est toujours devant nos
yeux. Elle est la garantie que jamais les survivants de cette tragédie
ne pourront oublier que les Allemands sont des sadiques et des assassins.
Le
calvaire d'un lieutenant-colonel Labat
Jean
LABAT de Biarritz, lieutenant-colonel d'infanterie, arrive un beau soir
dans notre chambrée où il fut assez froidement reçu,
car il prenait la place d'un ami.
Il était officier supérieur, il respectait
le Maréchal, il était très maladroit manuellement,
mais n'arrivait jamais à faire convenablement son lit, ce qui
était un danger pour toute la chambrée. Pour un grabat
en désordre, on voyait toutes les paillasses voler à travers
la cour.
Mais la douceur, la bonté et la grandeur morale
de cet officier français lui valurent rapidement le respect de
tous et de solides amitiés qui adouciront au maximum les souffrances
qu'il devait endurer.
Toute la journée, il roulait une brouette chargée
d'agglomérés en ciment. Très faible, il n'en prenait
que deux à la fois.
Mais un jour le civil allemand qui le commande, estime
que ce n'est pas suffisant et charge la brouette doublement. Labat s'efforce
de pousser son véhicule, mais la roue s'enfonce dans la terre,
l'empêche de démarrer. Ce voyant le « Schleuh »
le frappe.
Connaissant un peu l'allemand, qu'il avait appris
en activité, LABAT fit face à son ennemi et lui dit : « Je
suis un homme et non un chien ».
Cette réponse et la crânerie de l'officier
mirent en rage les boches, et c'est à plusieurs qu'ils lui infligèrent
une correction, l'abandonnant à terre sans connaissance, la figure
en sang.
Le soir, à l'appel, sur les rangs, LABAT doit
sortir et l'interprète fait savoir qu'il doit recevoir 50 coups
de trique pour refus de travail.
Aussitôt, en présence de l'officier SS, notre
ami, tenu par la tête, est frappé par un boche à
toute volée avec un manche de pioche.
Au 25ème coup, le tortionnaire abandonne, en
sueur, et exige d'un Espagnol, bâti en hercule, boxeur de profession,
qu'il frappe à sa place. Honteux, mais craignant d'encourir la
colère des boches en cas de refus, l'Espagnol fait semblant de
frapper.
Au 4ème coup, les SS lui arrachent la trique des
mains et c'est un autre Allemand qui donne à Labat les 25 autres
coups.
La punition terminée, l'officier français
se relève sans une larme, sans un cri, un sourire de dédain
aux lèvres. Il regarde froidement et fièrement ses bourreaux
avant de rentrer dans le rang. C'était sublime, nous avions envie
d'applaudir notre ami.
De retour à la chambre nous l'avons serré
dans nos bras. Les boches étaient furieux. Ils avaient voulu
voir un colonel français pleurer et crier de douleur, mais n'auraient
pas supposé que notre orgueil patriotique pouvait supporter les
souffrances physiques les plus violentes.
Malgré son courage, malgré le calme
apparent que conservait son corps rompu et meurtri, la mort impitoyable
s'empara de cette âme si noble.
Quelques jours après, nous prenions une douche improvisée
dans la cour ; voyant la maigreur de LABAT, ses plaies sur les
fesses et sur les reins, l'officier boche, qui lui avait infligé
la punition, pris de remords ou par crainte de l'avenir, ordonna de
lui donner chaque jour un litre de soupe supplémentaire.
De cette soupe, LABAT en mangeait la moitié
et distribuait l'autre moitié aux camarades de sa table.
Cette aumône, bien digne du sadisme boche, lui
fut supprimée un mois plus tard.
Tous les tourments endurés provoquèrent des
éruptions d'abcès dans le cou et sous les bras.
Il fut hospitalisé en septembre.
Sorti de l'infirmerie en octobre, il reprit courageusement
le travail mais il ne se passait pas de jours qu'il reçoive des
coups des Kapos et des « Vorarbeiters ».
« C'est dieu qui le veut » me disait-il
souvent.
Hélas, les souffrances de l'homme ont des limites.
Le froid, la faim et les mauvais traitements ont eu raison
de ce brave.
« Tu diras à mes enfants que leur père
est mort en bon Français et en bon chrétien »,
me dit-il la veille de sa disparition.
Les
tortures morales
Non
seulement les hitlériens nous faisaient mourir à petit
feu en nous privant de nourriture, en nous rouant de coups, mais, en
plus, avec un raffinement calculé, ils savaient nous tenir en
état de constante crainte : ils nous menaçaient
du four crématoire ; plutôt que de nous laisser délivrer
par les Anglais ils devaient nous fusiller ou nous noyer en mer.
En hiver, pour des motifs futiles, on devait rester
une partie de la nuit sous la neige dans la cour.
Malgré ce régime inhumain les Champenois
tenaient, le moral était bon.
Notre chambre était la meilleure du camp.
Bien que la majorité des camarades fussent de vrais
laïcs, c'est dans notre chambre que GERMAIN, curé du Jura,
célébrait son office le dimanche matin. Avec
empressement, nous montions la garde pour éviter que des camarades
soient surpris par les boches qui haïssaient la religion.
Ce jeune curé avait été déporté
pour avoir prêté sa soutane aux aviateurs anglais.
Déjà, à Compiègne, l'abbé
GERMAIN était devenu notre ami.
Les onze mois qu'ensemble nous vécûmes dans
le camp de la mort, nous permirent de connaître la grandeur et
la haute moralité de ce prêtre.
Son dévouement était sans limite, toujours
prêt à secourir ses semblables.
Sa journée terminée, malgré le pénible
travail de terrassement auquel il était affecté, il passait
ses heures de repos auprès des malades et des mourants.
Son plus grand chagrin était qu'il ne pouvait faire
communier les chrétiens qui mouraient.
Sachant le réconfort que la religion apportait
aux croyants et voulant faire plaisir à GERMAIN, je lui avais
promis de risquer le tout pour le tout pour essayer de lui donner satisfaction.
C'est ainsi que grâce à un prisonnier de guerre
de Touraine, André BÉDOUIN, je lui apportait une centaine
d'hosties consacrées au camp. Jamais je n'oublierai l'émotion
du prêtre lorsque je lui remis le précieux paquet.
Comme nous tous, l'abbé GERMAIN connut les
coups de matraque.
Comme LABAT il connut les abcès et, malgré
sa foi, son courage et sa volonté, il succomba dans ce pays maudit,
sans avoir revu la France et ses braves paysans du Jura qu'il aimait
tant.
Avec l'hiver, notre calvaire devint encore plus pénible.
Les hommes tombent comme des mouches.
Malgré tout, les Champenois passeront Noël
ensemble.
Vers la fin janvier 1945, le découragement se met
dans nos rangs, nous sommes complètement épuisés.
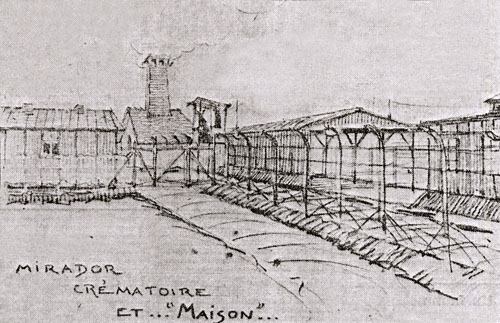
Ce
qui reste de vos camarades « La fumée »
L'épuisement
commence
Dans
la même semaine, doivent être hospitalisés : ESTEVA,
MOULS, NEYRAUD, PAILLARD, MENU, LACOMBE, FLORION de Reims, BORDELAIS,
GARITAN, PETITFRÈRE de Villers-Allerand, LEMEMME d'Épernay,
etc.
Quinze jours plus tard c'est à mon tour et à
celui de LETILLY de Fismes.
Pour se faire admettre à l'infirmerie, il fallait
être complètement épuisé.
Ce lieu était l'épouvante de tous, car c'est
là que se sont déroulés des drames terribles dont
je vous citerai quelques exemples.
Tous les trimestres passait une commission qui désignait
les malades devant être conduits à Neuengamme pour se faire
soigner. Les soins, quels soins ! Une piqûre et le four crématoire.
Un jour un de nos camarades de chambrée, TARIF,
sous-chef de gare de Bordeaux, ayant une jambe infectée, doit
être immédiatement amputé.
Sur le rapport de JEAN, jeune docteur de Bordeaux,
les SS vont quérir un chirurgien dans la localité voisine.
Ce « brave » praticien répond qu'il ne
se dérangera pas pour un « bandit » français.
Sur cette réponse, le jeune docteur bordelais
n'hésita pas et réalisa l'opération avec des moyens
de fortune. L'amputation réussit, mais, faute de nourriture appropriée,
TARIF mourait trois semaines plus tard en avalant sa langue.
Un jeune Parisien, que nous avions surnommé
« Pâte de Fruits » que la peur des coups
avait abruti, se rendit un soir d'hiver à l'infirmerie. Le pauvre
avait fait dans son pantalon ( cela arrivait à bien des détenus
) et il était brûlant de fièvre.
L'infirmier boche, ROBERT, lui infligea une correction,
le doucha avec un seau d'eau glacé, puis l'enferma dans un réduit
dont les fenêtres étaient grandes ouvertes.
Après deux journées de délire,
où toutes les nuits il appelait à son secours sa maman
et ses amis, il mourut de froid.
Suivant son humeur de sadique, l'infirmier allemand
piquait les malades qui mouraient quelques heures plus tard.
JEAN, notre docteur bordelais, veillait et n'hésitait
pas à prendre à partie l'assassin pour l'empêcher
d'accomplir son oeuvre criminelle.
Cet infirmier était pourtant un politique,
détenu depuis plus de douze années dans les bagnes. Personne
ne lui commandait d'assassiner, mais, sûr de l'impunité,
il voulait simplement se rendre digne de la race élue des héros
dont ses maîtres, les SS, étaient les dignes représentants.
Mériter leurs compliments, qui se dosaient à la quantité
des morts journaliers, tel était son but et sa joie.
La
dernière épreuve
Voici
enfin les premiers beaux jours de 1945.
Les Alliés percent les fortifications allemandes,
avançant trop lentement à notre gré.
Des kommandos, qui se sont repliés, viennent échouer
dans notre camp.
Ces nouveaux frères de misère nous renseignent.
Ils ont failli être délivrés, seule une rivière
a empêché cette chance de s'accomplir.
Déjà tous les détenus ont confiance
: le jour de la Libération est proche.
Nos amis les Anglais ne sont plus qu'à 75 kilomètres.
Les boches deviennent inquiets et nerveux.
On ne travaille plus, les routes sont barrées, les
interminables convois de civils sur les routes nous consolent : c'est
la revanche de quarante.
Les premiers jours d'avril 1945, alors que nous pensions
être libérés d'un moment à l'autre, une mauvaise
nouvelle circule : Himmler aurait ordonné d'exterminer les
détenus pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des alliés.

L'évacuation du Kommando
Le
canon gronde
Quelques
jours après, vers huit heures du soir, alors que le canon gronde
au lointain, l'ordre arrive de nous évacuer dans un train stationné
en gare. Immédiatement, je cours à l'infirmerie.
Que vont devenir nos malades ? Nul ne sait, nos malheureux
camarades sont laissés à l'abandon.
Je vois ESTEVA méconnaissable. La mort déjà
s'inscrit sur son visage. En me serrant la main il crie : « Je
vais mourir. Que je souffre ! ».
Plus loin un autre grand malade, un ami, SOUQUE de Bordeaux,
m'appelle, me fait ses dernières confidences. Il sait que c'est
la fin.
Puis c'est le tour de PIMODAN qui veut me serrer la main
et me fait des recommandations pour de POIX, son meilleur ami, qui est
très faible.
C'est LACOMBE qui pleure et NEYRAUD qui m'explique que
son cœur va flancher, etc.
Je n'en peux plus. Je me sauve, le cœur défaillant
devant tant de misère et de désespoir, la tête prête
à éclater.
Les oreilles me bourdonnent : « Charlot
j'ai mal ! Charlot je vais mourir ! Charlot, ma femme, mes
enfants, maman ! ».
Rentré dans ma chambre, MASSÉ me demande
ce que j'ai. Je lui raconte ma visite. Il a aussitôt compris.
Ces moments terribles seront inoubliables.
Le
voyage de la mort
Le
soir même nous sommes entassés dans des wagons.
Nous fuyons l'arrivée des Alliés.
C'est le voyage de la mort qui nous conduit dans le camp
d'extermination. Notre train sera le dernier conduit
par les boches, nous couvrons la déroute allemande.
Les Alliés peuvent nous faire sauter d'un moment
à l'autre, rien ne permet aux aviateurs de distinguer notre convoi
d'un convoi de munitions ou autre matériel guerre.
8 avril 1944 - Tout le long de ce parcours, qui durera
quatre jours, nous risquons à chaque minute notre peau.
C'est par centaines que les morts sont descendus des wagons
pendant les arrêts.
Dans les premiers nous comptons plusieurs Champenois dont
notre cher ami ESTEVA.
En quatre jours nous avons touché 200 grammes de
margarine pour nourriture. Des scènes d'héroïsme
et de sauvagerie se sont déroulées pendant ces quatre
journées. Pour une cigarette on tuait un homme ; c'est ce
qui est arrivé à un Rémois, MOULS, ; c'est
ce qui a failli arriver à GOGUEL, qui, assailli une nuit par
une demi-douzaine de Russes, ne dut son salut qu'à sa force musculaire.
Nous sommes souvent arrêtés par l'encombrement
des voies.
Les troupes alliées gagnent du terrain.
Le troisième jour au soir, le front est à
une dizaine de kilomètres de la gare où nous sommes arrêtés.
Dans la nuit nous voyons le feu des pièces d'artillerie et les
maisons qui flambent. Les employés du chemin de fer ont déserté,
même notre mécanicien s'est sauvé. Les civils allemands
pillent les wagons de marchandises. Déjà des obus explosent
à proximité de la gare.
Les officiers allemands réussissent, après
beaucoup de recherches, à trouver un autre mécanicien
pour conduire notre convoi.
C'était la poisse à quelques minutes de notre
libération.
Repartir, quelle déception !
Pourtant le moral est excellent.
Les
Alliés à 2 kilomètres
Dans
un coin du wagon, nous tenons conseil à quelques-uns. Il faut
s'évader. Les Alliés sont à deux kilomètres.
Un petit Savoyard est volontaire pour risquer sa vie pour nous sauver.
Nous arrachons les fils de fer barbelés qui
obstruent la petite lucarne d'aération, par laquelle passe notre
ami, alors que le train roule à 80 kilomètres à
l'heure. Rapidement nous réveillons les copains qui dorment.
Chacun s'enveloppe dans sa couverture et dès que la porte sera
ouverte, on se laissera tomber à plat ventre sur le ballast,
en se protégeant la tête avec les bras.
Après mille difficultés, notre petit
ami, à l'extérieur, réussit à atteindre
la porte et déjà il déroule le fil de fer qui sert
de cheville au crochet de fermeture.
À ce moment le train ralentit. C'est un jour
malheureux pour nous. Notre camarade ne peut achever sa mission. Il
se laisse tomber à terre. Les boches ne l'ont pas vu. Bientôt
il sera libre.
Les
mitrailleuses en action
Dans
les autres voitures, les mêmes tentatives d'évasion sont
tentées.
Les gardiens ont dû apercevoir quelques évadés
et les mitrailleuses se mettent en action.
Beaucoup de copains qui se sauvent sont touchés,
certains le corps à moitié passé dans l'ouverture,
retombent dans le wagon, la tête fracassée.
Toute la nuit, la mitraille crépite autour de nos
prisons roulantes.
Au lever du jour, le calme revient et nous allons
tenter une nouvelle fois l'évasion.
Cette fois-ci, le camarade russe, qui s'est dévoué,
réussit et notre wagon est ouvert.
Déjà une dizaine de camarades ont sauté
et de nouveau les balles sifflent et le train s'arrête.
Rapidement nous refermons la porte. La poussée est
si brutale que le loquet retombe en place, et les boches, qui inspectent
quelques minutes plus tard les wagons, ne s'aperçoivent de rien.
Ils ne pouvaient savoir le nombre exact des prisonniers de chaque voiture,
la hâte de l'embarquement n'ayant pas permis de nous compter.
Le
passage de l'Elbe
Quelques
heures après, nous passons l'Elbe.
Fini l'espoir de retrouver la liberté dans une fuite
possible.
Cette rivière est pour nous l'obstacle qui nous
vaudra, dans les deux semaines qui vont suivre, des centaines de morts.
Elle retarde de quinze jours notre libération.
Trente-cinq kilomètres plus avant nous sommes
débarqués dans un camp en construction.
Dès que nous sommes à terre, nous tombons.
Depuis quatre jours que nous voyageons, nous avons mangé
200 grammes de pain et 400 grammes de margarine.
Au matin nous apprenons la mort de notre camarade GARITAN.
Les baraquements du nouveau camp ne sont pas terminés
et nous couchons à même la terre.
Des corvées sont organisées pour aller chercher
des branches de sapin qui feront notre couche.
Notre arrivée prématurée n'a pas permis
d'apporter du ravitaillement.
Pour une journée nous touchons 120 grammes de pain
et un doigt de miel artificiel.
Pour comble de malheur, chaque journée apporte
de nouvelles arrivées de prisonniers. Chaque nouveau convoi déverse
autant de cadavres que de vivants.
Les survivants sont réduits à l'état
de squelettes ; nos visages sont horribles ; on se fait
peur. Comme nous, ils sont restés dans les wagons une semaine
sans manger.
La
famine
Vers
le 25 avril 1945, nous n'avons plus de force pour tenir debout.
Nous restons des journées entières couchés.
Sur 3 000 prisonniers, 80 à 100 meurent chaque jour
de faim.
Nos camarades LETILLY, PAILLARD et FLORION sont complètement
épuisés et sont conduits à l'infirmerie.
C'est la famine dans toute son horreur.
Les rares voitures qui amènent du pain sont prises
d'assaut dès qu'elles traversent la cour. Cependant elles sont
bien gardées. Les SS qui accompagnent le véhicule, tuent
à chaque tentative 5 ou 6 hommes. Les prisonniers ne se laissent
plus raisonner et le lendemain c'est de nouveau le pillage des vivres
et le carnage.
La situation est telle que, la nuit, les cadavres
sont mutilés, certains malheureux étant devenus cannibales.
Un jour, un détenu, s'étant bien restauré
de viande humaine, en avait cédé à un de ses camarades.
Dès que nous avons appris cette horreur, nous avons tué
le misérable à coups de bâton.
Chaque jour la situation empire. Nous n'avons plus
la force de penser. On ne ramasse plus les cadavres. Il y en a un peu
partout dans la cour et dans les chambres.
Nous savons que si nous ne sommes pas libérés
dans une semaine, tous les Français seront morts.
Nouveau
départ
Le
1er mai 1945, de nouveau l'ordre d'évacuation est donné.
Déjà les hommes sont rassemblés dans
la cour, par un Kapo boche surnommé « Neneuil ».
Nous savons que les Américains ne sont plus qu'à
une vingtaine de kilomètres. Ils ont traversé l'Elbe la
nuit.
Les Russes qui viennent en sens opposé sont à
quelques kilomètres.
Voulant assurer leur crime jusqu'au bout, en exécutant
les ordres d'Himmler, les boches nous embarquent dans des wagons, pour
nous noyer dans la mer du Nord.
Avec GOGUEL et MENU, nous nous faufilons dans les rangs
pour tâcher de nous camoufler dans l'infirmerie. Avec la complicité
du docteur JEAN de Bordeaux, nous menons à bien notre tentative,
et avec un grand soulagement nous nous cachons parmi les morts et les
mourants.
Nous venions d'être introduits dans ce lieu
macabre, quand un officier allemand vint ordonner aux médecins
et infirmiers de partir dans le convoi. Aux protestations du corps médical,
qui estime à juste raison que son devoir est de rester avec les
malades, l'officier boche répond que son revolver guérira
les « bandits » hospitalisés.
Sur un nouvel ordre impératif, les docteurs
et infirmiers nous quittent pour rejoindre la colonne de ceux qui commençaient
à monter en wagon.
Quant à nous, nous nous serrons le plus possible
parmi les cadavres.
Pendant ce temps une grande confusion règne au camp.
Avant de quitter les lieux, nos camarades Russes prennent
d'assaut le dépôt de vivres. Les Allemands qui montent
la garde, tirent à bout portant, mais cette fusillade ne peut
arrêter les affamés. Les premiers rangs tombent sans arrêter
le flot des assaillants. Bientôt les boches sont débordés
et les détenus se restaurent avec les vivres acquis au sacrifice
de leur vie.
Profitant de ce désarroi, certains groupes
se sont évadés du camp. Mais nos pauvres camarades sont
tellement faibles qu'ils sont bientôt rejoints par les SS qui
les abattent froidement d'une balle dans la tête.
Du renfort allemand étant arrivé, des patrouilles
circulent dans le camp, mitraillette en main, et tirent sans sommation
sur tout déporté qui refuse de s'embarquer.
Deux heures plus tard, tous les détenus à
même de pouvoir marcher sont dans les wagons et le calme plane
de nouveau dans le camp.
Parmi
les morts
Depuis
douze heures que nous sommes cachés parmi les morts, la faim
et la soif nous tiraillent l'estomac.
À la tombée de la nuit, nous allons chercher
quelques épluchures dans les détritus de la cuisine.
Si ce que nous trouvons est infect et n'a aucune valeur
nutritive, c'est suffisant pour calmer nos estomacs.
Toute la nuit, les troupes allemandes défilent dans
les environs du camp.
C'est la déroute, comparable à celle de l'armée
française de 1940.
Le
retour du train
Au
réveil, nous avons la grande joie de voir revenir au camp les
camarades de la veille embarqués dans le train qui devait les
conduire à la mort.
Le projet des boches avait échoué. La
ligne avait été coupée et de plus nous étions
encerclés. La délivrance était proche.
Cependant, vers dix heures, nous sommes de nouveau sur
les rangs pour le dernier appel. Les Allemands ont le toupet et le cynisme
de demander que les hommes volontaires pour les suivre se préparent.
Le départ aura lieu à pied. Des Kapos se font tout doux
et d'un air confidentiel nous conseillent de quitter le camp avec eux,
car ils pensent qu'au dernier moment les SS massacreraient ceux qui
resteront.
Nous ne pouvons admettre de départ volontaire
avec nos bourreaux et nous préférons risquer la mort plutôt
que de commettre une telle lâcheté. Malgré tout,
une centaine de détenus se groupent avec les Allemands, avec
parmi eux une vingtaine de Français, et quittent le camp à
midi.
Nos bourreaux sont remplacés par une garde
civile, la « Volksturm ».
Aussitôt, nous rentrons en conversation avec nos
nouveaux gardiens qui sont complètement dégonflés.
Ils nous demandent d'être calmes : ce sera bientôt
la délivrance.

La libération et le retour
Les
Alliés sont là !
Pour
une fois j'avais eu la main heureuse et, profitant du désordre
général dans le camp, j'avais volé une trentaine
de betteraves rouges et de pommes de terre. Avec un seau de l'infirmerie,
nous commençons à faire cuire les pommes de terre. Quelles
lueurs de joie dans tous les yeux !
Je m'occupe du feu pendant que MASSÉ, BORDELAIS
et GOGUEL, un manche de pioche en main, montent la garde et protègent
un rêve enfin réalisé.
Cuire des aliments au milieu de deux mille affamés
était une opération qui ne pouvait réussir qu'avec
une équipe organisée et décidée.
Pourtant, pendant que nous étions occupés
autour de notre feu, un grand mouvement de foule se produit au bout
du camp et dégarnit notre côté : les Américains
sont là !
C'est un moment indescriptible. Deux parachutistes
américains sont dans le camp. C'est le délire. Le terrible
cauchemar, vécu depuis une année est terminé.
On s'embrasse. « Les vaches ne nous ont pas eu »,
est la phrase des Français. Mais la joie est si grande
pour ces malheureux si faibles, que pour certains c'est la mort.
Quant à moi, je faillis subir ce sort ; mon
cœur a lâché quelques secondes et je suis tombé
dans les bras de mes amis. Heureusement, ma faiblesse n'est que passagère.
J'avais trop résisté à la souffrance pour mourir
le 2 mai 1945, à deux heures, au moment de recouvrer la liberté.
À BORDELAIS je remets mes pommes de terre,
et avec MASSÉ nous prenons la route pour la ville.
Déjà des Russes nous ont devancés armés
de mitraillettes qu'ils ont trouvées dans un camion abandonné.
La première borne kilométrique nous apprit
que le camp était situé à cinq kilomètres
de Ludwigslust et, à l'opposé, la même distance
nous séparait de Lublin, occupé par les Russes.
Ce qui nous surprend, c'est que nos camarades russes ainsi
que les Allemands se dirigent vers la ville occupée par les Américains.
Nous avançons lentement en nous soutenant mutuellement.
À un kilomètre du camp, nous passons le premier
barrage américain. Deux Jeep. Dans l'une, un officier
est en communication radiophonique avec le PC.
Quatre soldats barrent la route aux véhicules.
Les camions sont chargés de soldats allemands. Il
y en a partout : sur les marchepieds, sur le capot, sur la toiture.
De temps en temps, arrive une voiture touriste avec 5 ou 6 officiers.
Tous venaient se rendre. Voitures et camions étaient garés
dans le bois qui longeait la route. Soldats et officiers en descendaient
et, à pied, se rendaient en ville. Les Américains étaient
débordés. En deux jours, plus de 20
000 boches se sont rendus sans un coup de fusil dans ce secteur occupé
par une 30 000 parachutistes.
Les épaulettes et les brassards à croix
gammée ont disparu comme par enchantement.
Nous abandonnons un des nôtres aux Américains
: le pauvre diable était épuisé.
La
débâcle hitlérienne
Sur
cette route, nous pouvions mesurer l'étendue de la débâcle
hitlérienne. On y trouvait de tout, du canon
à la machine à écrire, de la tenue militaire aux
robes de femme, des dossiers de paperasses, des liasses de marks neufs.
Le tableau est pire qu'en France en juin 1940.
En ville, tout immeuble a son drapeau ou son drap
blanc arboré aux fenêtres. Quant à
la population, elle est inchangée, mieux elle semble joyeuse.
Les rues sont noires de monde. Des automobiles américaines
circulent lentement, les soldats qui les occupent lancent aux Allemands
des paquets de cigarettes et des biscuits ( on n'avait pas encore tout
vu ).
Nous n'avons pas la force de courir et de ramasser
les largesses de nos alliés et pourtant nous avons faim et voulons
fumer.
Le premier boche qui passe à ce moment près
de nous a les poches pleines. MASSÉ les lui
vide. L'Allemand veut protester, mais la vue de nos gourdins le rend
docile.
Ça ne fait rien, on fait des largesses aux Allemands et
nos copains meurent démunis de tout au camp. Une fois de plus
nous sommes écœurés. Il ne faut compter que sur nous
même. Furieux mais décidés, nous arrêtons
un convoi pour prendre deux vélos liés sur un camion.
Près de la gare, une foule énorme véhicule
par tous les moyens ( brouettes, chariots, voiturettes d'enfants, etc.
) des vivres de toute sorte. La population pille l'intendance militaire.
Je garde les bicyclettes pendant que MASSÉ pénètre
dans un de ces immeubles dont la superficie est comparable aux halles
de Reims et où sont entreposées des milliers de tonnes
de vivres.
Quelques minutes après, mon ami reparaît chargé
de deux seaux de confiture, du porc, du bœuf, du fromage, du poisson,
du beurre, etc.
À mon tour, je fends la foule pour compléter
notre garde-manger. À l'intérieur vous imagineriez difficilement
ce qui se passe. Plus de dix mille personnes sont unies dans le pillage.
Les SS voisinent les déportés. Officiers allemands et
prisonniers de guerre s'aident mutuellement pour soulever et éventrer
les gros colis. Les femmes serrées poussent de petits cris câlins,
les gosses se faufilent entre nos jambes, chargés de colis trop
lourds pour leurs forces. Pas de dispute, il y en a pour tous à
foison. Et pourtant la guerre n'est pas finie.
Nous
mangeons à notre faim
Nous
sommes le 2 mai 1945, 16 heures.
À midi, il y avait encore dans cette ville,
un vainqueur et un vaincu, un gardien et un prisonnier, un bourreau
et une victime.
Deux heures plutôt, on assassinait nos camarades,
et, à présent, pour la gueule, tout est oublié.
Pauvre humanité !
Chargé de vin du Rhin, de cognac, de tabac, je rejoins
mon camarade.
Après avoir dérobé un pain sous le
bras d'un fridolin, nous mangeons à notre faim, ce qui ne nous
était pas arrivé depuis une année.
Nous encombrons le trottoir avec nos vivres, mais chacun
se dérange, la petite Allemande nous fait des sourires, les gosses
nous demandent si l'appétit est bon. Certaines femmes nous offrent
même l'hospitalité.
Bon dieu ! Nous n'avions pas encore tout vu. Ils ont
de l'audace, les boches. Restaurés, allons-nous
continuer notre voyage ? Non, il faut retourner au camp. Les copains
ont faim. Pourtant c'est terrible de quitter la vie pour retourner dans
cet enfer, parmi ces cadavres, ces mourants, respirer cet air vicié,
cette puanteur provenant de la décomposition des cadavres exposés
depuis une semaine au soleil.
Courage ! Chargés d'une cinquantaine de kilos
de vivres, nous prenons le chemin du retour.
Tout au long du parcours, nous croisons des centaines
de déportés qui se traînent vers la ville, vers
la vie. Tous nous interpellent. Deux détenus en vélo,
fumant des cigares et chargés de vivres, c'est quelque chose.
À notre passage les mains se lèvent : « Bravo
KZ ! ».
Chacun y va de son petit mot :
- « Franzousse, viel essen »
- « Oui, Ruski »
- « Wie viel kilometers di burg ? »
- « Drei »
- « Eh ! les copains, y a-t-il à manger dans le bled
? »
- « Oui, plus que tu n'en voudras »
À la tombée de la nuit, nous pénétrons
dans le camp et distribuons les vivres aux amis.
Beaucoup seront malades et ne pourront fermer l'œil
de la nuit.
Au matin, je vais dire au revoir aux copains qui sont trop
faibles pour marcher et parmi lesquels : BORDELAIS, FLORION, PAILLARD,
LACOMBE, etc.
« Tu diras à nos familles que nous rentrons
par train militaire. Dis aux Américains qu'ils
viennent nous chercher, dis à ma femme, dis à nos gosses,
dis à mon père, etc. ».
Une
vision horrible
Pour
la dernière fois, je regarde ces rangées de cadavres allongés
dans les blocks et la cour : c'est horrible.
En traversant le bois, des coups de feu partent de différents
points. Couchés dans les fossés, nous assistons à
l'encerclement par les Américains de cinq boches, qui se rendent
après quelques minutes de résistance.
Un déporté à la main traversée
par une balle. Arrivé en ville, je tombe évanoui au pied
d'une statue.
MASSÉ me conduit dans une ancienne caserne, où
sont entassés des milliers de « zèbres »
de toutes nationalités.
Le lendemain nous récupérons un camion Renault
abandonné par l'armée prussienne.
Nous le chargeons de matériel tout neuf qui est
abandonné : pneus, machines à écrire, appareil
cinématographique, linge, etc.
Le 5 mai 1945, à l'aube, parés, nous
prenons la route vers la France.
À la sortie de la ville, les Noirs américains
nous font faire demi-tour : on ne passe pas !
Après avoir renouvelé notre tentative
sur d'autres points de la ville et après avoir rencontré
chaque fois la même hostilité de la part de nos libérateurs,
nous revenons à notre point de départ.
Avec amertume, le seul officier français qui
était dans la ville nous apprit que nos pauvres camarades étaient
toujours au camp et qu'il fallait aller les chercher avec le camion.
Épuisé, je dus me coucher pendant que mon
copain allait chercher nos malades.
Au deuxième voyage, il tombe à son tour.
Nous avions pris domicile dans un logement d'officier.
Au réveil, mon regard se porte machinalement sur
la glace face au lit.
Quelle horreur ! C'était moi, avec des yeux vitreux,
les pommettes saillantes, le teint verdâtre, cadavérique.
À mon tour, vais-je mourir ? Je connais ce visage,
c'est le masque de la Mort. J'en ai vu des milliers,
tous ceux qui l'ont eu ne sont plus.
Je sais que l'on part sans douleur, en s'endormant, mais
je ne veux pas mourir.
À
l'hôpital
Plein
d'angoisse, accompagné de mon copain qui crache le sang, me soutenant
sur une canne, je me traîne à l'hôpital.
Le docteur JEAN, un ami, me voyant changé de couleurs
me dit : « Qu'as tu fait, malheureux ? ».
- « Sauve-moi ou je vais crever ».
- « Nous n'avons plus de piqûres, il nous en restait
150 et nous en avions besoin de 3 000 ».
- « Et les Américains ? »
- « Rien ».
Néanmoins, après bien des recherches,
on parvint à trouver de quoi m'injecter le médicament
sauveur et 48 heures après, j'étais sauvé.
Le 7 mai, MASSÉ, toujours malade, revient tout
décomposé de la visite médicale. Quatre de nos
meilleurs amis sont morts cette nuit, parmi eux FLORION et PAILLARD,
deux Rémois avec lesquels nous avions depuis une année
partagé toutes nos souffrances et nos espérances.
Que c'est terrible. Même sortis de l'enfer, à
la veille de revoir les leurs, les déportés tombent chaque
jour par centaines.
Si ça continue, on va tous y passer.
Où est la Croix-Rouge ? Où sont les
docteurs militaires ? Où sont les médicaments ? On nous
abandonne.
Furieux, je vais trouver l'officier gaulliste. Il
n'y peut rien. Seulement, il se décide de se rendre dans le secteur
occupé par les Français pour faire un rapport sur la situation
et nous promet de prendre nos lettres pour les faire parvenir à
nos familles. Ce qui fut fait.
Enfin,
le départ
Un
kommando de prisonniers de guerre français qui voisinait près
de nos casernes devait partir. Aussi, sachant qu'ils étaient
dans l'impossibilité d'emporter toute la réserve de colis
de la Croix-Rouge qu'ils avaient en garde, nous nous empressâmes
d'aller leur rendre visite, escomptant bénéficier de leur
surplus.
Une nouvelle déception nous attendait. Nos compatriotes
préféraient échanger les vivres pour un baiser
de Prussiennes. Toutefois, avec l'aide de quelques prisonniers, qui
eurent pitié de notre misère, nous pûmes dérober
quelques colis.
Enfin le 15 mai 1945, nous quittons la ville en camion.
Beaucoup des nôtres y étaient morts.
Notre convoi se compose d'une vingtaine de véhicules.
Sur chaque camion flotte le drapeau tricolore. Nous croisons de nombreux
convois qui rapatrient les prisonniers russes. Eux aussi ont pavoisé
avec le drapeau rouge portant l'étoile.
Le soir nous arrivons à Wittenbergen, où
par erreur on nous descend dans une caserne où se rassemblaient
les prisonniers de guerre. Il paraît que le régime était
trop bon pour des bagnards, aussi sommes-nous transportés une
demi-heure plus tard à l'autre extrémité de la
ville dans des immeubles infects ; il est vrai que là, au
moins on se trouvait entre bagnards, une vexation de plus.
En
route vers la France
Heureusement,
le lendemain, nous reprenions les camions et en route vers la France.
Dans notre voiture, nous avions plusieurs femmes déportées.
Elles sortaient d'un camp où était internée une
nièce du général de GAULLE. Cette jeune française
aurait été en butte aux pires brutalités allemandes.
Nos déportées sont jolies. Fraternellement,
elles se servent de nos épaules pour dormir. Et chacun de blaguer.
Mais c'est tout ce qu'il nous est possible de faire : blaguer, la plus
belle fille et la meilleure volonté ne peuvent nous donner la
force d'aimer, même un instant.
L'Elbe est passée sur un pont de radeaux.
À 13 heures, nous arrivons dans une usine de munitions
complètement construite sous bois. Elle couvre des dizaines de
kilomètres carrés. Les immeubles sont séparés
par plusieurs milliers de mètres et reliés par voie ferrée
Le camouflage est impeccable. La position de cette usine était
restée secrète et elle ne fut jamais bombardée.
Pour nous, c'est une nouvelle déception, rien
ne justifiant un centre de rapatriement dans ces locaux. Des milliers
de Français et de Belges attendaient ici leur rapatriement.
On couchait à même le sol.
Les déportés politiques étaient en
minorité ainsi que les prisonniers de guerre. Plus
nombreux étaient les requis et les volontaires. Pour ces derniers,
la vie était belle : ils organisaient des campings et couchaient
avec les femmes que les boches avaient amenées et abandonnées
quelques jours avant. Les putains comme les volontaires évitaient
les déportés qui ne se gênaient pas pour leur dire
ce qu'ils pensaient de leur attitude.
Après trois journées d'attente dans
cette station de débauche, nous repartons en camion jusqu'à
Solingen, puis par chemin de fer dans des wagons à minerai, sous
la pluie pendant un jour et une nuit, nous traversons la Hollande...
Et le 22 mai 1945, c'est Bruxelles...

Les croquis de M. Bertrand
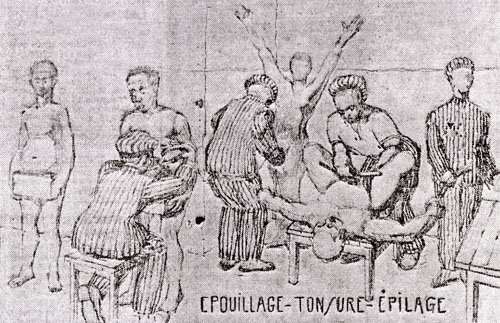
Épouillage -
Tonsure - Épilage
Les figaros du camp de travail
|
|
|
|
Un
« dangereux » bagnard |
Un
autre « dangereux » bagnard |
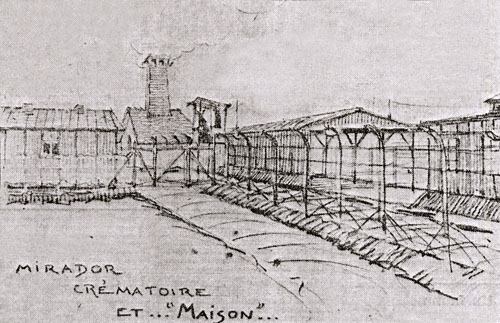
Ce
qui reste de vos camarades « la fumée »
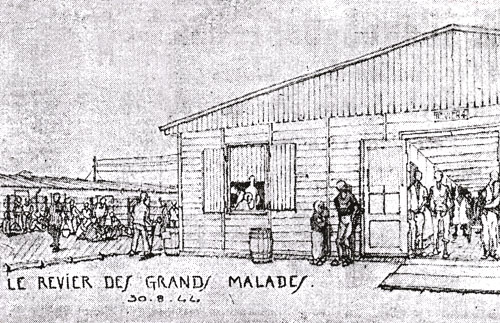
Le
Revier des grands malades - 30 août 1944
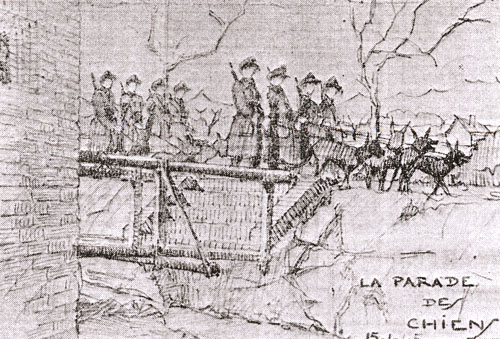
La
parade des chiens - 15 janvier 1945

Sous
la pluie et la neige pendant des heures

Le
kommando de transports

Neuengamme - Le
retour en fanfare - 7 mars 1944


|