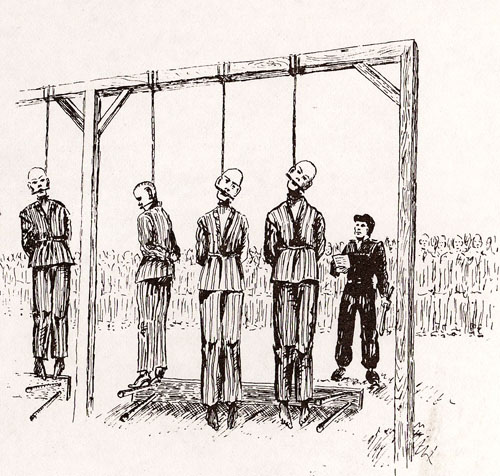|
16
mois de bagne
Buchenwald - Dora
par
le numéro n° 43 652
Alfred UNTEREINER, en religion Frère BIRIN
Témoignage
mis en ligne par Jean-Pierre HUSSON
Frère Birin
Alfred
UNTEREINER, en religion Frère BIRIN,
est né le 24 juin 1906 à Veckersviller en
Moselle.
Frère des Écoles chrétiennes,
domicilié à Épernay, il aide des prisonniers
évadés et des jeunes qui veulent se soustraire au
STO, leur fournit de faux papiers et leur trouve des refuges.
Le 15 décembre 1943, il est arrêté
par la Gestapo dans sa salle de classe à Épernay
et interné à Châlons-sur-Marne.
Le 18 janvier 1944, il est transféré
à Compiègne, puis déporté le 27 janvier
à Buchenwald où il reçoit le matricule 43
652.
Le 13 mars 1944, il est transféré
à Dora. En cachant son identité d'ecclésiastique
et en se déclarant instituteur, il parvient à se
faire affecter comme secrétaire-interprète à
l'Arbeitsstatistk, où il s'efforce de soustraire
ses camarades aux kommandos les plus meurtriers.
Le 4 novembre 1944, accusé de protéger
ses camarades, il est transféré à la prison
de Nordhausen avec 7 autres déportés, puis il est
détenu pendant 5 mois au bunker de Dora où il subit
plusieurs interrogatoires et échappe de peu à une
pendaison.
Transféré le 4 avril à
Bergen-Belsen, il survit à la marche de la mort grâce
à l'aide de Paul Chandon-Moët qui le porte littéralement.
Libéré par les Britanniques le
15 avril 1945 à Bergen-Belsen, il rentre en France le 1er
mai 1945.
Dès 1946, conformément à
l'engagement qu'il avait pris auprès de ces camarades morts
dans les camps, il publie son témoignage sur ce que fut
la déportation à Buchenwald-Dora. |

R.
Dautelle Libraire-Éditeur, Épernay, 1946

Présentation par Paul Chandon-Moët
Voici
un livre déjà préfacé, complet. A-t-il
besoin encore d'une malhabile présentation ? Ceux
qui ne connaissent pas l'auteur en sauront assez si on leur dit que
c'est un des meilleurs parmi les Français, ou mieux, un Français-tout-court,
comme aime à le répéter notre cher Alfred.
Ses camarades l'ont poussé à écrire
ce témoignage. Il le fallait, pour le souvenir des morts et
pour nous, pour tous et pour nous, pour tous ceux qui se méfient
du roman. Ici, c'est le documentaire sans trucage. Chacun pourra ensuite
juger.
Ce film était nécessaire. Mais, que
le lecteur n'oublie pas qu'il a fallu des milliers de cadavres pour
le réaliser, que notre témoin a, de sa main, relevé
près de 9 000 noms de Français décédés
à Dora.
Il fallait, pour nous le rapporter fidèlement,
un témoin exceptionnel. La Providence nous a donné Alfred.
Tout le monde à Épernay connaît
le Frère Birin. C'est un solide Lorrain, directeur d'une école
chrétienne. Il prépare infatigablement les jeunes au
certificat d'études, on l'écoute, on l'aime, on le craint
bien un peu aussi, et on réussit.
Jamais la journée n'est terminée pour
le Frère Birin : après la classe, les jeunes sportifs
et tous les anciens. Semaine, dimanches, vacances, tout est pour l'œuvre
magnifique qui fera peu à peu de jeunes compagnons, des hommes
solides, au cœur bien trempé, droits et fiers... des amis
pour toujours.
Ce n'est pas le Boche qui peut les séparer les uns des autres.
Le Frère Birin, dont le cœur n'a jamais battu que pour
la France, ne peut pas laisser souffrir ses grands, et les laisser
partir en Allemagne. Et avec de bons camarades, ce sont les fausses
cartes qui s'impriment, les cachets qui sont gravés. Tout cela
sauvera bien des vies. D'autres activités encore viennent s'ajouter
et le Frère Birin connaîtra bien des secrets, transmettra
des renseignements... il fait son devoir.
À Épernay, dans une file d'attente,
une mère conte à sa voisine sa peine : « Mon
garçon va partir pour l'Allemagne, au travail ».
« Comment, tu ne vas pas laisser faire ça ; va trouver
le Frère Birin...».
Tout le monde le savait.
Nous voici au 15 décembre 1943. Le Frère
Birin fit la connaissance de Bischof à 14 heures. Pour mon
cousin le Comte Ghislain de Maigret et moi-même, ce ne fut que
vers 18 heures. Mais, grâce à ce Commissaire, nous nous
retrouvâmes tous dans les locaux de la Feldgendarmerie d'Épernay
puis, le soir même, de la Gestapo à Châlons-sur-Marne.
Compiègne, Auschwitz, Buchenwald. Voilà
mes premières étapes. Mais, pas de nouvelles de mon
cher Frère. Septembre 1944 : Dora.
Dès l'entrée, je puis dire avant d'entrer
au camp, dans les locaux, où l'on vous fait subir l'examen
d'identité, j'apprends qu'il est ici. ( Il avait donné
ses instructions pour être prévenu, dès que mon
nom paraîtrait sur une liste ). Ce n'est plus le Frère
Birin, c'est Alfred, l'Alfred de l'Arbeitsstatistik. Quelle
joie pour moi ! Partout, j'ai échappé à de graves
dangers. Ici, ne connaissant que la réputation du camp : le
plus mauvais des kommandos de Buchenwald, je pouvais tout redouter.
Mais non. Alfred est là : je sais donc que je suis sauvé.
Quelques heures plus tard, il venait à la quarantaine et nous
tombions dans les bras l'un de l'autre. Oui, j'étais bien sauvé,
moi et les 600 camarades du transport, qui ne se sont pas douté
de leur sort.
Ce que le livre ne dira pas dans le détail,
c'est ce dévouement inlassable d'Alfred, qui a sauvé
des centaines et des milliers de vies, et toutes les souffrances qui
en furent la rançon.
Alfred a constitué, au mépris de toute
prudence, une liste des décédés français
et l'a soigneusement cachée. Il a donné une sépulture
à des restes de Français, dont il a vu brûler
les corps et dont il a recueilli lui-même les cendres. Puissions-nous
les faire revenir un jour dans leur terre natale.
Et pour terminer sa tâche, en terre d'exil,
j'ai vu Alfred, malade, reprendre du service pour diriger, à
la demande du Docteur Lagey, l'hôpital de Bergen-Belsen. Il
sortait du lit pour y retourner quelques jours après ! Mais
il demeura avec ses malades, lui, parfois plus malade qu'eux, et ne
revint en France que le dernier.
Épernay vient de lui faire fête. Le
compte rendu de la journée du 24 février 1946 sera la
conclusion du livre, si ces pages en sont la présentation.
Et le lecteur verra que les récompenses que M. Bollaert a remises
à notre Alfred l'ont été à un grand cœur
et à un Français.
Paul
CHANDON-MOËT
matricule 53.546
Président de l'Association des Déportés Politiques
de l'Arrondissement d'Épernay.
Épernay, 2 mars 1946

Préface d'Émile Bollaert
J'ai
lu ces pages, leur accent de sincérité m'a ému,
j'ai cru revivre ces mois de dénuement total de Dora et d'ailleurs.
Toute exagération est restée bannie de ce texte, parfois
même il demeure au-dessous du vrai.
La lecture de ce livre ne fait, en particulier,
pas ressortir ce que le nom d'Alfred signifie pour des centaines d'anciens
Dorassiens. Rares sont ceux qui connaissent le Frère Birin,
des Écoles Chrétiennes, mais nul n'ignore Alfred de
l'Arbeitsstatistik. Son menton proéminent était
tout un programme : tenir tête. À son poste exposé,
il tenait tête aux SS, aux détenus d'autres nationalités
pour prendre la défense des Français. Il l'a fait au
mépris de sa vie ; car, s'il n'est pas mort, ce n'est pas à
ses bourreaux qu'il le doit.
Quand notre transport arriva à Dora, ce camp
disciplinaire de Buchenwald, nous n'avons pas tardé à
entendre parler d'Alfred, cette providence des Français. Comme
Dora était le spectre de Buchenwald, Ellrich était celui
de Dora. Je vois toujours le camion d'Ellrich avec sa remorque bondée
de cadavres monter vers le four crématoire : ces cadavres,
véritables squelettes, souillés, jetés pêle-mêle
sur le véhicule, têtes et pieds dépassant, image
surréaliste, s'il en fut. Le bruit se répandit bien
vite que les « " soixante-dix-sept mille » –
c'est ainsi qu'on appelait notre transport parce que nos numéros
commençaient par 77 000 – allaient partir pour Ellrich.
D'Alfred partait alors le mot d'ordre : que ceux qui peuvent trouver
un prétexte se fassent examiner à l'infirmerie ? Là,
des amis faisaient l'impossible pour faire attribuer au plus grand
nombre des billets de « travaux légers ».
Mais cela ne pouvait passer inaperçu ; le
nombre croissant de détenus affectés aux Kommandos du
camp – qui n'étaient, d'ailleurs, pas non plus de tout
repos – fut remarqué par les SS qui décidèrent
de former un « Nacht und Nebel Transport » (
Nuit et Brouillard ) ou Himmelskommando ( Kommando du Ciel
). Ces sortes de transports étaient toujours constituées
très rapidement ( en une heure au maximum ) afin
que les détenus n'aient pas le moyen de se faire libérer.
Alfred n'en eut connaissance qu'au dernier moment, il eut juste le
temps de nous serrer les mains et de nous adresser quelques paroles
d'encouragement. Mais n'étions-nous pas quelques bons camarades
qui n'avaient aucune envie de se quitter ! Quand nous revînmes
« réformés », c'est-à-dire
bons pour le four crématoire, Alfred était en prison
« expiant » sa bonté pour ses compatriotes.
Telle était, en effet, la volonté de nos bourreaux :
la solidarité nationale ne devait pas seulement être
tuée, mais elle était considérée comme
un complot, un crime contre la sécurité de l'ordre national-socialiste
dans le camp.
Sombre ironie ! cet ordre, les dirigeants du camp
le voulaient un enfer, une bagarre pour la vie. Que les détenus
s'entretuassent pour une louche de soupe, que la mort du voisin fût
attendue pour le partage des dépouilles, que dis-je, pour le
partage même du cadavre, que la suspicion régnât
entre co-détenus, que chaque détenu considérât
son voisin comme son pire ennemi, voilà l'ordre souhaité
dans le camp.
Cette psychologie à la Hobbes poussée
à ses extrêmes jusqu'à l'absurde, a réellement
dominé une majorité dans les camps. Et s'il a été
possible d'en préserver une minorité, de regagner un
certain nombre de « Häftlinge » à
des conceptions plus humaines de la vie, c'est à des hommes
comme Alfred que nous le devons.
Je fais abstraction, ici de son apostolat religieux,
il ne l'imposait à personne, il ne l'offrait même pas,
si l'on n'en manifestait pas le désir, au point que certains
de ses amis en ignoraient le premier mot. Non, Alfred, par son exemple,
par le rayonnement de sa bonté, par sa volonté d'aider
partout où il le pouvait, sans égards au danger, sans
considération des opinions philosophiques ou religieuses, a
galvanisé bien des volontés, provoqué des réveils
de l'homme civilisé, a arraché non seulement des centaines
de Français aux mains d'assassins des SS, mais les a sauvés
bien plus encore d'eux-mêmes.
Strasbourg,
le 16 janvier 1946
Emile BOLLAERT
Commissaire de la République à
Strasbourg

Dédicace
Je
dédie ces pages à mes anciens élèves,
à mes chers Jeunes d'Épernay, car c'est pour eux que
j'ai connu les bagnes nazis, c'est parmi eux aussi que j'ai rencontré
la plus ardente sympathie au cours de ces longs mois de détention.
Qu'on me permette de citer spécialement Jacques Dham, déporté
à Buchenwald et à Auschwitz. Il a été,
en toute circonstance, le modèle des résistants par
son courage, son moral et son dévouement au-dessus de tout
éloge [...]
Pendant seize mois de détention, et spécialement
dans l'enfer de Dora, j'ai reçu, avant leur mort, les dernières
confidences de nombreux camarades. J'avais soigneusement établi
une liste et le résumé des dernières volontés
de nos martyrs. Ces documents, malheureusement, ont été
perdus lors de ma nouvelle arrestation, au camp même. Perdues
ces adresses d'êtres chers, ces fragiles souvenirs auxquels
un moribond privé de tout, attache le meilleur de son âme…
Ne pouvant plus entrer en relations avec les familles
comme je l'avais promis, j'écris ces pages à leur mémoire
et pour ceux qui ne les oublieront pas.
À ces épouses, à ces parents,
à ces enfants qui pleurent un être cher, je dois redire
quelle existence a été celle de ces pauvres martyrs
de Dora. Quel rude calvaire ils ont dû gravir avant de recevoir
la récompense de leurs souffrances !
Que ceux qui les pleurent sachent que malgré
la privation officielle de tout secours religieux, nombreux sont ceux
qui ont pu, sous les espèces d'une Hostie minuscule, recevoir
comme suprême consolateur, Celui qui, quelques instants plus
tard, allait être leur juge et leur vengeur. Cette ultime communion
sera, je pense, la meilleure consolation qui puisse être offerte
à leurs familles éplorées.

Arrestation, 15 décembre 1943
Il
fallait placer les jeunes gens pour éviter leur départ
en Allemagne. Il fallait de fausses cartes d'identité. Il fallait
chercher et trouver des refuges dans les fermes et dans les Maisons
de vins de champagne d'Épernay.
La discrétion était de rigueur. Cette
discrétion fut-elle toujours strictement observée ?
Bavardages ? Mouchardages ? Je n'ai jamais su à quelle cause
immédiate je devais d'être recherché par la Gestapo
de Châlons.
J'en fus cependant prévenu et ne fus point
étonné de voir le mercredi 15 décembre 1943,
le triste Bischof de la Gestapo d'Épernay, pénétrer
revolver au poing dans ma salle de classe.
J'aurais pu évidemment gagner le maquis tout
proche, mais je ne pouvais risquer d'attirer des représailles
sur mes confrères et amis.
« Renvoyez vos élèves »,
m'ordonna Bischof après m'avoir signifié mon arrestation.
Je les congédiai en leur disant : « Chers enfants,
voici la police allemande qui vient m'arrêter. Retournez chez
vous, mais retenez les dernières paroles de votre maître.
Je suis arrêté pour avoir commis le crime d'être
un bon français. Je crains de ne plus vous revoir. En souvenir
de moi, restez de bons chrétiens, restez de bons français ».
Je ne pus ajouter autre chose. Un retentissant « die Schauze
zù » me fit taire. Mes pauvres élèves,
effarés, disparurent et la fouille commença.
Ne trouvant rien de compromettant, le policier me
demanda où se trouvaient mes affaires personnelles. « Dans
ma chambre », répondis-je. « Conduisez-nous
dans votre chambre », m'ordonna aussitôt le policier.
Comme je me dirigeais vers la sortie, l'Allemand de hurler :« Arrêtez
ou je tire… ». Et moi de répondre : « Mais
vous m'avez dit de vous conduire à ma chambre, or, elle ne
se trouve pas ici , mais à dix minutes de trajet ».
Un peu calmé, Bischof me conduisit à sa voiture, m'y
fit monter, tandis qu'un comparse, mitraillette anglaise au poing
( sans doute prise à un maquis voisin ) venait s'asseoir
auprès de moi.
Arrivé dans ma chambre, la porte étant
fermée à clé, le policier me demanda si j'avais
des armes. Sur ma réponse négative, je fus fouillé.
Passant la main dans la poche droite de ma soutane, il sentit un étui
le cuir et avant de le sortir, me regardant en face, il me cria « Ah ! vous
n'avez pas d'arme » et sortanyt l'objet délictueux…
« Et ça ? … ». Ouvrant l'étui
il en retira mon livre de prières. Je ne pus m'empêcher
de rire de la déconvenue du boche.
Une perquisition minutieuse des pauvres meubles
à mon usage, ne leur fit rien découvrir, sinon une somme
de 2 à 3 000 francs destinée à solder quelques
factures de séances théâtrales. Cet argent fut
empoché par le policier.
Amené à la Feldgendarmerie, j'y retrouvai Monsieur Fignerol,
Directeur du Personnel de la Maison Moët et Chandon, coupable
d'avoir camouflé des réfractaires, dont un certain nombre
de mes protégés. Peu après, entra Monsieur Fréby,
secrétaire général de la mairie. Sa vue me fit
craindre que nos manœuvres pour fournir des tickets aux gars
du maquis ne fussent découvertes. Décidément,
la partie semblait perdue.
À tour de rôle, vinrent nous rejoindre
Monsieur le Docteur Jean Pellot, M. Prioux et M. Amiel, sous-chef
de gare principal. Au moment où l'on nous embarquait pour Châlons,
j'aperçus MM Paul Chandon-Moët et Ghislain de Maigret.

À Châlons, 15 décembre 1943 - 18 janvier 1944
Tard
dans la nuit nous fûmes écroués à la prison
de Châlons. Une étrange impression m'envahit lorsque
je fus poussé brutalement entre quatre murs froids, percés
d'une seule ouverture barrée de fer.
Dès 6 heures du matin, la porte de ma cellule
s'ouvre brutalement et un sous-officier allemand s'exclame : « Und
Herr Pfaffe, haben sie gut gebelet ? ( Alors, curaillon, avez-vous
bien prié ? ) – Oui, » répondis-je.
C'en était trop. « Comment, dit-il, vous osez répondre.
Vous n'aurez rien à manger aujourd'hui ». Je dus
donc attendre le lendemain pour apprécier le menu de la prison
: une soupe aux carottes et un morceau de pain ? Invariablement,
deux fois par jour. Quelques jours plus tard, je trouvai dans une
autre cellule, Messieurs Paul Chandon-Moêt et James Lecomte.
Celui-ci devait, hélas, être fusillé peu après.
Il sut mourir courageusement, en Français.
Le père de ce courageux jeune homme se trouvait
détenu dans une cellule voisine.
Monsieur Paul Chandon fut, peu de jours après,
mis au secret. Les journées étaient interminables. Je
ne pouvais que réfléchir et penser. Mes craintes devenaient
très vives au sujet de mes amis : Jacques Dham, si dévoué
à la Résistance, et plus particulièrement M.
Dautelle, imprimeur bénévole de centaines de fausses
cartes d'identité ; et aussi MM. Jean Bailly, Lamblin, Gérard
Breton, commissaire de police à Épernay, Winckel, inspecteur
de police, et Gentil, capitaine de gendarmerie, qui avaient facilité
ma tâche de façon si effective et parfois si risquée.
Bientôt, d'interminables interrogatoires vinrent
remplir ces mornes journées. Les détenus, conduits les
menottes aux mains à travers Châlons, restaient les yeux
bandés durant de longues séances qui duraient de 8 heures
à 17 heures. La schlague, le casque électrique, la baignoire,
étaient tout à tour appliqués pour faire parler
les inculpés. D'autres raffinements étaient employés
à l'occasion. Lors d'une confrontation avec Monsieur Herr,
à propos d'armes fournies à la Résistance, j'ai
vu ses mains toutes sanglantes. Sous chaque ongle, des épingles
avaient été profondément enfoncées. J'eus
l'honneur au retour de cette confrontation, d'être ramené
à la prison, enchaîné à ce martyr par les
mêmes menottes.
En cellule, malgré la surveillance, les langues
marchaient bon train. Lors de mon dernier interrogatoire, le chef
de la Gestapo me signifia : « Vous serez fusillé ».Cette
menace me fit vivre des moments d'angoisse. Appelé dans la
nuit du 18 au 19 janvier 1944, je crus ma dernière heure arrivée
: j'embrassai mon compagnon de cellule, cet héroïque James
Lecomte, et descendis dans le grand couloir de la prison, où
se trouvaient déjà réunis d'autres détenus
et en particulier MM. Touvet, Poittevin, Brun, Martin, Fréby,
Terver, Kuhlmann, Guérin, Guillepain, Lecomte père,
Ramillon, Mayer, Foujus et Richons ainsi que l'abbé Michaux.
Un convoi d'autocars confortables nous conduisit,
par Reims, à Compiègne. Une forte escorte rendait impossible
toute tentative de fuite.
À Reims, je retrouvai le Docteur Jean-Marie
Robert, médecin de la prison de Châlons, qui s'était
constitué le facteur bénévole de ses clients.
Je fis connaissance de quelques Rémois qui me donnèrent
des nouvelles de trois de mes confrères récemment emprisonnés
à Reims. Le soir même du 19 janvier, le camp de Royallieu
à Compiègne refermait ses portes sur nous.

À Compiègne, 19 - 27 janvier 1944
Affecté
au bâtiment 9, je fis plus ample connaissance avec divers détenus,
entr'autres avec le docteur Paul Lagey, de Vitry-la-Ville. Ce brave
docteur était connu de tout l'étage pour son moral inébranlable.
Chantant et blaguant à longueur de journée, il agaçait
singulièrement les surveillants. L'un d'eux, pour l'intimider,
lui annonça qu'il allait être fusillé. Le gardien
avait à peine refermé sa porte que notre joyeux docteur
m'interpellait pour se moquer de la stupidité de l'Allemand.
Avec de tels compagnons, les heures de mélancolie
ne pouvaient durer et la bonne humeur reprenait ses droits.
Après quelques jours, je fus placé
au bâtiment 12, réservé à l'aumônerie
du camp. J'y trouvai le Révérendissime Père Abbé
de l'Abbaye de Bellocq, le R.P. Grégoire, prieur, l'abbé
L'Hermite, curé âgé de 70 ans, arrêté
pour avoir marié un prisonnier évadé, – le
maire de la commune a d'ailleurs subi le même sort –
l'abbé Alfred Caron, curé de la Somme, condamné
pour avoir célébré un office religieux pour le
repos de l'âme d'aviateurs anglais tombés sur sa paroisse,
ainsi que Monsieur le chanoine Bordes, Vicaire-Général
de Dax. Ce dernier fut rappelé de Buchenwald à Paris
peu après notre arrivée dans ce camp pour un complément
d'information ; ayant voulu prendre la défense d'un jociste,
il fut, m'a-t-on affirmé, de nouveau dirigé sur un camp
de concentration. Une rafale de mitraillette imposa bientôt
silence à ce courageux protestataire.
Parmi les nombreux autres prêtres alors internés
avec l'abbé Bourgeois, professeur au Séminaire de Besançon,
il y avait le R.P. Renard, trappiste, qui était passé
dix fois à la baignoire. Sa santé, très ébranlée,
ne résista pas aux fatigues du voyage, il mourut en arrivant
à Dora.
C'est surtout avec l'abbé Amyot d'Inville
que j'entretins les relations les plus suivies. Il devait d'ailleurs
être l'âme de la résistance spirituelle au camp
de Dora et mourir de son dévouement sacertodal.
La plupart de mes amis d'Épernay partirent
déjà de Compiègne le 22 janvier pour Buchenwald.
Je fis partie du convoi du 27. Après une fouille minutieuse,
nous fûmes mis à 2 000 dans un bâtiment spécial
et, le lendemain, nous fûmes dirigés vers la gare de
Compiègne.
Le trajet du camp à la gare se fit sous bonne
escorte : un SS était posté à peu près
tous les deux mètres et de chaque côté de la colonne.
Il paraît que des évasions lors des transferts avient
été fréquentes. De braves Compiégnoises
passaiebt le long de la colonne et prenaient au bras un détenu
avec lequel elles partaient dans une rue adjacente à la Grand'Rue
qui mène à la gare. Ce fait m'a été confirmé
par plusieurs déportés partis plus tôt et retrouvés
à Buchenwald. On comprend dès lors le déploiement
des forces de police et l'absence totale de civils dans la rue, celle-ci
ayant dû être vidée par ordre.
Au départ du camp de Rayllieu, chaque partant
avait touché une boule de pain et 200 grammes de saucisse pour
le voyage, mais le tout nous fut confisqué avec tous nos vêtements
dès la nuit suivante, dans les circonstances qui vont être
relatées.

Transfert en Allemagne
Nous
arrivons en gare vers 10 heures. Assurément, je ne m'attendais
pas à des wagons de voyageurs. On nous mit sur rangs de cinq
; j'avais comme voisins Messieurs Touvet, Terver, Chabaut ; on nous
fit entrer dans un wagon « 8 chevaux 40 hommes »...
mais au nombre de 125. Avant d'en fermer la porte, un gros SS bien
pansu nous dit : « Une dernière fois, je demande
s'il y en a qui possèdent des couteaux... Ceux qui essaieront
de s'évader seront fusillés et l'on fusillera autant
de détenus qu'il y aura de manquants ». La porte
se ferma brusquement, fut cadenassée et clouée. Bon
nombre de jeunes gens avec lesquels j'avais fait connaissance à
Compiègne se trouvaient parmi nous. Vers midi, le train se
mit en marche et, de ce moment, notre calvaire commença. Les
occupants du wagon s'énervèrent très vite, chacun
voulant s'approcher de la seule et unique ouverture barbelée
par laquelle nous arrivait un peu d'air. À la nuit tombante,
plusieurs jeunes du wagon qui avaient réussi à cacher
des outils, surtout des couteaux à scie, me firent part de
leur intention de se sauver. Les plus âgés, entr'autres
un pauvre infirme, me demandèrent de les en empêcher,
car, dirent-ils, c'est nous, les vieux qui seront pris comme otages.
Je répondis que je ne m'opposerais pas à leur tentative
de fuite, mais que je resterais avec les vieux. Les plus débrouillards
se mirent à l'œuvre pendant que d'autres chantaient et
criaient pour étouffer le bruit des outils. Bientôt un
grand panneau était libéré près de la
porte. Je conseillai d'attendre jusque dans la montée de Bar-le-Duc
où le train irait moins vite. Mais l'impatience d'être
libres était trop grande... C'est alors que je dis ceci : « Mes
amis, ceux d'entre vous qui vont essayer de se sauver, comme ceux
qui vont rester sont tous en danger de mort ; si vous voulez, nous
allons réciter ensemble un bon acte de contrition ».
Cette proposition fut acceptée par tout le monde, et j'ai vu
rarement des hommes prier avec une telle ferveur et une telle foi.
Aussitôt la prière terminée,
le panneau est enlevé et un premier, puis un deuxième
puis un troisième prisonnier sautent sur le ballast avec beaucoup
d'assurance. Ah ! si je n'avais pas donné ma parole de rester
! ... Soudain, des coups de feu éclatent, quatre camarades
encore réussissent à sauter mais le neuvième
est déjà criblé de balles alors que son corps
n'était qu'en partie sorti de l'ouverture. Aussitôt le
train stoppe... nous étions entre Châlons-sur-Marne et
Vitry-le-François. les coups de feu, les hurlements des sentinelles
se rapprochent de notre wagon. « Couchez-vous »
criai-je à mes camarades car je craignais que les sentinelles
ne tirassent dans le wagon. Je ne m'étais pas trompé
; plusieurs rafales de mitraillettes passèrent au-dessus de
nos corps entassés. Puis la porte fut ouverte et, nous chassant
avec vigueur d'un côté du wagon, les sentinelles, le
pansu en tête, commencèrent une fouille minutieuse. Tous
les outils avaient été jetés à temps par
l'ouverture. Le chef nous compta en nous faisant passer un à
un, à coups de nerf de bœuf, dans l'autre moitié
du wagon. « Il en manque neuf, dit-il, et vous savez ce
qui vous a été dit au départ ; neuf d'entre vous
vont être fusillés ». Il sortit sa lampe de
poche et en choisit neuf parmi les plus jeunes, les fit descendre
à coup de bottes sur le ballast, les fit déshabiller
complètement et fusiller séance tenante. Puis les boches
remontèrent dans le wagon et se mirent à nous battre
à coup de nerf de bœuf, de crosses de fusils, de bottes.
D'une voix féroce, le chef hurle : « Déshabillez-vous ».
Pendant cette opération, les coups n'arrêtèrent
pas de pleuvoir. En un clin d'œil, nous sommes bousculés
et remis dans un autre wagon, toujours fortement stimulés par
les coups. Je vois toujours ce camarade battu d'une façon abominable
parce qu'il avait gardé sa montre-bracelet. Ce nouveau wagon,
métallique, avait plusieurs ouvertures à grillage de
gros fil de fer ; il était sale et sans un brin de paille.
Et c'est ainsi qu'en fin janvier nous voyageâmes, nus, transis
de froid, durant quatre jours et quatre nuits. Le wagon ne s'ouvrit
qu'une fois à Trèves ; nous aurions préféré
de beaucoup qu'il ne s'ouvrit pas, car on nous fit défiler
devant une foule de spectateurs, hommes, femmes et enfants. Tout ce
monde nous fit un accueil digne de la race boche, en nous jetant des
pierres et en crachant sur nous. J'avais la rage au cœur ; mon
ami Hubert Touvet fit cette remarque ironique : « Drôle
de coïncidence, n'est-ce pas mon Cher Frère Birin, c'est
dans la ville où l'on conserve la Sainte Robe qu'on nous promène
nus ».
Après cette humiliation, le wagon se referma
; il ne devait plus s'ouvrir qu'à Buchenwald. Vers la fin du
troisième jour de voyage, plusieurs camarades eurent des accès
de folie et, pour éviter le pire, il nous fallut les assommer
à moitié, ne disposant d'aucun lien pour les ligoter.
Heureusement, ces pauvres diables n'avaient plus ni couteau ni rasoir
à leur disposition ; ils auraient pu imiter ce camarade qui,
devenu fou furieux peu après le départ de Compiègne,
blessa plusieurs d'entre nous avec un rasoir soustrait à la
vigilance des boches ; il fallut le tuer pour éviter des morts.
Il me fut impossible d'intervenir pour maintenir l'ordre et ensuite
trop épuisé pour arriver à lutter contre l'instinct
qui détruit tout sentiment de solidarité et de dévouement.
Ce furent des disputes, des coups, des cris ; les
cas de folie augmentaient d'heure en heure. Une équipe de quelques
scouts essaya de ranimer ceux qui s'étaient évanouis,
et nous n'avions comme médicaments que les mouchoirs que certains
avaient réussis de garder en main et de... l'urine.
En gare d'Erfurt, le train stationna une journée
entière à quai ; j'interpellai une sentinelle pour lui
demander de l'eau pour des camarades qui mouraient. Voici son aimable
réponse : « Comment, ces cochons ne sont pas encore
tous crevés », et il mit la main à son revolver.
J'eus moi-même quelques heures la perte du contrôle de
mes actes, et avec mes camarades, dans un désir farouche de
vivre, je criais : « À boire, à boire ».
N'étions-nous pas fous en vérité de demander
à boire à des boches !
Ce fut tard dans la nuit du 31 janvier que nous
arrivâmes à Buchenwald. Les SS nous attendaient à
la descente du train avec des chiens. Quand la voiture cellulaire
qui devait nous conduire au camp fut prête, l'ordre fut donné
d'y monter et les chiens furent lâchés. Je laisse imaginer
au lecteur la ruée, l'affolement, les cris... Plusieurs malchanceux
qui se trouvaient sur les bords de cette masse humaine furent étranglés
par les molosses.

Buchenwald
Nous
espérions, en arrivant au camp, trouver à boire et à
manger. Hélas, le jeûne devait continuer. Vers trois
heures du matin, on nous réunit dans une salle avec les autres
détenus, lesquels, comme nous, doivent se déshabiller.
Nous sommes désormais intégrés dans la masse.
Nous défilons devant des SS auxquels nous devons remettre,
montres, alliances, bijoux. De crainte de recel, on nous fouille dans
la bouche et... ailleurs. Personnellement, n'ayant point d'alliance
ni de bague, ayant prétendu être célibataire,
je subis une fouille révoltante.
Qu'on me permette de citer le fait suivant dont
je fus témoin à cette occasion. Un brave jociste, mort
peu après l'arrivée et que je sais seulement être
originaire de la région de Dax, avait caché dans sa
bouche une petite médaille, souvenir auquel il était
très attaché. Très malmené par le SS qui
le fouilla, cette brute l'obligea d'avaler sa médaille en proférant
un blasphème que j'ose à peine écrire : « Mange
ton Bon Dieu, ensuite tu pourras le... rendre ».
Je citerai aussi cet autre fait plus brutal encore
d'un camarade, portant une jolie bague qui plut au SS. Ne pouvant
la sortir, le monstre lui fit couper le doigt. Mon camarade, me montrant
sa blessure en pleurait encore de rage.
Tout arrivant doit passer à la désinfection.
Tout d'abord à la tonte générale
où des barbiers improvisés, ricanants, s'amusent de
notre confusion et des entailles dont, par hâte ou maladresse,
ils lardent leurs patients. Tel un troupeau de moutons privés
de leur toison, les détenus sont précipités pêle-mêle
dans un grand bassin d'eau crésylée à forte dose.
Maculé de sang, souillé d'immondices, ce bain sert à
tout le détachement. Harcelées par des matraques, les
têtes sont obligées de plonger sous l'eau. En fin de
chaque séance, des noyés sont retirés de cet
abject bassin.
Une douche suit, c'est le seul moment de bien-être
dans cet enfer de camp. Pour se vêtir, chacun reçoit
ensuite, sans essayage, quelques vieilles défroques civiles
; chemise, caleçon, veste et pantalon ; chapeau, casquette
ou bonnet de nuit en guise de coiffure ; et, comme chaussures, une
paire de claquettes, souliers à semelles de bois offrant les
inconvénients des sabots sans en assurer les avantages.
Affublés de ces oripeaux de carnaval, nous
sommes accueillis par divers bureaux pour y être recensés
et immatriculés. Là, notre nom, notre dernier bien,
est remplacé par un numéro. Je deviens le numéro
43 652.
Souvent la providence se joue des hommes. C'est
à ce moment-là, en effet, au bureau politique, que j'eus
l'agréable surprise de rencontrer l'abbé Senger, curé
de Maxéville ( Meurthe et Moselle ) et ami de ma
famille. Après m'avoir conseillé de ne jamais déclarer
mon état de religieux, il me remit quelques parcelles d'hosties
consacrées, fruit de ses messes clandestines. Jusqu'au 4 novembre
1944, je devais constamment garder sur moi la Sainte-Réserve.
Situation étrange, qui me valut une faveur
telle que même un prêtre ne peut se l'octroyer en temps
normal. Quel réconfort et quel courage j'ai puisé dans
cette divine présence ! Aidé par d'autres prêtres
et de pieux fidèles, j'en fis largement profiter mes camarades
de captivité.
Nous fûmes ensuite dirigés sur un block,
grand baraquement construit pour 500 détenus. Je m'y trouvai
avec Messieurs Terver, Touvet et Chabaut. Nous tombions de fatigue
et nous nous endormîmes promptement. Des hurlements ne tardèrent
pas à troubler notre sommeil. Nous recevions, enfin, noter
première ration de « jus ». Depuis cinq
jours, nous avions été privés d'eau ou de boisson
; nous étions complètement déshydratés.
La ration était peu abondante. Aussitôt après
cette distribution, eut lieu l'un de ces appels interminables dont
tout déporté conserve le cauchemar.
Notre chef de block nous fit savoir que, non compris
sur l'effectif de la journée, nous ne toucherions nos premières
rations que le lendemain. Sur cette assurance, aiguillonné
par la faim, je me mis à la recherche de mes amis sparnaciens
et châlonnais arrivés avant moi. Le premier que je rencontrai
fut Monsieur Fréby, secrétaire général
de la mairie d'Épernay. Je le reconnus à peine :
figure fatiguée, cheveux ras, accoutrement ridicule. Malgré
les tristes circonstances, je ne pus m'empêcher de rire et le
brave Monsieur Fréby de me dire : « Tu as beau rire,
tu n'es pas plus beau. Viens voir les autres, il y en a qui sont pire ».
"En effet, plusieurs de mes malheureux compagnons paraissaient
durement affectés. Déjà Monsieur Richon manquait
à l'appel. Sauvagement frappé à coups de pieds
durant le voyage de Compiègne à Buchenwald, il devait
mourir dans ce dernier camp avec d'autres arrivants et notamment l'abbé
L'Hermitte.
Toutefois, ces bons amis me donnèrent chacun
un peu de pain prélevé sur la légère portion
qu'ils avaient gardée pour le soir.
Comme tous les arrivants, nous fûmes mis en
quarantaine. L'emploi du temps n'était pas fixé ; le
réveil sonnait à 3 heures et demie. C'était alors
la course au lavabo, à 200 mètres du camp. Le chef de
block et ses aides ou Stubendienst, en majorité polonais,
harcelaient et matraquaient tout traînard. Les journées
étaient occupées par de nombreux appels, des inspections
sanitaires pour dépister les poux, des séances de vaccination
ou des corvées de camp. C'est lors d'une de ces corvées
que je pénétrai au fameux block 46, surnommé
block des « cobayes ». Des détenus choisis
parmi les mieux constitués y servent de cobayes, soumis à
des traitements variés, les réactions de leur organisme
sont étudiées et suivies dans leur développement,
jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsque la victime devient
inutile et que l'expérimentateur n'en peut plus rien espérer,
une piqûre au cœur achève le malheureux patient.
On m'a raconté les pratiques inhumaines auxquelles
se livraient ces médecins allemands pour leurs recherches scientifiques.
Je ne veux cependant relater que ce que j'ai vu. J'ai pu causer avec
un détenu de ce block qui portait un pansement sous verre.
Ces tortionnaires, m'expliqua-t-il les larmes aux yeux, veulent voir
comment mon bras pourrit. C'est aussi dans ce block que j'ai vu cette
salle d'exposition digne d'une tribu d'anthropophages ; des peaux
humaines, tatouées y étaient artistement présentées.
Sous des prétextes humanitaires, les visites
médicales devenaient souvent de véritables supplices.
J'ai le souvenir d'une journée de février, passée
presque entièrement dans une petite cour près de l'hôpital,
nu, avec mes camarades nus eux aussi, attendant une inspection médicale.
La corvée ordinaire consistait à charrier
à force de bras des pierres extraites de la carrière
sise au bas de la côte au sommet de laquelle est bâti
le camp de Buchenwald. Chacun s'ingéniait à prendre
le plus faible poids possible mais les nazis veillaient et matraquaient
ceux dont la charge leur paraissait insuffisante. Par le gel ou la
pluie, par la boue ou la neige, il fallait remonter avec son fardeau
cette pente raide. Tandis que la bise s'engouffrait dans nos pauvres
défroques, nos claquettes restaient souvent enfoncées
dans la boue ou la neige. Pour rejoindre la colonne et éviter
d'être roués de coups, il fallait prendre ses chaussures
sous le bras et marcher pieds nus. Lamentable procession que cette
masse de plusieurs milliers d'être humains de tout rang et de
tout âge, en haillons, se traînant exténués,
transis de froid, marchant sous la férule d'un ennemi sans
pitié.
La mort éclaircit encore les rangs de mes
camarades d'infortune. Messieurs Poittevin, Kuhlmann, le Docteur Robert,
le Docteur Genillon, de Fismes, ne purent résister à
ces fatigues. Après une journée harassante, les nuits
ne nous procuraient aucun repos. Nous ne disposions, pour nous allonger,
que d'un espace de trente centimètres par corps. Force nous
était de nous coucher tous dans le même sens, les membres
enchevêtrés les uns dans les autres. Au milieu de la
nuit, au signal donné, tous se retournaient, sinon il eût
été impossible de se dégager de ce chaos humain.
L'immobilité forcée devenait un supplice par la dureté
de notre couche, à même le sol, et par la multitude de
puces qu'une telle promiscuité ne pouvait manquer de faire
proliférer.
Lever très matinal, nourriture nettement
insuffisante pour 12 heures de travail : 1 litre de soupe,
200 à 250 grammes de pain, 20 grammes de margarine. Néanmoins,
la vie à Buchenwald était encore supportable.
Début mars, 1 200 Français, dont j'étais,
furent désignés pour une destination inconnue. Avant
le départ, nous reçûmes des habits de forçats
à rayures bleues et blanches : veste et pantalon seulement,
qui ne pouvaient nous garantir du froid.
Nous êumes à subir une ridicule visite
médicale. Pendant plusieurs heures, nous dûmes attendre
dehors, en plein vent, entièrement nus, l'inspection du médecin
SS. Quand celui-ci daigna se montrer, plusieurs camarades avaient
roulé à terre, frappés de congestion. Il passa
devant les rangs se contentant de faire montrer à chacun la
paume et le dos des mains. Peut-on pousser plus loin la barbarie,
l'inconscience et le cynisme ?
Malgré ces tragiques circonstances, la gaîté
française reprenait ses droits. Enfermés dans un block
spécial pendant ces trois jours où se succédèrent
appels, contrôles de numéros, visites médicales,
beaucoup y allèrent de leur chanson pour distraire leurs compatriotes.
Et tous reprenaient en chœur le chant des bagnards, composé,
je crois par un Ingénieur de l'École des Mines de Paris
:
Nous sommes des déportés
Des bagnards la tête haute,
Qui n'ont commis d'autre faute !
Que d'être toujours Français ?
Nous irons par la Lorraine
Avec nos sabots de bois
Et les blés d'or de nos plaines
Verront rentrer les Français d'autrefois.
Hélas,
beaucoup de ces Français qui chantaient avec tant de foi et
d'espérance, ne devaient pas revenir de l'enfer de Dora.
Le 13 mars 1944, après avoir passé
presque toute la nuit sur la place d'appel, sous une pluie glaciale,
nous fûmes embarqués dans des wagons à bestiaux
; mouillés, n'ayant rien mangé depuis 24 heures. Nous
n'étions que 50 par wagon mais le milieu devait rester libre
pour les SS de garde qui se relayaient fréquemment. Il faisait
terriblement froid. Durant toute la journée du voyage, le givre
ne disparut pas des bordes de la lucarne. Les vêtements trempés,
sans paille pour nous abriter du vent, le froid nous pénétrait
jusqu'aux entrailles. Tard dans la soirée, notre convoi stoppait
à Dora.

L'arrivée à Dora
Là,
comme à Buchenwald, les SS nous attendaient à la descente
des wagons. Tard sans la soirée, je remarquai qu'on empilait
sur une charrette des cadavres de camarades morts pendant le trajet.
Avaient-ils succombé à l'épuisement
et aux conditions déplorables du voyage, ou aux mauvais traitements
des SS de faction ?
Un chemin sillonné d'ornières pleines
d'eau conduit au camp. Il fut parcouru au pas de course. Les nazis,
chaussés de grandes bottes, nous pourchassaient et lâchaient
leurs chiens sur nous.
Ils éprouvaient un plaisir singulier à
nous bousculer dans les flaques d'eau boueuse. Cette corrida d'un
nouveau genre se ponctuait de nombreux coups de fusils et de hurlements
inhumains.
Avec Terver, je traînai mon pauvre ami Touvet
dont les jambes enflées refusaient tout service.
Au camp, les 1 200 nouveaux arrivants furent entassés
dans un block servant à la fois de latrines et de lavabo.
Puis, commencèrent les formalités
d'inscription au bureau politique. Vers deux heures du matin, un morceau
de pain, un bâton de margarine ( 20 grammes ) et un peu
de café furent distribués.
Nous étions tous épuisés. Il
y avait déjà 48 heures que nous étions debout.
Vers 3 heures, bousculés par les SS excitant toujours leurs
chiens, notre misérable troupeau s'engouffrait dans le tunnel
conduisant aux blocks souterrains.
J'eus l'impression de descendre tout vivant aux
enfers. Tout le long du parcours traînaient des cadavres décharnés,
nus ou presque ; des êtres squelettiques, d'un aspect repoussant,
les yeux fiévreux enfoncés dans leurs orbites, peinaient
en maniant pioche ou pelle, tandis que leurs cerbères ne leur
ménageaient pas les coups.
Parqués dans un hall garni de boxes à
sept étages, on nous laissa quelques heures de repos. Chaque
emplacement destiné à recevoir un corps contenait bien
une paillasse, mais répugnante de saleté et sentant
le moisi. Je fis d'ailleurs plus tard une macabre découverte
sous cette paillasse. Quant aux couvertures, il n'y fallait point
songer. La fatigue était telle que je dormis profondément.
Avant de relater ce dont j'ai été
témoin dans ce camp et pour permettre de mieux comprendre la
suite de ce récit, je crois utile d'indiquer comment était
organisé ce camp. Sans doute, il se modelait sur les autres
bagnes nazis, mais ici le camp était en période d'installation
; ceci explique les conditions particulièrement pénibles
faites aux détenus.
Après quelques semaines du régime
commun, j'eus l'avantage d'obtenir une place au bureau de la Direction
et de la répartition de la main-d'œuvre, à l'Arbeitsstatistik.
J'y fus le témoin, au bureau même, de bien des faits
que le pauvre détenu soumis au sort commun a ignorés,
heureusement d'ailleurs, et par mes fonctions, je pus m'enquérir
discrètement de ce qui se passait dans les diverses parties
du camp.
En ne parlant que de ce que j'ai vu, je puis donner
cependant un aperçu assez exact sur la vie au camp de Dora.

Établissement du camp de Dora,
ou plutôt des camps
Les
camps de Dora étaient situés situés dans les
montagnes du Hartz, à 7 kilomètres de Nordhausen et
portaient le nom de Dora-Mittelbau.
Les camps qui en dépendaient directement
étaient ceux d'Ellrich, de Harzungen, de Wida et de Kleindodungen,
appelés Mittelbau I, II, III, IV.
Ce groupe de camps, en rapports administratifs avec
celui de Buchenwald, était un des principaux centres secrets
de l'industrie de guerre allemande. Les déportés y étaient
employés à l'extension de l'usine souterraine, à
la fabrication des bombes volantes V1 et V2, à l'usinage des
moteurs d'avions Junkers, etc...
Le camp de Dora commença à s'installer
en novembre 1943. Rien n'existait à cette date, sauf deux tunnels
principaux datant de 1913 et abandonnés depuis, le travail
ayant paru trop pénible. Le forage des galeries souterraines
fut repris en septembre 1943, par un kommando de détenus politiques
envoyés de Buchenwald.
J'ai pu compter 56 galeries à Dora même,
sans compter celles que, de l'autre côté de la montagne,
on creusait à Ellrich, à Harzungen, pour achever ainsi
le forage de la montagne.
D'après le plan déposé à l'Arbeitsstatistik
que j'ai pu consulter, 125 autres galeries étaient prévues.
J'estime, d'après les contrôles dont
j'avais la charge, que 5 pour cent seulement des détenus français
aux camps de Dora ont pu survivre dans les premiers temps à
la vie de tortures qui leur était imposée. À
Dora, on mourrait de faim, de froid, de fatigue et de tortures.
J'avais établi une liste de près de
9 000 morts français, que j'avais cachée sous le contreplaqué
de ma table de travail à l'Arbeitsstatistik, espérant
m'en servir un jour.
En général, les plus forts résistaient
6 à 7 mois, c'était le temps moyen pendant lequel les
détenus restaient dans les souterrains sans revoir le jour.

L'organisation du camp - L'autorité dans le camp
Comme
à Buchenwald, la haute direction était assurée
par des SS, mais à Dora, ceux-ci intervenaient constamment
pour notre plus grand malheur. Un véritable essaim s'agitait
continuellement dans le camp. Armés de matraques, de nerfs
de bœuf ou du terrible "Gummi" ( tube de caoutchouc
garni d'une armature de fils métalliques ) et entourés
de leurs molosses, ils y répandaient une véritable terreur.
Tous les SS portaient des titres pompeux où
revenait le mot de Führer, Sturmbannführer,
Obersturmbannführer, Oberscharführer, Rapportführer,
Blockführer, Arbeitsdienstführer.
Cependant, malgré leur rage satanique, ils
n'auraient pu suffire à leur besogne de mort.
Les détenus étaient, en effet, si
nombreux qu'il eût fallu une armée pour les garder. Aussi,
Himmler avait eu une inspiration génialement odieuse : faire
exercer l'autorité par les détenus eux-mêmes.
À Buchenwald, la chose était encore supportable, car
les détenus politiques allemands occupaient les divers postes
du camp et ne menaient la vie dure qu'à ceux qui le méritaient,
notamment aux détenus de droit commun qui partageaient des
peines de 10, 20 ou même 30 ans de travaux forcés.
Par contre, à Dora, ce furent les repris
de justice allemands et polonais qui eurent le haut du pavé,
et tous les détenus politiques, spécialement les Français,
considérés comme ennemis de la nation, souffrirent durement
de leur rancune.
Au camp, l'unité administrative est le block
dirigé par un chef assisté par des hommes de chambre
ou Stubendienst et un secrétaire. L'unité de
travail ou kommando obéit à un kapo ( abréviation
de Konzentrationslager Polizei ou Police du camp de concentration
) assisté de contre-maîtres ou Vorarbeiter.
À ces agents ordinaires de chaque unité,
s'ajoutent des surveillants du camp ou Lagerschutz plus terribles
que tous, frappant pour frapper, pour complaire aux SS
qui les dirigent.
À Dora, tous ces détenus « gradés »
étaient choisis parmi les « Verts »,
détenus de droit commun, la plupart Allemands ou Polonais.
Ces derniers se montrèrent particulièrement
cyniques et le déportés sont unanimes à se plaindre
de ces bandits avilis au rôle de sbires au service de leurs
ennemis.
On les appelait les Verts en raison du triangle
vert peint sur leurs habits. Ainsi reconnaissait-on les condamnés
de droit commun. Les détenus politiques portaient un triangle
rouge avec une lettre indiquant leur nationalité F : Français ;
B : Belge ; R : Russe. Un triangle violet indiquait un objecteur de
conscience. Un triangle rose, un condamné pour mœurs spéciales.
Un triangle noir désignait les saboteurs de guerre ou les tziganes.
Entre ces catégories si nettement désignées,
une haine farouche, entretenue à dessein, provoquait souvent
des drames.
Il y eut quelques chefs de blocks de nationalité
tchèque qui favorisèrent leur nationaux aux dépens
des Français.
Pour être juste, il faut convenir que les
rares Français parvenus à ce poste agirent de même.
Nos compatriotes étaient très mal notés en raison
de leur réputation de saboteurs, mais je puis affirmer que,
parmi les milliers de Français que j'ai connus, un seul se
montra indigne de ce nom en servant la cause des nazis.
Il s'agit d'un nommé Naegel que nous retrouverons
dans la suite de ce récit.
Tuer était la consigne. Jamais un SS de surveillance n'intervint
pour protéger un détenu. Tout au contraire, j'ai vu
des SS féliciter un kapo, parce que dans son kommando, il avait
fait crever plus d'hommes que dans tout autre kommando.
Réclamer devenait dangereux. Il ne fallait
pas s'y risquer. Des détenus exaspérés venaient-ils
se plaindre à l'Arbeitsstatistik ? Confrontés
pour la forme avec leur kapo ou leur Vorarbeiter, celui-ci
les accusait de délits imaginaires. Le plaignant ne s'en retournait
alors qu'après avoir reçu 25 coups de schlague.
Invariablement, les plaignants étaient ensuite
assommés pendant leur travail. Le lendemain, des listes d'appel
appelaient simplement leurs numéros parmi les morts de la journée.

Une journée au camp - Travail
Réveillés
à 4 heures du matin par les cris des Stubendienst, les
détenus se lèvent en hâte. Le SS Block-führer
guette les traînards et leur administre des coups de bottes
ou de gummi, ou, mieux encore, lance à leurs trousses ses chiens
policiers. Nombreux sont les malheureux portant aux mains ou aux pieds
la trace de morsures. Ces blessures, non soignées, se sont
souvent envenimées et ont causé plus d'un décès.
Une seule issue permettait de sortir ; il s'y produisait
fatalement une bousculade et pendant les longues minutes d'attente,
les gardiens ne cessaient de frapper sans relâche.
Au début, il n'y avait pas d'eau pour se
laver. Plus tard, des lavabos furent installés. 20 robinets
devaient suffire pour 500 à 600 hommes. Pas de serviette ni
de savon. Si parfois nous avons touché un morceau de savon
ersatz, il fallait le garder en poche pour éviter le vol. Il
s'effritait rapidement.
Quelquefois, une distribution d'un liquide innommable
et infect a précédé le travail.
Dans
le Tunnel
Les travailleurs étaient répartis
dans les kommandos et dans le tunnel. Il y avait de nombreux kommandos
à Dora, mais le tunnel absorbait la plupart des travailleurs.
Ils y étaient partagés en deux équipes : Tagesschicht
ou équipe de jour, Nachtschicht ou équipe de
nuit. Chacune de 7 à 8 000 hommes. Les uns travaillaient aux
usines déjà établies, les autres continuaient
à forer les galeries.
Les machines-outils servant à fabriquer les
V1 et V2 provenaient de l'usine de Penemunden, sur la Baltique, littéralement
pulvérisée par un bombardement, au dire d'un survivant,
Beaumont. On y trouvait du matériel belge, français,
italien, américain, mais peu de matériel allemand.
Le travail se faisait à la chaîne,
25 ouvriers étaient affectés spécialement dans
chaque équipe à un travail bien déterminé.
En faisant construire leurs armes secrètes par des détenus,
les Allemands pensaient garder leur secret. Ils n'empêchèrent
point le sabotage.
Le forage des galeries constituait le travail le
plus pénible. Un ouvrier, en temps ordinaire, supporte difficilement
les trépidations du marteau pneumatique. Affaibli par le régime
du camp, le détenu était rapidement épuisé,
le cœur défaillait et l'homme s'affalait sur sa tâche.
Le Kapo ou le nazi de garde l'achevait souvent,
tandis qu'un autre prenait sa place pour tomber à son tour.
Le travail de déblaiement devait se faire à une cadence
accélérée. Dans ces travaux de forage, en plus
des garde-chiourme habituels, des civils dirigeaient les travaux et
se faisaient appeler ingénieur ou Meister. Ils se montraient
aussi inhumains que nos gardiens.
Travail
forcé. Dans le camp
D'autres
kommandos assuraient le service du camp. Celui de la carrière
ou Steinbruch était un des plus durs. C'était
le kommando de punition. Il se composait en majorité de Français,
qui y sont morts par centaines. D'autres kommandos extérieurs
assuraient les terrassements, l'installation des baraques. Comme à
la carrière, on y travaillait par tous les temps. Enfoncés
dans la boue jusqu'à mi-mollets, il fallait continuer à
pelleter. Nos habits ne nous quittaient pas. Deux ou trois jours étaient
nécessaires pour sécher les vêtements trempés,
à la seule chaleur du corps. Durant de longs mois, les SS avaient
imaginé de prescrire le pas de course aux détenus dans
leurs déplacements comme dans les corvées, même
en poussant une brouette chargée.
Transportant de grosses dalles, j'eus le malheur
de trébucher et de tomber. Le SS qui nous surveillait me frappa
dans le bas-ventre à coups de bottes. Je me relevai avec peine
et je souffre encore aujourd'hui de ces brutalités. Elles étaient
accompagnées d'ignobles insultes, mais, depuis longtemps, j'étais
rompu aux douceurs du vocabulaire teuton.
Après avoir travaillé quelque temps
au tunnel, je fus affecté au fameux kommando de Grossverter,
aux environs de Nordhausen. Nous y étions conduits en camions
découvertes par les plus grands froids. Le travail durait de
6 heures à 19 heures, avec une halte de 30 minutes, à
midi, pour une collation ; mais, distribuée la veille au soir
pour le lendemain, la maigre ration était absorbée depuis
longtemps.
La cadence du travail ne pouvait ralentir et, plus
que partout ailleurs, nos gardiens se montraient féroces. Je
reçus, d'un kapo, une pelletée de ciment en pleine figure,
et comme j'eus un réflexe un peu vif, la brûlure causée
par le ciment m'a fait perdre l'œil gauche, cet énergumène
brandit la pelle pour me frapper. J'esquivai le coup, mais mon voisin
le reçut. La figure horriblement tailladée, il perdait
son sang abondamment. Le kapo daigna se calmer, mais la plaie s'étant
infectée, sa victime ne put survivre. Une autre fois, mes deux
voisins s'entraidaient ; c'étaient un père et un fils.
Le premier encourageait le second qui défaillait. Le nazi de
garde voulut les séparer. Apprenant leur parenté, il
tend au père son fusil et désignant le jeune homme :
« Tuez-le », ordonne-t-il. Refus indigné
du père. Sans sourciller, la brute, reprenant son arme, abat
le fils et ensuite le père afin de le punir de sa désobéissance.
Sous cette perpétuelle menace de mort, le travail ne pouvait
chômer. Le soir, nous étions heureux de retrouver le
camion du retour. Il arriva que celui-ci fut en panne d'essence. Les
17 kilomètres qui nous séparaient du camp furent faits
à pied. Pour hâter notre marche, les SS distribuaient
force coups de crosses de fusils. Lors de la traversée des
villages et de Nordhausen, les gens s'ameutaient et encourageaient
nos gardiens à nous frapper. J'entends encore cette grosse
commère s'écrier : « Très bien, très
bien. C'est ainsi qu'il faudrait les traiter tous les jours jusqu'à
ce qu'ils crèvent ». Les gosses nous jetaient des
pierres et criaient : « Banditen, Banditen ».
Plus d'une fois en kommando nous avons été
surveillés par des enfants de 7 à 8 ans, de la jeunesse
hitlérienne. Ces féroces bambins étaient heureux
de venir nous narguer. Les jours de congé, les nazis se faisaient
remplacer par ces gosses revêtus d'un uniforme et portant un
revolver à la ceinture. Voyaient-ils un détenu paraissant
moins actif ? Ils s'approchaient et, d'une main malhabile, ils reproduisaient
péniblement son numéro sur un carnet, puis le dénonçaient,
heureux de lui faire administrer les 25 coups réglementaires.
Dans la suite, je dus, de par mes fonctions à
l'Arbeitsstatistik, me rendre dans les kommandos de Harzungen
et d'Ellrich. Là, le réveil sonnait à 3 heures
30. Après un appel, des wagons de marchandises découverts
transportaient les détenus à Wolfleben. Un nouvel appel
se faisait avant le départ pour le travail, à 6 heures
du matin.
À quelques kilomètres de ce camp,
nous construisions des châteaux d'eau. Nous nous rendions au
chantier dans les premières heures du jour.
Nous croisions en chemin de pauvres loques humaines
aux traits tirés. C'étaient les équipes de nuit
occupées à l'extraction de la craie utilisée
par les usines de produits chimiques, qui rentraient au camp.
Les arrivants se dispersaient en petites colonnes
et s'engouffraient dans les galeries. L'entrée en était
dissimulée par des toiles de camouflage.
Pendant le travail, chaque explosion de mine devait distendre ces
toiles et les agiter comme l'eût fait un vent de tempête.
Il n'était pas rare de croiser des blessés soutenus
ou portés par deux camarades.
Aucun de ces mineurs ne portait le casque protecteur dont les Meisters
ne se séparaient jamais.
Rendement
et sanctions
Le
rendement des équipes devait toujours être poussé
au maximum. Il ne se passait pas de semaine sans que l'un ou l'autre
kommando ne fût signalé pour l'insuffisance des tâches
réalisées. La punition ordinaire consistait alors soit
dans la suppression d'une moitié de la ration journalière
pour une période de 10 à 15 jours, soit dans l'administration
de 25 coups de gummi.
Ces 25 coups réglementaires étaient
infligés fréquemment et sous les plus futiles prétextes,
par exemple, s'être attardé aux latrines afin de gagner
quelques instants de repos. Un Français exténué
crut pouvoir en toute tranquillité s'étendre sur le
tas de cadavres empilés près de son kommando. Un Lagerschutz
ou surveillant l'aperçut, le dénonça au nazi
de faction qui le tua séance tenante.
Lorsque les ingénieurs se trompaient dans
leurs calculs, les détenus en supportaient les conséquences,
mais la tâche assignée devait être exécutée
quand même.
En voici un exemple :
Dans le kommando qui creusait les puits d'aération
du tunnel, les techniciens allemands avaient prévu un cubage
trop important de béton à couler d'une seule pièce
dans la journée.
À 17 heures, malgré un travail acharné,
le tiers seulement de l'ouvrage était réalisé.
Le travail se poursuivit donc jusqu'à 3 heures du matin à
la lueur des phares, sans repos ni aliment. Rentrée au camp
après 24 heures de travail, cette équipe n'eut que 6
heures de répit pour manger, se laver et dormir.
L'Administration pénitentiaire allemande
louait parfois des détenus aux entreprises adjudicataires des
travaux publics, mais la faiblesse des forçats ne permettait
pas un rendement suffisant du travail. Il en résultait de fréquents
conflits entre le SS conducteur de travaux et les directeurs.
Dans ces entreprises, les tâches les plus
dangereuses étaient réservées aux détenus.
Ainsi, dans un kommando, pendant 12 heures de suite, leur tâche
consistait à recevoir des wagonnets chargés de pierres.
Il fallait, au risque de se faire écraser, enlever un panneau
de chaque wagonnet et en basculer le contenu dans un remblai, puis
déplacer les rails et recommencer plus loin. Ce travail s'exécutait
de nuit. On ne peut évaluer combien de pieds, de mains et d'individus
furent écrasés dans ce labeur exténuant et dangereux,
surtout quand le froid engourdissait les mains.
À l'Arbeitsstatistik, je voyais défiler
sur les listes dressées à l'entrée du four crématoire,
ces mêmes noms et numéros qui, quelques jours auparavant,
figuraient sur les listes de départ pour ce kommando.
L'usure du matériel humain ne comptait pas.
Le travail était exténuant autant par la répartition
des tâches et leur rythme d'exécution, que par l'absence
des moyens matériels.
Ainsi, quatre détenus devaient hisser un
rail Decauville au sommet d'une colline, dix autres y transportaient
un aiguillage, trois devaient suffire pour déplacer un poteau
télégraphique...
Il devient fastidieux de rappeler les brutales et
incessantes interventions des surveillants et les conditions physiques
plus que déficientes des ouvriers qui, par tous les temps et
sans répit aucun, devaient assurer la tâche imposée.
Les travailleurs ne pouvaient réparer leurs
forces par un sommeil et une alimentation suffisante.
Et cependant, tous, nous gardons des longues stations
sur la place d'appel, un souvenir au moins aussi douloureux que celui
de ce travail de forçats.

Au camp - L'appel
Tous
les soirs, au retour du travail, avait lieu l'appel. Impeccablement
alignés par blocks, 15 à 20 000 esclaves attendaient
le bon plaisir des SS. Au passage de ceux-ci, personne ne devait avoir
l'audace de remuer ni un pied, ni une main, ou de détourner
le regard, sinon des coups de poing en pleine figure ou de vigoureux
coups de pieds venaient corriger le délinquant. Souvent, tout
un block était puni, son garde-à-vous ou son alignement
ayant laissé à désirer. La station debout était
alors imposée plusieurs heures durant.
Quelquefois, le groupe était astreint à
faire plusieurs fois le tour de la place d'appel au pas de course,
ou bien encore à parcourir à sauts de crapaud plusieurs
centaines de mètres. Malheur à celui qui tombait de
fatigue, il risquait de ne plus se relever.
L'appel durait en moyenne deux à trois heures,
mais si le chiffre des présents ne concordait pas avec celui
enregistré aux bureaux, l'appel se prolongeait le temps nécessaire
pour retrouver l'erreur. C'est ainsi que j'ai assisté à
des appels de six et même vingt-trois heures. On ne peut s'imaginer
quelle grande fatigue et quel abattement physique produisaient ces
longs stationnements debout, dans l'immobilité absolue.
C'est un tourment dont tous les rescapés
parlent avec horreur. Fatigués par leur journée de travail,
l'estomac creux, en léger costume de bagnard, sous les rafales
de pluie ou de neige ou sous un soleil de plomb, cette attente était
mortelle. Souvent, on a relevé des morts.
L'appel se terminait parfois par une dernière
vexation. Au commandement répété des centaines
de fois : « Mutzen ab, Mutzen auf » : enlevez la
casquette, remettez la casquette, il fallait exécuter le geste
avec ensemble, inlassablement. Ce petit jeu dura une fois trois heures
de suite...
Durant ces longues heures, debout, le regard fixé
au delà des barbelés, les muscles endoloris par l'immobilité,
l'esprit battait la campagne. J'ai entendu mes voisins rêver
à haute voix à leur famille, à leurs œuvres
d'apostolat, l'un à sa femme, à ses enfants, un autre
à sa fiancée... Chacun raidissait toutes ses énergies
pour lutter contre la défaillance et s'éviter le pire.
Plus d'un y perdait la raison et j'entends encore
ce pauvre squelette ambulant s'en aller en murmurant des paroles pleines
de tendresse à l'égard de sa femme et de ses enfants
qu'il ne devait, hélas, plus revoir.
Quant au pauvre dysentérique, s'oubliait-il
? Très malmené d'abord, il s'entendait ensuite signifier
sa mise à la diète totale pour plusieurs jours...
Les malades non reconnus devaient se présenter
à l'appel. S'ils ne pouvaient plus marcher, deux camarades
les y traînaient ou les portaient sur des brancards. Les morts
eux-mêmes devaient être là, du moins ceux qui étaient
décédés hors du Krankenbau, ou baraquement
des malades. Ils allaient rejoindre sur la place d'appel, les morts
des kommandos déjà sortis.

À
l'appel, les morts devaient être présents comme les autres...
Une charette passait après l'appel pour charger
tous ces corps et les conduire aux fours crématoires.
Par une dérision cruelle, les cuivres de
la musique du camp résonnaient à tout rompre, tandis
que devant nous de grandes flammes rougeâtres panachées
de lourdes volutes d'une fumée noirâtre, s'échappaient
de ces fours tragiques, emplissant l'atmosphère d'une âcre
odeur qui faisait frémir.
À l'appel, succédait bien des fois,
tard dans la nuit, un contre-appel. Comme pour l'appel, pas de pitié
pour les malades.
À ces longs stationnements debout s'ajoutait
la brutalité coutumière des SS
Par une journée diluvienne, pour me garantir de cette humidité
glacée qui imprégnait mes vêtements, je me fabriquai
avec un sac à ciment en papier, une espèce de pull-over
que je mis sous ma chemise. Le soir, il y eut fouille générale.
Le SS sentit crisser le papier contre ses doigts. Il me fit déshabiller
séance tenante et me roua de coups, pour avoir commis un vol
au préjudice du grand Reich.
Un autre malheureux, dans le même cas, après
avoir subi le même traitement, fut tout simplement étranglé
par le nazi, qui lui passa son ceinturon autour du cou.
Un Français, très fatigué,
s'accroupit pendant l'appel, me demandant de guetter l'approche du
SS. Malheureusement, celui-ci survenu à l'improviste le surprit
sur le fait et le tua aussitôt à coups de bottes.

Nourriture et logement
Nous
recevions chaque jour un litre de soupe, presque toujours préparée
avec des rutabagas, 200 à 250 grammes de pain et 20 grammes
de margarine. De temps en temps, une rondelle d'un Ersatz en forme
de saucisson, dans lequel il se trouvait de tout sauf de la viande,
venait s'ajouter au menu habituel.
Enfin, rentrés au block, la ration de la
journée était distribuée.
Cette distribution s'accompagnait de brutalités
de la part des Stubendienst et de pugilats entre Russes et
Polonais, sépcialisés dans le vol des rations.
J'ai vu, dans le tunnel, ces voleurs couper le courant
électrique, se ruer sur les marmites de soupe, s'emparer du
pain, ce qui nous valut, plus d'une fois, d'être privés
de repas. Un autre procédé non moins odieux était
couramment employé. La distribution de la soupe était
soumise à la vérification des numéros matricules
; ces bandits s'emparaient de la veste des morts, l'endossaient et
bénéficiaient ainsi d'une seconde ration.
Avantageux pour l'un ou l'autre détenu sans
scrupule, ces agissements étaient expiés par tous, car
les appels se prolongeaient indéfiniment pour essayer de dépister
les numéros ne figurant ni sur la liste d'appel, ni sur la
liste des fours crématoires.
Les nouveaux arrivants éprouvaient parfois
de macabres surprises. À mon arrivée
à Dora, j'avisai une paillasse libre, que je m'empressai d'adopter.
Une odeur affreuse empestait le local sombre et privé d'aération.
Je n'y pus bientôt plus tenir et je m'aperçus alors avec
horreur que cette paillasse couvrait un mort. J'étais couché
sur un cadavre.
Je changeai d'habitat et dormis dès lors
à même le sol.
Les paillasses étaient en nombre restreint
et insuffisantes, elles étaient chaque fois l'enjeu de véritables
combats. Quant aux couvertures, pour nous autres Français,
nous ne devions pas y songer. Elles étaient distribuées
par les Stubendienst, qui servaient d'abord leur compatriotes
Allemands, Polonais ou Russes.
Il fallut s'accoutumer à reposer sur le sol
et se tenir recroquevillé et agglutiné à ses
voisins, compagnons de misère.
Ainsi parqués, le chef de block venait passer
une visite de propreté des pieds. Pour coucher sur le sol nu,
suintant d'humidité ou sur des paillasses moisies et noires
de crasse, il était indispensable d'avoir les pieds propres
! Ce n'était qu'une vexation de plus. Toutefois, un soir, cette
inspection nous valut une scène du meilleur comique, dont la
pauvre victime elle-même ne put s'empêcher de rire.
Un détenu bien couvert par sa couverture
laissait dépasser des pieds affreusement noirs. Le chef de
block montrant avec indignation ces pieds qui défiaient la
consigne, administra à leur possesseur une schlague magistrale.
La brute se rendit bientôt compte qu'il s'agissait du seul homme
de couleur existant dans le camp, et que nous appelions « Doudou ».
Le lendemain, Doudou nous fit cette réflexion : « Je
préfère mes pieds noirs à la grande Kultur allemande ».
Durant la nuit, le silence relatif était
bien souvent interrompu par des cris de protestation d'un malheureux
auquel un Polonais ou un Russe venait de ravir une partie de sa ration
ou quelque vêtement.
Et la nuit trop courte se passait ainsi sur la dure,
heureux quand il ne prenait pas au SS quelque fantaisie nocturne.
Une nuit, un de ces derniers, ivre sans doute, fit
lever tous les hommes de mon block les rangea en file, face à
lui, et déchargea son revolver sur les pieds de chacun. Les
plus agiles parvenaient à écarter les pieds à
temps, mais de nombreux camarades, mal réveillés, furent
blessés. Le manque de soins et la gangrène rendirent
mortelles ces blessures, insignifiantes par elles-mêmes.

Colis
Pour
tromper la faim, le détenu, normalement, aurait pu compter
sur l'arrivage des colis expédiés par les siens ou par
la Croix-Rouge. Ces colis parvenaient bien au camp, leurs emballages
étaient remis aux destinataires, mais ils ne contenaient souvent
plus qu'une minime partie de l'envoi.
J'ai reçu moi-même un colis pesant
au départ 15 kilos, mais dans lequel je ne trouvai que quelques
comprimés de saccharine.
Le vol était courant. Sur les 219 colis,
envoyés par ma famille, mes confrères et mes amis d'Épernay,
une vingtaine au plus m'ont été remis et, fréquemment,
pillés par les Stubendienst et le chef de block.
Pour éviter ensuite le vol de ces provisions,
il fallait les consommer de suite.
Les paquets envoyés par la Croix-Rouge subissaient
le même sort. Vers le mois d'octobre 1944, il est arrivé
à Dora un envoi de mille colis de la Croix-Rouge française
et d'un nombre égal de la Croix-Rouge belge. L'adresse comportait
la mention :
À
un interné civil politique Français
(ou Belge)
Camp de Dora
Annexe du camp de Buchenwald
Ces
deux mille colis furent entièrement pillés par les SS.
Je fus chargé de désigner un détenu pour en brûler
les emballages afin qu'il n'en restât plus de traces.
Le cynisme allait fréquemment plus loin.
Souvent, les détenus furent appelés au contrôle
des colis et furent obligés d'en accuser réception sur
la carte mensuelle, mais ils ne les touchèrent jamais. Les
familles ainsi trompées se faisaient un devoir de continuer
leurs envois.
Réduits à la maigre portion de l'ordinaire,
chacun s'ingéniait à trouver quelques débris
pour tromper la faim. Des orties, des épluchures de pommes
de terre, des pissenlits ou tout autre verdure étaient de précieuses
trouvailles. Pour comprendre les ravages de la faim, il faut avoir
vu ces corps décharnés amoncelés devant les fours
crématoires et dont les membres enchevêtrés laissaient
penser à un chargement de charbonnette basculé devant
la porte d'un boulanger. Seule, la peau recouvrait encore les os.
J'ai vu ce fait que je n'oserais affirmer si je
n'en avais pas été le témoin direct : l'estomac
torturé par les affres de la faim, des détenus rôdaient
à l'entour des fours crématoires et, profitant de l'absence
des gardiens SS et Lagerschutz, mordaient à pleines
dents dans la fesse bien amaigrie d'un cadavre.

Punitions
Aux
souffrances et mauvais traitements, s'ajoutaient les sévères
punitions qui frappaient sans pitié tout manquement au règlement.
Il suffisait d'être suspecté pour encourir le dernier
supplice.
Officiellement, deux punitions étaient appliquées
: 25 coups de gummi et la pendaison.
Toutefois, le sadisme des SS ne pouvait s'en contenter.
Ainsi réduisaient-ils les rations de moitié, lorsqu'ils
ne les supprimaient pas totalement, aux kommandos dont le travail
était déficient.
Avait-on le malheur, au retour du travail, de ne
pas défiler devant les baraquements SS en exécutant
le pas de l'oie de façon impeccable ? On risquait de passer
la nuit debout sur la place d'appel.
Rentrant, un soir, excessivement fatigués
et traînant les pieds, un jeune SS ingénieux s'en aperçut
et nous apostropha : « Ah ! vous êtes fatigués,
je vous retrouverai après l'appel ».
Déjà, avec hantise, nous envisagions
des heures supplémentaires de stationnement. Ce fut pire. Après
l'appel, ce jeune nazi força tout le kommando à se coucher
à terre, cinq par cinq, puis déversant des arrosoirs
d'eau glacée sur les corps allongés, il les força
à se rouler sur une assez grande distance, appuyant même
sa botte sur les crânes qui tentaient d'échapper à
l'engluement de la boue.
De retour au Block, les Stubendienst armés
de leurs gummis nous en interdirent l'accès prétextant
notre dégoûtante tenue. Après nous être
désenglués sommairement, silencieux, trempés
jusqu'aux os, nous nous sommes glissés jusqu'à nos boxes.
Et ce n'était qu'une plaisanterie d'un SS.
Pour un salut incorrect, pour une tenue défectueuse,
le détenu se voyait privé le dimanche suivant, des quelques
heures de repos parcimonieusement accordées, et la punition
spirituellement imaginée par les nazis consistait à
répandre des matières fécales sur un terrain
transformé en potager pour l'usage exclusif des SS.
Pour ce faire, il fallait puiser dans un immense
bassin, où chaque jour la corvée spéciale ou
Kubelkolonne, déversait le trop plein des tinettes servant
de latrines. Au pas de course, portant à deux un baquet muni
de brancards, et rempli jusqu'au bord, ces hommes devaient exécuter
le transport sans en rien répandre.
Les surveillants SS se montraient particulièrement
agressifs. C'étaient souvent eux-mêmes les punis de la
semaine, brisé par ce travail au pas de course, un malheureux
vient-il à trébucher ? Il est obligé, à
la main, de recharger son baquet… S'il est trop épuisé
pour courir, son sort sera plus déplorable encore. En effet,
dès que l'homme est de retour près de l'immense dépôt,
le SS de garde, d'une bourrade, l'envoie s'enliser. « Fumier,
dit-il en ricanant, puisque tu ne peux plus courir, tu pourras au
moins nager… ». Combien de malheureux ont trouvé
là une mort atroce !
Les chefs de Block ne se montraient pas moins féroces
et inventaient des supplices pour punir une attitude manquant de soumission,
ou même une simple négligence.
Un camarade n'avait pas de numéro à
sa veste. Notre chef de Block le condamna à rester nu dehors,
pendant une nuit glaciale. Par un raffinement de cruauté, il
ordonna de lui jeter de quart d'heure en quart d'heure, un seau d'eau
froide sur le corps, tandis qu'il l'obligeait à tenir les bras
levés, soutenant une lourde pierre.
Le malheureux claquait des dents et tremblait de
tout son corps.
N'étant pas mort dans la nuit, le chef de
Block le fit assommer par les Stubendienst. D'autres faits
analogues pourraient être contés.
La convoitise seule suffisait parfois à pousser
nos gardiens au crime. Malheur à l'interné ayant une
ou plusieurs dents aurifiées. Un SS s'en apercevait-il ? Il
jetait au loin son calot et obligeait la victime à aller le
ramasser. Il profitait de ce moment pour l'abattre à coups
de fusil et sans attendre que la mort ait fait son œuvre, il
récupérait, à coup de crosse dans la mâchoire,
le métal précieux. Pour clore l'incident, les témoins
du drame devaient témoigner que le détenu avait voulu
s'évader. Une telle mise en scène n'était pas
toujours jugée nécessaire. La victime était désignée
au Kapo ou au Vorarbeiter qui, moyennant quelques cigarettes,
savait trouver l'occasion favorable pour perpétrer son crime.
Les femmes de SS désignaient aussi leurs
victimes, et avec plus de cynisme encore que leurs maris. Ce qu'elles
désiraient, c'était de belles peaux humaines, artistement
tatouées. Pour leur complaire, un rassemblement était
ordonné sur la place d'appel, la tenue adamique étant
de rigueur. Puis, ces dames passaient dans les rangs et, comme à
l'étalage d'une modiste, faisaient leur choix.
On entendait leurs papotages, leurs exclamations, leurs petits rires
de satisfaction : « Das ist schön… », et
elles montraient du doigt l'objet de leur choix.
Les détenus désignés sortaient
des rangs et leurs peaux allaient bientôt orner le salon de
ces dames ou enrichir la collection du camp.
J'ai déà dit qu'à Buchenwald,
j'avais pu pénétrer dans la salle d'exposition de ces
peaux humaines.
Étant à l'Arbeitsstatistik, je fus
témoin d'un autre procédé. Le SS de service vint
déclarer que tel numéro devait figurer sur la liste
des morts lors du prochain appel. Il incombait aux interprètes
de transmettre la funèbre nouvelle et il ne restait au malheureux
qu'à se supprimer s'il voulait se soustraire au martyre. Je
ne citerai que ce cas qui ma ému jusqu'aux larmes. La victime
était un Français. Je fus donc obligé de lui
annoncer la terrible sentence. Le pauvre homme n'eut que la force
de murmurer : « Oh, ma femme et mes enfants… ».
Il essaya de se cacher dans le camp, mais vite découvert par
les Lagerschutz, il fut assommé comme un chien.
Était-ce la vengeance d'un SS. ou un ordre
de la Gestapo ? Je n'ai jamais su pour quel motif ces meurtres étaient
commis.

Pendaisons
L'appel
effectué au son de la musique était suivi d'un autre
spectacle non moins odieux. C'était l'heure de la pendaison.
Celle qui eut lieu le dimanche de Pâques me reste gravée
dans la mémoire. Après un appel ayant duré 6
heures, nous avions travaillé toute la matinée. Le Rapport-führer
nous annonça que nous allions avoir nos œufs de Pâques.
Aussitôt, tandis que la musique déversait ses flon-flon
de cirque, une vingtaine de camarades s'avancèrent, les mains
liées derrière le dos. Un morceau de bois solidement
fixé par un fil de fer recourbé vers la nuque, leur
servait de bâillon.
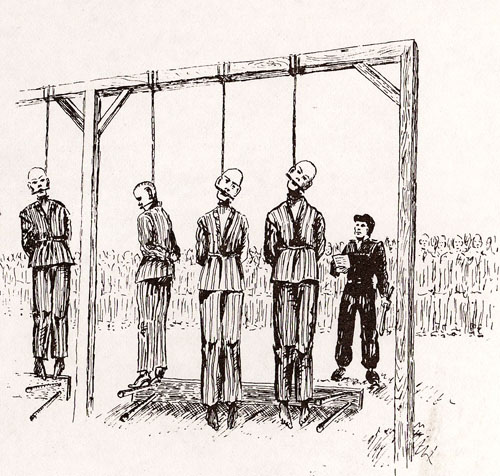
Ils
étaient pendus, là, devant nous...
Au même instant, la potence est dressée
sur la place d'appel. Par groupes de cinq, montés sur une espèce
de banc, la corde leur est passée au cou. Du pied, le banc
est basculé et les condamnés pendent lamentablement.
L'exécution se faisait en série. Une
fournée succédait à une autre. Il arriva qu'un
des corps se ranima, alors que le groupe suivant se balançait
au bout de la corde. Sans sourciller, un SS saisit un tabouret et
brisa le crâne de cet homme. La cervelle en jaillit.
Près de moi, un jeune Parisien horrifié
laissa échapper un cri : « Oh ! maman… ».
Le S.S. le plus proche l'entendit. « Comment, tu protestes
», lui dit-il, et sur ce, il le conduisit à la potence.
Le moindre larcin, la moindre indiscipline menaient
à la potence. Le sabotage y menait tout droit. Il suffisait
seulement d'être soupçonné. Trouvant en effet
difficilement les coupables, les SS exécutaient tous ceux qui
étaient susceptibles d'avoir commis le délit. Un jour,
85 malheureux furent ainsi pendus.
On devine les moments d'angoisse que chaque désignation d'otages
faisaient vivre à tous.
Quand le sabotage semblait certain, la pendaison
se faisait plus cruelle. Les suppliciés étaient enlevés
de terre par la traction d'un treuil électrique qui les décollait
doucement du sol. N'ayant pas subi la secousse fatale qui assomme
le patient et souvent lui rompt la nuque, les malheureux passaient
par toutes les affres de l'agonie.
D'autres fois, un crochet de boucher était
planté sous la mâchoire du condamné qui était
suspendu par ce moyen barbare.
Mais il y eut pire encore. Sur l'instigation du
fameux Oberscharführer Sanders SD, avec lequel j'eus affaire,
d'autres modes d'exécution furent employés pour les
saboteurs.
Les malheureux étaient condamnés à
creuser d'étroits fossés où leurs camarades étaient
contraints de les enterrer jusqu'au cou. Ils restaient abandonnés
dans cette position pendant un certain temps. Ensuite, un SS armé
d'une hache à long manche, coupait les têtes.
Mais le sadisme de certains SS leur fit trouver
un genre de mort plus cruel. Ils ordonnaient aux autres détenus
de passer, avec des brouettes chargées de sable, sur ces pauvres
têtes. Je suis encore obsédé par ces regards que
je ne puis oublier ; regards de supplication et de désespoir,
dans un visage tuméfié, qui ne conservait rien d'humain.
Les corps étaient ensuite déterrés et portés
aux fours crématoires.
La pudeur m'interdit de parler ici d'autres crimes
dont la justice appréciera l'extravagance et l'horreur...
On
s'étonnera qu'en opposition avec ce mépris officiel
de la mort, les Boches aient prévu des règlements propres
à apporter des soins aux malades.
Le sadisme de ces gardiens devenus bourreaux, s'accommodait
en vérité de la mise en pratique de principes d'hygiène
dont la théorie était d'ailleurs fort bien conçue.
Mais on verra par la suite que les mesures adoptées n'offraient
en fait, pour les détenus, que de nouvelles occasions de souffrir
et de mourir.

Désinfection
Ce
seul mot nous faisait peur. Pour ne pas écourter le travail,
elle se pratiquait le soir après l'appel. C'était un
prétexte à de nouveaux et longs stationnements dehors,
sans vêtements, même par les plus grands froids.
À l'entrée du block destiné
à la désinfection, nous étions accueillis par
une schlague fournie. Ensuite, rasés sur toutes les faces,
nous passions au bassin d'eau crésylée, mais toujours
à portée des matraques, et à la douche obligatoire.
Une centaine de pommes d'arrosage suffisaient à 600 ou 700
hommes. L'eau qu'elles déversaient était tantôt
chaude, tantôt froide, lorsqu'elle n'était pas intentionnellement
trop chaude, ou trop froide. Les malheureux atteints de la gale étaient
alors repérés, et copieusement schlagués, leurs
plaies s'envenimaient rapidement et, faute de soins, infectés
de gangrène, refoulés de partout, ils mourraient isolés,
souhaitant la mort qui était une délivrance.
Nos vêtements, liés au préalable,
passaient à l'étuve pendant ce temps. Ils étaient
parfois rendus à la sortie. Souvent, nous en restions privés
jusqu'à 2 heures du matin.
Nous devions ainsi rejoindre le block en courant,
par la pluie, dans la boue, et coucher nus.
La distribution des vêtements désinfectés,
mais humides, était un prétexte pour avancer l'heure
du lever.
Beaucoup de détenus ont contracté,
pendant ces nuits mouvementées, des refroidissements ayant
occasionné leur mort. La désinfection n'atteignait d'ailleurs
pas son but. On cherchait à supprimer la vermine, mais les
paillasses n'étant jamais renouvelées, nous n'étions
pas plus de 24 heures sans éprouver les piqûres de parasites
variés.

L'infirmerie
Les privations, la fatigue, les longs appels, les mauvais traitements,
les refroidissements, devaient augmenter chaque jour le nombre des
malades et des morts. Pour ceux-ci, le four crématoire fonctionnait
sans arrêt. Quant aux malades, la question était plus
difficile à résoudre.
Il y avait d'abord l'infirmerie, le « Krankenbau
ou Revier ». Au début, son organisation était
lamentable.
Pourvus d'un Kapo vert, ses hôtes devaient
travailler au terrassement. Le régime s'adoucit ensuite. Le
kapo, fumiste de sa profession, se mit à pratiquer des opérations.
Un français de plaignit de maux de ventre.
Il voulut pratiquer l'ablation de l'appendice. Il choroforma le patient,
lui badigeonna le ventre à la teinture d'iode, et pratiqua
une marge laparatomie, sortant à peu près tous les intestins.
Furieux de ne pas trouver l'appendice, il s'écria : « Mais
ce chien-là n'a pas d'appendice », puis il fit au patient
une injection intracardiaque d'un poison mortel et le fit jeter par
ses aides sur le tas des morts de la journée.
Un détenu souffrait-il d'un mal blanc ou d'un panaris ? Sans
hésiter, il amputait le doigt malade.
Pour être admis au Revier, on devait
se présenter après l'appel, mais jamais l'admission
n'était immédiate et aucun soin n'était donné.
Si le malade accusait une température à 39°, il
lui était remis un papier l'autorisant à se présenter
à la visite le lendemain matin. Venait-on à cette visite
sans papier, ou le Kapo du Revier refusait-il de vous reconnaître
? Une vigoureuse distribution de 25 coups de gummi sur la place d'appel
sanctionnait ce délit, en attendant le départ pour un
kommando de punition.
Par la suite, quelques médecins français
purent exercer au Revier, mais SS et Kapo entravèrent constamment
leurs fonctions.
Ordonner du repos à des êtres exténués,
c'était organiser le sabotage. Cependant, ces médecins
ont fait preuve du plus beau dévouement. Je ne citerai que
ce bon vieux docteur Mathon, surnommé papa Girard et le docteur
Lagey, de Vitry-la-Ville.
Ce dernier fut envoyé à Harzungen,
où, par des survivants, j'ai appris son dévouement de
jour et de nuit pour arracher ses camarades à la mort.
Combien de pauvres êtres, dévorés par la fièvre,
les jambes enflées par l'œdème, ou les os saillants
sous la peau diaphane, en proie à une dysenterie tenace ou
couverts de furoncles, sont morts parce que leur admission trop tardive
au Revier rendait tout soin inutile !
Pour recueillir les hommes exténués
et reconnus inaptes au travail, un Block, dit « de ménagement
» avait été agencé. Deux par paillasses,
sans vêtements sous leur couverture, ceux-ci y attendaient la
mort. Le chef de block, un vert naturellement, sans aucune culture,
jouait au docteur. Il auscultait gravement et, cornet acoustique en
mains, décidait des entrées et des sorties. Il était
fin gras ce « toubib » improvisé qui se réservait
exclusivement les colis destinés à ses malades. Il se
soignait, lui, et c'était l'essentiel. Quant à ses pensionnaires,
il les avait divisés en deux groupes parqués de chaque
côté du block. D'une part, ceux qui étaient gravement
atteints, d'autre part, ceux qui pouvaient vivre quelque temps encore.
Les seconds se guérissaient seuls s'ils le
pouvaient. Quant aux premiers, on ne s'en occupait que pour les maltraiter
et hâter leur fin. C'étaient pour la plupart des dysentériques.
Il régnait dans ce block une odeur insupportable.
Chaque fois q'un moribond souillait sa paillasse,
infirmiers et médecins improvisés lui administraient
une sévère correction. Avec de tels soins, 30 ou 40
hommes mouraient chaque jour.
Dans la suite, ce block fut désaffecté,
et les hommes inaptes furent rassemblés périodiquement
et envoyés dans des Himmel-kommandos.

Himmel-Kommando
( Kommando du ciel )
Les
SS désignaient ironiquement sous ce nom les détachements
composés d'invalides et dirigés tous les trois mois
sur Lublin. Beaucoup succombaient durant le voyage. Les autres mourraient
presque tous dans ce camp lointain.
Pour éviter la divulgation des secrets relatifs
aux fabrications de guerre, aucun des survivants n'est revenu dans
le camp d'origine. Cependant, quelques rares convalescents reparaissaient
à Dora. Pour préciser mon témoignage, voici quelques
indications sur le dernier Himmel-Kommando que je vis fonder
à Dora.
Il comprenait 1 200 malades, parmi lesquels mes
amis Touvet et Terver d'Épernay, l'abbé Bourgeois, de
Besançon, M. Grandremy, de Reims. Entassés sans soins
dans un block spécial depuis la veille, à la tombée
de la nuit, ils furent embarqués dans des wagons à bestiaux.
Le plancher était couvert d'une épaisse couche de chaux,
masquée par un léger lit de paille. Se traînant
ou portés par des infirmiers d'occasion, ces pauvres gens vieillis
avant l'âge, faisaient peine à voir. Les moribonds étaient
jetés en un tas, pêle-mêle. Puis, les portes fermées,
seule la petite lucarne grillagée, donnait une aération
insuffisante pour toutes ces poitrines oppressées et affaiblies.
Le train, chargé, stationna huit jours en gare. Restés
sans soins et sans nourriture, 800 malades sur 1 200 moururent avant
que le convoi ne s'ébranlât. J'ai assisté à
la discussion assez vive entre le SS chargé des fours crématoires
et le chef du convoi. Le premier refusa de faire incinérer
les cadavres, parce qu'il y en avait trop.
Quelques mois plus tard, 25 rescapés revenaient
à Dora. L'un d'eux me fit le récit de l'extermination
de ses malheureux compagnons. Ils avaient été dirigés
sur Bergen-Belsen, et non sur Lublin. Les mauvais traitements avaient
tué la plupart des survivants du voyage.
Ces Himmler-kommandos avaient à peine quitté
le camp, que d'autres convois arrivaient de Buchenwald. L'Arbeitsdienstführer
nous les annonçait ainsi : « Ist frische Ware angekommen
so und so viel ", ( il nous est arrivé de la nouvelle
marchandise, tant et tant ).
Ce n'étaient même plus des hommes.
Et cette nouvelle marchandise vieillissait vite. À Dora, six
mois suffisaient largement pour lui faire prendre place dans le rebut
des Himmel-kommandos, du moins ce que les fours crématoires
n'avaient pas réduit en cendres.

Fours crématoires
Longtemps,
Dora n'eut pas de four crématoire. Pendant plusieurs mois,
par camions, les cadavres étaient transportés à
Buchenwald. Ces arrivages funèbres expliquent la mauvaise réputation
que Dora avait à Buchenwald même. Plus tard, les fours
construits à Dora, ne suffisaient pas pour incinérer
les cadavres relevés dans le camp et ses annexes.
Le surplus, arrosé de matière inflammable,
était brûlé à l'extérieur. En juin
1944, on construisit un nouveau four d'un modèle perfectionné,
afin de pourvoir aux nouveaux besoins du camp, dont on prévoyait
de quintupler la population.
Appelé chaque jour aux fours crématoires
pour y contrôler les listes des morts, j'ai trop souvent, hélas
été témoin par moi-même de l'horreur de
ces enfers.
Le Kapo, un exécrable bandit, semblait éprouver
une volupté sadique dans l'accomplissement de sa macabre besogne.
Sans aucun respect des morts, il obligeait le détenus à
sectionner bras et jambes pour réduire le volume des cadavres.
Un jour, n'ayant pu lui cacher mon dégoût, ce kapo me
dit amicalement : « Sois tranquille, quand ton tour viendra,
tu auras une cuisson pour toi seul ».
Parmi ces cadavres, un corps, une fois, se dressa…
Sans hésiter, le SS le fit abattre sur le champ, sous prétexte
qu'il était déjà rayé des contrôles.
Ces tueries étaient minutieusement réglementées
par les contrôles. La paperasserie y était abondante
et administrative. Chaque mort était soigneusement pointé
sur une liste, tandis que l'on ôtait son numéro matricule.
La dépouille était estampillée à la cuisse
et livrée aux gens des fours. Lorsque le second contrôle
révélait une erreur, une nouvelle vérification
des tampons était imposée.
Les cendres étaient jetées dans la
fosse des vidanges et allaient ensuite amender le potager des SS.

Culte religieux
À
ses victimes, la Gestapo refusait toute consolation religieuse. Elle
ne tolérait aucune cérémonie, ni pour les vivants
ni pour les morts. Le clergé lui-même, était spécialement
pourchassé. Affectés aux plus rudes kommandos, prêtres
et religieux étaient mis dans l'impossibilité d'exercer
leur apostolat ; d'ailleurs tout acte du culte, même privé,
était puni de pendaison.
On craignait trop, qu'autour d'eux, les détenus
ne parviennent à se grouper, et à se soutenir ainsi
mutuellement. Chacun devait souffrir seul, sans autre espoir que celui
de mourir bientôt.
Dès l'arrivée à Buchenwald,
prêtres et religieux furent invités à se faire
connaître. Le SS qui fit cette communication ajouta qu'un accord
avait été passé avec le Saint-Siège, en
vue de leur transfert dans un autre camp, où ils devaient jouir
de certains avantages.
Suivant le conseil reçu de l'abbé
Stenger, je me gardai bien de sortir du rang, je ne pouvais pas me
fier à cette phypocrite déclaration.
Les prêtres appartenant à mon convoi
prirent la même décision. Avions-nous, en effet, le droit
d'abandonner à leur triste sort, les camarades que les secours
de la religion pouvaient réconforter dans ces terribles épreuves
? Grâce à eux, le culte catholique peut être célébré
de façon clandestine au camp de Dora.
Pendant 10 mois, j'ai toujours porté sur
moi la Sainte-Réserve. Des prêtres, qui s'exposaient
constamment à la mort, m'ont sans cesse réapprovisionné.
Je dois nommé ici l'abbé Bourgeois, le RP Renard, trappiste,
et ce cher abbé Amyot d'Inville, du diocèse de Beauvais,
tous trois morts à Dora ou dans les convois qui en sortirent.
Au début, n'ayant rien pour célébrer
la messe, nous dûmes nous contenter de nous réunir le
dimanche pour prier en cachette, après l'appel, soit dans un
bosquet, soit dans un des nombreux blocks en construction, loin des
regards des SS ou des Lagerchutz.
Peu de temps après, j'eus l'immense bonheur
de trouver dans un colis un peu de farine et un sachet de raisins
de corinthe. Le plus difficile était de fabriquer des hosties.
Plus tard, grâce aux avantages de ma place à l'Arveitsstatistik,
il m'était facile d'en faire cuire la pâte dans une boîte
de sardines. J'obtenais ainsi des hosties grosses comme des lentilles
qui furent consacrées lors d'émouvantes messes au cérémonial
encore plus primitif que dans les Catacombes.
Pour éviter que l'attroupement autour du
célébrant n'attirât l'attention, un assitant lisait
tout haut un lambeau de journal qui avait servi d'emballage.
L'abbé Amyot d'Inville utilisait un gobelet
en guise de calice et un mouchoir faisait office de nappe et de corporal.
Ses genoux remplaçaient la table d'autel.
À la moindre alerte, une musette recevait les objets suspects.
L'abbé Amyot s'était déclaré menuisier
; partageant le sort de ses compagnons de misère, il ne pouvait
guère fréquenter que les hommes de son block.
Servi par mes fonctions, je pouvais pénéter
partout, même au Revier. À combien de mourants,
j'ai pu donner ainsi Celui devant lequel ils allaient paraître.
Je vois encore ces yeux enfoncés dans leurs orbites s'illluminer
à l'offre très discrète de leur donner le Bon
Dieu. Ah ! ... Est-ce possible !... La communion !... Quelle
joie pour moi-même d'apporter dans cet enfer un faible rayon
céleste !
J'ai beaucoup souffert à Dora, je n'ai pas
à le cacher, la suite de ce récit le montrera suffisamment.
Toutefois, ces heureux moments ont compensé largement toutes
les heures pénibles que j'ai pu y vivre. Je remercie Dieu de
m'avoir permis, à moi simple religieux, de remplir une des
fonctions sacertodales auxquelles je n'aurais jamais osé aspirer.
De nombreux camarades, après l'appel, cherchaient
à me rencontrer ou venaient me trouver dans mon block, dans
l'espoir de communier. On s'ingéniait à ruser et à
dépister les SS et leurs suppôts. Des camarades ignorants
regardaient avec envie cette bouchée de pain ou cette pomme
de terre cuite sous la cendre que je partageais fraternellement avec
un compagnon.
Nul ne s'est douté que c'était un moyen de transmettre
une des minuscules hosties consacrées. Faut-il le dire ? L'endroit
le plus tranquille et rarement inspecté étant les latrines,
c'est là que je passais à des camarades la Sainte Hostie.
Que Dieu me pardonne, mais la foi et la ferveur des communiants rachetaient
largement l'indécence du lieu.
Comme custode, je ne disposai d'abord que d'une
minuscule boîte de carton qui avait été fabriquée
par M. Arsène Dourneau, instituteur à Saint-Jean-sur-Mayenne,
que j'avais casé comme relieur. Mais cette boîte s'écrasa
vite dans ma poche.
Deux amis d'Épernay, Guillepin et Guérin,
m'en façonnèrent une superbe aux ateliers du Tunnel.
Ils risquaient la pendaison pour sabotage. Cette boîte était
trop voyante et faillit me perdre. Comme je venais de communier en
viatique un pauvre jeune homme qui me mourait de faim, je fus surpis
par un Lagerschutz qui s'empara de la boîte et s'informât
de son contenu. « Ce sont des vitamines, répondis-je,
que j'ai reçues dans un colis ». Angoissé,
je me demandais ce qu'il allait faire de mon trésor. Jetant
la boîte au loin, il me hurla : « Tu ne sais pas
qu'il est formellement interdit d'avoir des médicaments ».
J'attendis qu'il eut le dos tourné et j'allai rechercher ma
précieuse boîte et le divin Remède qu'elle contenait.
M. le Comte Paul Chandon-Moët possédait
le même précieux dépôt sacré et réconfortait
les camarades de son block.
De son côté, l'abbé Amyot d'Inville
se dépensait sans ménager ses forces et parfois au mépris
du danger.
Chaque soir, il s'efforçait de me rejoindre
à mon block et je l'informais des malheureux qui réclamaient
son ministère.
Après une longue journée d'un travail
harassant et exténué de fatigue, il s'imposait de porter
ses consolations à tel de nos camarades que je savais mourant
et qui n'avait pas été accepté au Revier.
Nombreux sont les pauvres compatriotes qu'il a pu
assister. Un jour, cependant, il se trahit. Un compagnon de labeur
défaillit sous ses yeux. N'écoutant que son cœur
de prêtre, l'abbé Amyot lui donna une dernière
absolution.
Un SS l'aperçut, fonça sur lui en
hurlant : « Pfaffe" » ( curaillon ) et
le burtalisa de façon atroce. Le lendemain, il était
désigné pour le kommando de Wieda-Ellrich. Je voulus
lui épargner cette mutation ; lui-même m'en dissuada
: « Ici, me dit-il, je suis découvert et, même
en cachette, je ne pourrai plus exercer mon apostolat sans attirer
l'attention. Ailleurs, j'espère pouvoir être utile ».
Dominant ses souffrances, il faisait déjà
d'autres projets. Dieu se contenta de ses héroïques dispositions
en l'appelant à la récompense éternelle. Durant
son transfert, il tomba d'épuisement et mourut, comme tant
d'autres, dans un fossé de la route.
Après ma libération à Bergen-Belsen,
j'ai retrouvé le bréviaire de ce cher martyr, j'ai pu
faire parvenir cet unique souvenir à sa famille éprouvée,
puisque trois autres de ses frères sont tombés au champ
d'honneur durant cette guerre.
À partir du jour où ce cher abbé
avait été surpris dans l'exercice de son ministère,
ce fut une véritable chasse à travers le camp pour rechercher
d'autres ecclésiastiques s'il s'en trouvait.
Soupçonné moi-même par le Kapo
de l'Arbeitsstatistik, celui-ci me dit un jour : « Je
me demande si toi aussi, tu n'es pas un curaillon ?..." »
mais je sus déjouer ses soupçons en plaisantant sur
de pareilles suppositions.
Il m'était d'ailleurs facile de tromper sa
vigilance. Très adonné à la boisson, il était
ivre dès 9 heures du matin, buvant de l'alcool à brûler
comme du lait. Grâce à des complicités, je pus
m'en procurer un litre de temps en temps et, en endormant cette brute
alcoolique, j'agissais en maître, sans être trop inquiété.
Il ne restait plus au camp qu'un seul prêtre
originaire du Diocèse d'Amiens. Il travaillait au tunnel presque
toute la journée du dimanche. Comme il savait un peu l'allemand,
je pus lui faire obtenir la place de secrétaire dans son kommando.
À son bureau, il s'ingéniait pour célébrer
la messe. Le tiroir de sa table de travail cachait l'indispensable
des objets liturgiques. Était-il seul ? il ouvrait le tiroir
et commençait à réciter les prières essentielles
de la messe. Un indiscret arrivait-il ? Le tiroir se refermait,
et le prêtre, toujours courbé sur sa table de travail,
continuait sa besogne de secrétaire.
Allant d'un bureau à l'autre, je pouvais
lui porter le pain et les raisins de corinthe à consacrer et
renouveler ma provision d'hosties.
Au moment de mon arrestation, ma veste n'ayant pas
été fouillée, je glissai la boîte contenant
la Sainte-Réserve sous la paillasse de mon voisin, Paul Heintz,
cousin de Monseigneur l'Évêque de Metz, et mon compagnon
à l'Arbeitsstatistik où je l'avais introduit.
Durant six mois, je me suis demandé s'il
avait aperçu mon geste et j'étais dans de cruelles incertitudes.
Lors de ma sortie de prison, j'obtins des apaisements à ce
sujet, les hosties avaient pu être remises au prêtre d'Amiens.

À
l'Arbeitsstatistik
Lors
de mon arrivée au camp et durant quelques mois, j'ai subi en
tout le sort commun. J'ai fait du terrassement, j'ai poussé
le wagonnet, porté le rail et le sac de ciment, coulé
du béton. Je souffrais terriblement des yeux, surtout de l'œil
gauche, brûlé par une pelletée de ciment qu'un
kapo m'avait lancée en pleine figure. De plus, j'eus un doigt
malade et le poignet enflé à l'excès, par les
efforts qu'il fallait fournir pour bétonner. Le ciment était,
en effet, entièrement mélangé à la main.
Miné ainsi par une fatigue excessive, hanté par la mort
et le spectre du four crématoire, mes forces déclinaient
journellement.
C'est dans ces circonstances qu'un soir après
l'appel, la radio demanda des Schreiber ( Secrétaires
) et des Klaufleute ( Commerçants ). Ceux-ci devaient
se présenter à l'Arbeitsstatistik. J'eus un moment
d'hésitation, la méfiance était de rigueur. Je
risquais, de plus, d'encourir les foudres de mon kapo s'il apprenait
ma démarche. Mais, mourir pour mourir, je me décidai.
Arrivé à l'Arbeitsstatistik,
je fus reçu par le SS entouré de plusieurs employés
de bureau ( des verts ). On me demanda le motif de ma démarche.
Je répétai les paroles que la radio venait d'émettre.
On me demanda ma profession. « Instituteur »,
dis-je. Le SS jeta un coup d'œil sur le numéro de ma veste,
sur mon triangle, et ajouta : « Mais tu es un fumier de
Français », puis me demanda mon lieu de naissance.
« Ah ! Me dit-il, tu es encore un de ces cochons de Lorrains
qui n'ont jamais voulu opter pour l'Allemagne, c'est sans doute la
raison pour laquelle tu es en camp de concentration ».
Cependant, le kapo, ayant besoin d'un interprète,
insista et l'on prit mon numéro. Je rentrai à mon block.
Tard dans la nuit, le chef appela mon numéro et me remit un
billet stipulant que je devais me présenter le lendemain à
l'Arbeitsstatistik.
Toute la nuit, j'appréhendai la réaction
de mon kapo. Je le savais très susceptible, autoritaire, méfiant
et jaloux. Au réveil, je lui présentai mon billet.
Il prit la chose de très haut ; ma démarche de la veille
avait déjà été mouchardée. Il me
dit ceci : « Ah ! Tu es allé te plaindre sur mon
compte ( il faut croire qu'il n'avait pas la conscience tranquille
), je t'assommerai quand tu reviendras ».
Dans
la suite, je n'ai pas oublié ce mauvais sujet, j'ai profité
d'une circonstance favorable pour glisser son numéro dans la
liste d'un transport pour Kleindodungen.
À huit heures, je me présentai au
bureau. Le kapo me reçut par ces mots : « As-tu
des poux ? » et, sans attendre ma réponse, m'envoya à
la Kammer ( Block d'habillement ) pour toucher habits et linge
plus propres et passer ensuite à la désinfection.
J'y fus seul avec mon ami Pierre Ziller, de Marseille,
admis en même temps que moi à l'Arbeitsstatistik
où il fut affecté au service de nuit, et qui rendit
tant de services aux camarades français. Ainsi nous n'eûmes
pas à craindre le coup de schlague au moment de passer à
la cuve crésylée. Quelques heures après, bien
en forme, je prenais mon nouveau poste.
En dehors de mes fonctions d'interprète,
j'aidais le détenu chargé de dresser les nombreuses
listes de l'affectation, de la mutation des kommandos, du contrôle
journalier des malades, des entrées et sorties du Revier
et, enfin, des pauvres et innombrables morts. Contrôle sérieux,
car c'est de l'exactitude de ces listes que dépendait l'accord
à l'appel du soir, et la durée de ces stationnements
que les survivants n'oublieront jamais plus. Deux mois après
mon entrée, je remplaçai la camarade que j'aidais et
qui fut renvoyé à la suite de difficultés avec
le kapo.
Cette situation à l'Arbeitsstatistik
avait pour moi de gros avantages ; tout d'abord, le travail d'écriture
était un jeu à côté du travail manuel que
je venais de connaître. De plus, je couchais désormais
dans un block divisé en des chambres séparées,
à huit lits individuels.
Ce n'était plus la colère, la dispute
et la bataille de chaque soir pour une misérable paillasse,
pour une couverture, ou tout simplement pour une place à même
le sol.
De plus, la nourriture était moins mauvaise.
Nous touchions nos rations au bureau même, et il y avait souvent
un supplément dont bien des camarades ont pu profiter.
Mais toute médaille a son revers. Il s'est
passé dans ce bureau des faits horribles, que le détenu
partageant le sort commun a ignorés, et dont je fus, malgré
moi, le témoin.
J'en étais excédé et seule
la certitude de rendre service à mes co-détenus me retint
à ce poste où, moralement, je souffrais atrocement.
La distribution sauvage de 25 coups de gummi y était
fréquente. Un vert, nommé Werner, bras droit du kapo,
était spécialisé dans la schlague. Cette brute
avait été condamnée 7 fois par les tribunaux
allemands pour vol et assassinat.
Je m'étais difficilement endurci à
ce spectacle auquel j'assistais impuissant, et je masquais difficilement
mon angoisse, lors des séances au cours desquelles le SS désignait
les détenus qui devaient figurer « morts »
à l'appel du soir. Toutefois, pendant 6 mois,
j'eus l'occasion bien qu'en courant de gros risques, de rendre service
à des camarades français.

L'échec d'un complot
Un
jour, le bureau de l'Arbeitsstatistik reçut un nouvel
interprète. C'était un russe, Nicolas Preschenko, gars
solide, énergique, une honnête figure, âgé
d'une trentaine d'années ; il m'inspira de suite la plus entière
confiance.
Comme moi, ce brave garçon se demandait souvent
s'il lui restait quelque chance de revoir sa patrie.
Comme Geheimnisträger ( porteurs du secret des V1
et V2 ), nous nous savions condamnés à mort et destinés
à être massacrés à l'approche des Alliés.
Un SS dans un moment de confidence nous avait, d'ailleurs,
donné cet avertissement brutal : « Si cela doit
aller de travers pour nous, aucun de vous n'en sortira ».
Or, le passage de plus en plus fréquent de
bombardiers alliés nous laissait présager une action
militaire décisive. Le moment n'était-il pas venu d'essayer
de mettre au point un projet destiné à nous sauver du
massacre ? Mourir pour mourir… Devions-nous nous laisser égorger
sans réaction ?
Vers la mi-octobre, je dis à mon camarade
: « Tu vois, Nicolas, on ne nous laissera pas sortir vivants
d'ici. En nous organisant, nous pourrons, au jour propice, un peu
avant l'arrivée des Alliés, tenter de nous débarrasser
de nos bourreaux. Au jour venu, que tous se soulèvent, s'emparent
des miradors, maîtrisent les SS… Des milliers d'entre nous
peut-être périront dans l'assaut, mais des milliers échapperont
ainsi au massacre inévitable. Parle à tes compatriotes,
je me charge des Français, et que tous marchent au cri convenu
de " Paris " ».
Chacun devait recruter trois camarades sûrs,
qui se chargeraient d'en recruter trois autres, et ainsi de suite.
Comme toujours, tout alla bien au début,
mais notre action était prématurée. Les Russes
manquèrent de prudence et Nicolas fut arrêté.
Torturé, il révéla l'organisation, mais, selon
la promesse mutuelle que nous nous étions faite, en cas d'échec,
de ne pas charger les amis, il déclara que cette tentative
était exclusivement russe.
Un jour, se rendant à un nouvel interrogatoire,
ce brave Nicolas, honteux d'avoir faibli, échappa à
son gardien et se lança tête baissée contre le
mur au fond du couloir.
Il fut relevé le crâne fendu et soigné
par un médecin qui dut en répondre sur sa tête.
Finalement, Nicolas fut pendu.
Du côté français, on soupçonna
une organisation analogue et, dans ce triste épisode, je dois
dénoncer le rôle ignoble d'un Maurice Naegel, se disant
ingénieur chez Citroën à Paris. Voici en quelques
lignes l'histoire de cet individu.
Engagé au service de la Gestapo à Paris, son zèle
lui valut d'être promu au grade de Oberleutnant. Viveur,
ses besoins d'argent étaient grands, il chercha le moyen d'en
gagner beaucoup.
Lorsqu'il était sur les traces d'un résistant,
il faisait porter les chefs d'accusation sur un homme innocent mais
qu'il savait riche et qu'il faisait incarcérer. Puis, il allait
voir sa victime en prison et lui offrait de la faire libérer
moyennant une somme importante.
Avec un mot du détenu, il allait trouver
la famille et touchait la forte somme. Il ne restait plus qu'à
arrêter le véritable résistant et, dans une confrontation
avec la victime, il prouvait l'innocence de celle-ci et obtenait sa
libération.
Selon ses propres aveux aux autorités anglaises auxquelles
il fut remis dès leur arrivée, il reconnut avoir gagné
entre trois et quatre millions.
Mais un jour vint où son jeu fut découvert
par la Gestapo, et il fut envoyé à Buchenwald.
Il chercha immédiatement, ainsi qu'un de
ses amis, un Belge arrêté avec lui, à entrer en
relation avec les SS pour se mettre à leur service.
Le Belge obtint un rendez-vous, mais il fut quelques
jours après, ramené mort à son Block.
Le dénommé Maurice Naegel, prenant
peur, se tint tranquille. Il arriva à Dora fin septembre 1944
et prit facilement contact avec les SS, ceux-ci circulant presque
toute la journée dans le camp.
Par l'intermédiaire d'un de ces derniers,
il adressa au Commandant du camp une lettre dont la teneur était
approximativement ceci : « J'ai été en France
Oberleutnant à la Gestapo. Ayant toujours le même
idéal, c'est-à-dire servir l'Allemagne, car je suis
convaincu que mon incarcération est une erreur judiciaire,
je me mets entièrement à votre disposition pour dépister
dans le camp ce qui serait d'action anti-allemande. Je serais même
heureux de m'engager dans les SS ». Le Commandant le fit
venir, lui fit comprendre que cela n'était pas de son ressort
mais de celui de la SD ( Sicherheits-polizeidienst, police
secrète ). Il lui fixa un rendez-vous avec l'Oberscharführer
Sanders de la SD. Celui-ci félicita Maurice mais ajoutaqu'il
lui fallait des preuves de sa sincérité.
« Nous soupçonnons, dit-il, qu'il
existe en ce moment, dans le camp, une organisation russe de révolte,
et nous vous demandons s'il n'y a rien de pareil chez les Français.
Nous vous chargeons donc de nous indiquer les détenus français
qui feraient partie de cette organisation et, afin de vous faciliter
la circulation dans le camp, vous serez nommé " kapo "
à partir de ce jour ».
Grâce au poste que j'occupais, je fus mis
directement au courant de cette démarche, mais il était
déjà trop tard. Des camarades que j'avais « planqués »,
auxquels j'avais trouvé des Kommandos plus faciles ou que j'avais
soustraits aux Kommandos d'extermination, ignorant le double jeu de
cet individu, avaient parlé. Maurice, ainsi renseigné,
vint me voit à plusieurs reprises, me félicita de ce
que je faisais pour les camarades français et me demanda ma
manière d'opérer. Je fis l'étonné et je
niai. Il revint le surlendemain. « Je te félicite,
me dit-il, tu n'as pas besoin de nier, tous nos camarades parlent
de toi avec éloge, et, d'ailleurs, c'est si naturel que, dans
cette profonde misère, nous nous entr'aidions. De mon côté,
je veux faire tout mon possible pour rendre service, mais, dis-moi
que puis-je faire ? ». Je ne répondis point… et
dormis mal.
Le 4 novembre 1944, vers minuit, je suis réveillé
par les hurlements des SS armés jusqu'aux dents. Ils me cherchent,
ils viennent m'arrêter.
Ils me font enlever caleçon et chemise, fouillent
ma tenue de bagnard, mais par miracle ne trouvent pas ma petite boîte
contenant la Sainte Réserve. ( J'ai dit plus haut comment
je parvins à soustraire les hosties saintes à leurs
mains sacrilèges ). Sous bonne escorte, on m'emmène
chez le Rapportführer, où je trouve sept autres
camarades. Et la nuit même, dans une voiture cellulaire de la
SD, on nous conduit à la prison de Niedersachs Werfen où
commença immédiatement l'interrogatoire.
Maurice Naegel dirigeait, se posant en accusateur.
Devant les SS et SD qui présidaient, il nous frappait de la
façon la plus bestiale, surtout sur la plante des pieds. Tous
les sept, nous eûmes ce soir-là le corps couvert d'ecchymoses.
Le lendemain, nous étions transférés
à la prison civile de Nordhausen, où d'autres camarades
arrêtés la même nuit se trouvaient déjà,
entre autres Paul Chandon-Moët.
Maurice nous accompagna et devint kapo de la prison.
Sa conduite envers nous a été honteuse. Il insultait
les accusés, volait leurs rations alimentaires, frappait les
détenus avec férocité. M. Debeaumarché,
actuellement Directeur adjoint au Ministère des PTT, reçut
de cet énergumène en une seule journée 300 coups
de nerf de bœuf. Un autre détenu, Claude Lauth, en reçut
plus de 150.
Mais, le 13 décembre, ce misérable
était à son tour arrêté. Nous en étions
délivrés. Il fut incarcéré au Bunker de
Dora pour avoir eu des rapports avec des femmes russes et françaises
détenues à la prison. Il bénéficia durant
sa détention du régime de faveur accordé à
tous les Reichsdeutschen : ration complète des travailleurs
du camp avec droit à la promenade.
À peine arrivés à la prison
de Nordhausen, les interrogatoires reprirent. Naegel m'avait accusé
d'être le chef de l'organisation française et je fus
transféré au Bunker du camp de Dora.
Il n'y avait aucune comparaison entre la prison
de Nordhausen et celle du camp. Les nombreuses arrestations russes
avaient surpeuplé les cellules. Celles-ci mesuraient 1,70 m
sur 2,50 m et n'avaient comme ouverture qu'une étroite lucarne
à gros barreaux. Nous étions 17 à 23 détenus
par cellule ; il était impossible de s'entendre ou de s'asseoir
sinon les uns sur les autres.
Les interrogatories avaient lieu parfois le jour,
mais de préférence au cours de la nuit. Quelles scènes
horribles j'y ai vues et vécues ! Des nuits entières,
j'entendais crier, hurler et gémir. Les SS se mettaient souvent
à trois pour frapper sur le même malheureux qui refusait
de parler. Quand, sous la violence des coups, il s'évanouissait,
les SS le traînaient sous la douche froide et reprenaient de
plus belle leurs flagellations.
Vint mon tour. Les motifs d'accusation ne manquèrent
pas. Camarades planqués, numéros faussés, mouvement
de résistance organisé dans le camp, lettre non censurée
à un camarade de Harzungen, Pierre Pointe d'Épernay.
Pour comble de malheur, mon dossier de Châlons était
venu me retrouver avec des accusations inédites.
Tout cela me valut des heures d'interrogatoire avec
tout ce qu'elles comportent. Que les camarades auxquels j'ai rendu
service reçoivent ici l'assurance que jamais le moindre aveu
ne m'a échappé.

5 mois au Bunker
Décrire
ces cinq mois de Bunker, les plus durs, les plus angoissants
de toute ma captivité, il m'est impossible de le faire.
Je n'en donnerai qu'un court aperçu. Le régime
alimentaire comportait invariablement un litre de soupe et 100 grammes
de pain, distribués à 6 heures du matin. Deux fois par
jour, nous avions une sortie pour satisfaire aux besoins naturels
et faire un soupçon de toilette.
À la sortie de la cellule, afin de hâter
le mouvement, un SS distribuait des coups de cravache en cadence ;
il nous fallait filer ensuite entre deux autres SS tenant chacun un
chien en laisse, tandis qu'un quatrième SS accélérait
l'entrée du troupeau dans le petit lavabo.
Ce lavabo comportait deux sièges de WC et
deux robinets pour un effectif de 17 à 23 hommes. Nous ne disposions
que de deux minutes pour faire notre toilette. Il fallut nous numéroter
afin que chacun puisse tous les quatre ou cinq jours soulager ses
intestins atteints de dysenterie. Puis c'était le retour à
la cellule avec le même cérémonial frappant qu'à
l'aller. De temps en temps, deux ou trois SS ouvraient une cellule
au hasard et faisaient sortir un quelconque des détenus pour
lui administrer 25 coups, uniquement pour s'amuser. L'odeur nauséabonde
qui s'échappait de notre tas grouillant de corps malpropres
incommodait parfois ces Messieurs. On nous faisait alors aligner dans
le couloir pour une inspection des pantalons et on entendait cette
réflexion. « Toi, tu seras à la diète
pendant quatre jours, comme cela tu n'auras pas.. d'ennuis… ».
Un de mes compagnons de cellule, au retour d'un interrogatoire où
il fut frappé sauvagement, délirait sous l'atteinte
d'une forte fièvre. Le SS de surveillance dans le couloir ouvrit
la cellule et demanda qui avait causé. Je lui répondis
qu'il s'agissait d'un malade. Un regard féroce accompagna cette
remarque : « Si j'entends encore la moindre chose, je le
guérirai à ma façon… ». La cellule
à peine refermée, le malade reparla ; quelques instants
après, le SS ouvrit brusquement la porte et, d'un coup de barre
de fer, fendit la tête au malheureux. Le cadavre resta sous
nous durant trois jours.
Au cours de ces cinq mois, nous subîmes des
tortures de tous genres. Il y eut plus de 280 pendaisons. Les survivants
étaient dans la continuelle appréhension d'être
pris à leur tour. Nous avons vécu dans une atmosphère
de cauchemars et d'angoisses impossibles à décrire.
Le 9 mars 1945, les SS avaient groupé dans
une cellule une vingtaine de Russes destinés à être
pendus le lendemain. Se sachant condamnés, ces détenus
tentèrent une dernière chance de salut. Vers 19 heures,
les SS allaient prendre leur repas et un seul d'entre eux restait
de garde dans le couloir du Bunker. Les détenus avaient
réussi à démonter la planche destinée
à servir de lit mais toujours relevée contre le mur
par suite du manque de place.
Ils frappèrent à la porte de la cellule comme s'il s'y
passait quelque chose de spécial.
Le SS vint ouvrir et fut assommé d'un coup
de planche ; malheureusement, il eut encore la force de tirer quelques
coups de revolver qui donnèrent l'alerte.
Les SS accoururent et tuèrent les détenus, sauf les
cinq ou six seulement qui s'étaient échappés
du couloir.
Une chasse à l'homme commença dans
le camp. Un seul ne fut jamais retrouvé. Au fur et à
mesure que les fugitifs étaient ramenés au Bunker,
les SS les assommaient à coups de matraque dans le couloir.
Vers 22 heures, les SS accompagnés de leurs
chiens entrèrent dans toutes les cellules et nous firent sortir
en nous frappant de la façon la plus bestiale.
Ils firent déchausser tout le monde, prirent les chaussures
et les couvertures, démontèrent la planche servant de
lit, puis nous firent rentrer dans nos cellules à coups de
cravache. Bientôt après, les SS réapparaissaient
sous la conduite du SD Sanders, afin de choisir des otages.
Treize détenus furent pris dans ma cellule
; j'étais du nombre. On nous mit dans la bouche un morceau
de bois lié très fort sur la nuque par un fil de fer.
Nous étions placés par rangs de cinq et j'étais
au troisième rang.
Au moment de passer à la potence, comme c'était
uniquement une révolte russe, je fis signe que je voulais causer.
Je fus aperçu par Sanders qui avait mené les interrogatoires
du Bunker. Il me fit sortir du rang en hurlant : « Mais
ce cochon n'a pas encore causé, il parlera d'abord et, ensuite,
on le pendra ».
Je ne dus la vie qu'à un réflexe in
extremis, mais, hélas, à ma place, le SS qui me reconduisit
en cellule prit le premier Russe qui lui tomba sous la main.
Plus que jamais, le régime de terreur régna dans la
prison, de ce jour jusqu'au 20 mars, date des dernières pendaisons
russes.
Le SS Sanders tint parole, il voulut me faire parler
et c'est ainsi que je passai la nuit du 10 au 11 mars tantôt
sous les coups, tantôt sous la douche.
Malgré tout, j'eus le courage, grâce à Dieu, de
ne point parler. Mon devoir était de ne compromettre personne.
Heureusement pour moi, l'avnce des Américains
fut rapide et j'échappai à d'autres interrogatoires
d'où je ne serais probablement pas sorti vivant.

Évacuation à Bergen-Belsen
Nous
ne savions pour ainsi dire rien de ce qui se passait.
La veille de Pâques, il y eut à Nordhausen,
à 7 kilomètres du camp, un terrible bombardement. Le
2 avril au matin, nous voyons avec surprise par notre petite lucarne
les SS démonter la potence et en jeter les morceaux à
droite et à gauche. Ils détruisaient les témoignages
de leur cruauté.
Vers midi, nos cellules s'ouvrent brusquement et
on nous jette à chacun une boîte de conserves et une
boule de pain. Ignorant tout des événements en cours,
cette générosité subite nous laissa quelque peu
ahuris. Toutefois, dans la soirée du 3 au 4 avril, nous devions
avoir encore un moment de frayeur en voyant abattre dans la cour de
la prison une dizaine d'Allemands détenus politiques.
Alignés sur un rang, ils eurent l'honneur
de causer avec le chef du camp qui, aimablement, leur offrit une cigarette,
puis vint l'ordre bref de se mettre à genoux et rapidement,
d'un coup de revolver dans la nuque, les détenus anti-nazis
furent tués.
Le 4 au matin, les cellules s'ouvrent au cri désormais
bien connu des Français : « Raus, Raus »,
mais nous n'étions pas sans appréhension. Qu'allions-nous
devenir ? On nous jette à chacun une paire de chaussures au
hasard, sans tenir compte des pointures, de sorte que plusieurs détenus
marchèrent pieds nus. En arrivant au camp, nous nous apercevons
qu'on évacue. On nous dirige vers la gare où nous trouvons
7 à 8 000 camarades prêts à être embarqués.
La veille, un contingent équivalent était déjà
parti.
Nous étions 100 à 150 par wagon de
marchandises découvert. Nous ne manquions point d'air, mais,
par contre, nous étions exposés à la pluie et
au froid. Plusieurs camarades des wagons voisins me firent signe et
profitèrent des rares arrêts où l'on pouvait descendre
pour venir me voir. Tous me dirent combien ils avaient été
inquiets sur mon sort pendant ces cinq mois de cellule.
Certains ne me reconnaissaient pas, tant les souffrances physiques
et morales m'avaient ravagé.
Durant six jours et six nuits, nous avancions, puis
reculions, tantôt en direction de Hanovre, tantôt en direction
de Hambourg ; voyage angoissant et pénible.
Nous étions surtout tenaillés par
la faim, car nous n'avions plus rien touché, depuis la généreuse
distribution en cellule.
Puis, vint la fatigue, car nous étions trop
serrés pour pouvoir nous asseoir. Hélas, de nombreux
camarades succombèrent. À peine morts, ils étaient
dépouillés par les survivants qui cherchaient à
se garantir du froid. La mort était devenue pour nous une chose
si naturelle qu'on s'asseyait ou se couchait sur les cadavres, sans
le moindre égard.
Trois fois durant ces six jours, les SS nous firent
creuser des fosses en bordure de la voie. Des centaines de morts y
furent enterrés et la terre étrangère recouvre
ces tombes collectives sans que la moindre croix ou le moindre symbole
en marque l'emplacement.
Enfin, on nous débarque, après six
jours, à Celle, à une dizaine de kilomètres du
camp de Bergen-Belsen.
La plupart des détenus étaient usés,
à bout de force. Les pauvres malheureux qui ne pouvaient plus
marcher étaient jetés dans les fossés le long
de la route et achevés par les SS.
J'étais, moi-même exténué
par cinq mois de Bunker, je ne pouvais plus marcher et je ne
fus sauvé que par le dévouement de camarades qui m'entraînèrent,
notamment Paul Chandon-Moët qui me porta littéralement.
Le camp de Bergen-Belsen est tristement célèbre.
Il faudrait créer un langage plus puissant que le nôtre
pour décrire en traits de feu et de sang l'horreur d'un tel
charnier.
Le camp de Belsen était à ce moment
surpeuplé par plus de 51 000 détenus hommes et femmes.
Le typhus y régnait et une moyenne de 500 personnes y mouraient
chaque jour. Il y avait au moins 7 000 cadavres épars dans
le camp.
La plupart des détenus fuyaient les baraques
contaminées et logeaient sous des tentes qu'ils purent monter
dès le départ des SS. Les 1 700 Français, venant
de Dora et Ellrich survivants du convoi, eurent la chance d'être
mis dans la partie du camp de Bergen non contaminée par le
typhus.

Libération
Les
12 et 13 avril, le bruit du canon se rapproche. Déjà,
les SS fuient les uns après les autres, des fusées éclatent
dans la nuit... des incendies s'allument. Tout cela
est de bon augure, mais nous ne savons rien de précis.
Le 15 avril, vers 14 heures 30, nous entendons tout
à coup des ronflements de moteurs. Des chars, des autos blindées,
pénètrent dans le camp. C'étaient les Anglais,
l'Armée de la Délivrance... Ce fut un indescriptible
délire joyeux de milliers d'hommes qui tous revenaient des
frontières de la Mort et qui, maintenant, se sentaient libres.
J'étais à ce point malade, brisé,
fatigué, que je puis à peine me traîner à
la fenêtre de la pièce où mes camarades m'avaient
déposé.
Je vis passer nos Libérateurs, et j'éprouvai,
moi aussi, cet ardent et vibrant bonheur que clamaient toutes les
poitrines : « LIBRES ! LIBRES ! ».
Les couleurs françaises, sorties on ne sait
d'où, flottaient déjà sur différents Blocks
avec les couleurs belges et russes. Les SS furent arrêtés
dans les bois avoisinants où ils s'étaient réfugiés,
entre autre le médecin SS du camp de Dora, lequel, pour avoir
la vie sauve, promit au Commandant anglais de lui remettre un document
dont nous eûmes connaissance plus tard.
Ce document, signé par Himmler, était
ainsi conçu : « La remise du camp n'entre pas en
ligne de compte, il doit être évacué de suite
et aucun prisonnier ne doit tomber vivant aux mains de l'ennemi. Si
le temps le permet, détruire tout dans le tunnel, mais à
la seule condition que tous les cadavres disparaissent, sinon évacuer
sur Hanovre ou Hambourg, où tout est prévu pour la destruction.
Si trop tard, évacuer sur Belsen et les supprimer par empoisonnement ».
En effet, le pain destiné à ce crime
monstrueux était prêt dès notre arrivée.
Le fait fut confirmé par le Lagerarzt ( médecin
du camp ) au Commandant anglais. Les tommies nous comblèrent
de gentillesse et de vivres, ce qui fit encore la perte de beaucoup
d'entre nous. Nous étions affamés, à bout de
forces ; le Commandant crut bon de nous donner à manger plusieurs
fois par jour, et de nombreux camarades furent victimes de la dysenterie,
conséquence de ce trop subit changement de régime.
Je quittai cette Allemagne maudite, le cœur
serré à la pensée des nombreux Français
qui y sont morts.
Je partis avec le dernier transport de Bergen dans
un convoi de malades. Les Anglais firent leur possible pour nous permettre
ce voyage dans les meilleures conditions.
Ils mirent à notre disposition des voitures
sanitaires jusqu'en Hollande, et ensuite un train sanitaire de haut
luxe. Sur les 180 malades graves que nous étions, 17 seulement
arrivèrent à destination, à Roubaix, le 1er
mai. Les autres étaient décédés ou avaient
dû être hospitalisés en cours de route.
Je n'oublierai jamais la réception qui nous
fut faite en gare de Roubaix. Rien n'avait été négligé.
C'était enfin la France, la douce France
qui nous accueillait. En gare d'Épernay, ce fut également
un accueil des plus enthousiastes, de mes confrères, de mes
élèves, de mes amis.
Je fus particulièrement heureux de retrouver
M. Pierre Servagnat qui, à Épernay et dans la Région,
fut le premier artisan, la cheville ouvrière de la Résistance.
Très activement recherché par la Gestapo, il sut toujours
s'échapper et parfois de justesse.
Une ombre à notre rencontre, l'absence de
sa chère compagne prise en otage lors de la fuite de son mari
qu'elle avait tant secondé dans son œuvre de Résistance,
et déportée au Camp de Ravensbrück en compagnie
de Mlle Denise Carroy et de Mme Joly, où elles subirent toutes
les tortures inventées par les brutes nazies, car il n'y avait
pour ainsi dire pas de différence de traitement entre les camps
de femmes et d'hommes.
Quelques mois se sont écoulés, et
parmi les souvenirs de ce que j'ai vu et vécu durant mes 16
mois de captivité, le plus précis, et aussi le plus
réconfortant, est celui de l'attitude des détenus français
devant les boches : leur fierté irréductible, le triomphe
tranquille de l'esprit de justice sur la force brutale.
Je pense à tous nos morts qui n'ont jamais
laissé percer ni un mot d'amertume, ni un regret pour l'action
patriotique qui leur avait coûté si cher.
Pensons à eux et inspirons-nous de leur sacrifice.
C'est à nous les survivants qu'il incombe de continuer leur
tâche, dans le même esprit et avec la même fermeté.
Il faut refaire la nouvelle France... et empêcher l'Allemagne
de réaliser par la violence son éternel rêve de
domination.
Il ne convient pas à un religieux de parler
de haine, mais il a le droit et ici, le devoir, de parler de justice.
Pardonner à ses propres bourreaux, c'est atteindre une suprême
grandeur, mais peut-on pardonner aux bourreaux des milliers de camarades
restés là-bas, sans renier cette justice elle-même
?
Français,
soyez vigilants et n'oubliez jamais !

Le
Square Frère Birin à Épernay en 2006



|