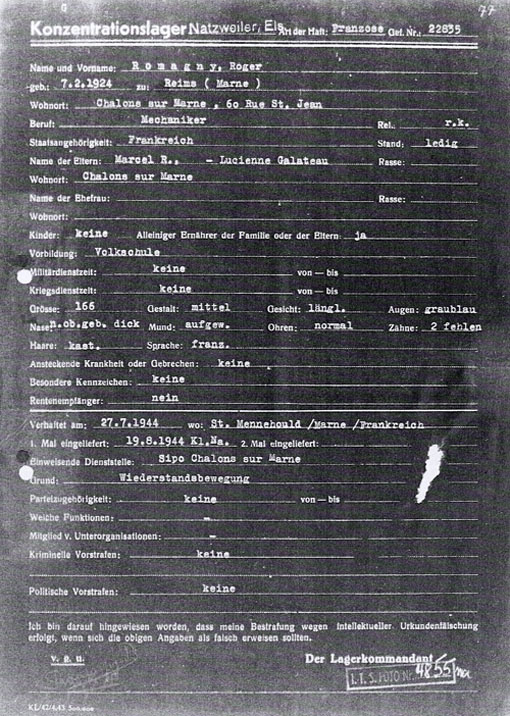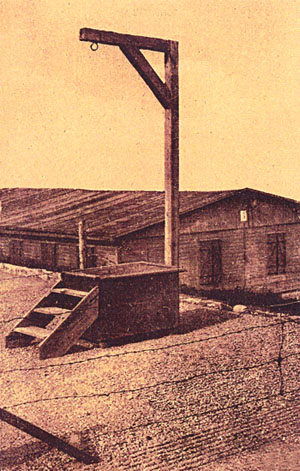Roger BOULANGER
|
En
mai 1943, Roger BOULANGER,
âgé de 17 ans, résidant à
Forbach en Moselle, un des trois
départements français annexés dès
1940 par l'Allemagne nazie, a refusé d'être
incorporé dans la Wehrmacht sous l'uniforme allemand.
Interné à la prison
de Sarreguemines, il a été
déporté au camp de Natzweiler-Struthof,
puis transféré en Allemagne en
janvier 1944, dans le Kommando de
Johanngeorgenstadt dépendant du camp de Flossenbürg.
En avril 1945,
il a survécu à l'évacuation des camps
qui a précédé l'arrivée des alliés
et à ce qu'on a appelé « les
marches de la mort » en parvenant à s'évader.
De retour en France, il s'est enfermé
comme la plupart de ses camarades déportés, dans
un long et profond silence correspondant à ce qu'on a
appelé le syndrome du survivant : souvenir angoissé
des camarades qui n'ont pas survécu à la déportation,
sentiment de culpabilité du déporté rescapé,
prise de conscience de l'indécence qu'il peut y avoir
à parler au nom des camarades morts dans les camps, impossibilité
de transmettre l'indicible, refoulement dans le contexte
du retour à la normale d'après-guerre.
Après une période
de deuil qui a duré quarante ans, Roger
BOULANGER a décidé de confronter ses souvenirs
de déporté aux travaux des historiens. Il a entrepris
lui-même des recherches dans les archives allemandes.
Puis il est allé à la rencontre
des élèves des collèges et des lycées
de Reims, ville où il a été professeur
d'allemand durant de nombreuses années. Depuis, il ne
cesse de témoigner et de dialoguer avec les jeunes, à
l'occasion de la préparation au Concours de la résistance
et de la déportation, ou lors des nombreuses
visites au Camp-mémorial du Struthof qu'il accompagne
régulièrement.
Son
témoignage est extrait d'un livre-témoignage qui
répond aux questions posées par les jeunes d'aujourd'hui,
des jeunes auxquels il adresse un appel
à la vigilance dans un monde toujours exposé
aux menaces du totalitarisme, du racisme, de l'antisémitisme.
Roger
BOULANGER, La déportation
racontée à des jeunes - Parole et témoignage
d'un ancien déporté, Histoire en mémoire
1939-1945, Scérén - CRDP de Champagne-Ardenne,
2003. |

Roger
Boulanger au milieu d'un groupe d'élèves du lycée
Clemenceau de Reims qu'il accompagnait
lors de la visite de l'ancien
camp de Natzweiler-Struthof
en avril 2004
Ce
fut l'arrivée en gare de
Rothau, en Alsace. Hurlements,
aboiements, vociférations sur le quai ! Le fourgon cellulaire
s'ouvre, nous sommes tous expulsés à coups de gourdin.
60 hommes ankylosés courent entre une haie de chiens furieux,
hurlant à la mort et tenus en laisse par des hommes en uniforme,
s'engouffrent dans un camion cellulaire sous les coups redoublés,
s'y entassent à s'étouffer. Quelques-uns restent sur
le quai. Suit un lourd silence, rompu subitement par les aboiements
féroces des chiens et d'atroces cris de douleur
: les SS avaient lâché les chiens. Les derniers d'entre
nous, horriblement mordus, se hissent sur nos têtes et, à
l'horizontale, nous écrasant de leur poids, ils effectuent
la montée aux enfers.
Elle
parut interminable. Cahotés, écrasés, bringuebalés,
à moitié asphyxiés, nous suivîmes la sinistre
route de montagne qui menait au camp de concentration de Natzweiler-Struthof.
Déchargés
devant le portail comme du bétail,
sous les insultes et les coups des SS et de ceux qui se révélèrent
être les kapos, 60 « nouveaux » franchirent la porte
grillagée du camp. Lorsqu'elle se referma, je réalisai
qu'à l'incertitude du lendemain venait de s'ajouter un deuxième
volet : la terreur, avec son cortège
de violences, verbales et physiques.
À
partir
de là, la dépersonnalisation
s'accéléra : tout signe extérieur,
symbole de statut social ou de vie individuelle, fut éliminé.
Dépouillés de nos vêtements, de nos cheveux, de
nos poils, nous n'étions plus que des
corps nus, apparemment sans âme ni personnalité,
que le système se promettait d'uniformiser et de façonner
à sa guise, sans susciter de velléité de révolte.
L'objectif des nazis était de
briser en nous toute volonté d'autonomie, de nous
réduire à des automates,
à une main-d'œuvre malléable, taillable et corvéable
à merci, destinée à l'industrie de guerre.
L'exploitation intensive
de la main-d'œuvre concentrationnaire était
un objectif annoncé par Speer en 1942.
Elle fut précédée dans les camps d'une mise
en condition confiée à la SS qui avait affiné
ses méthodes pour dégrader l'homme
: elle savait terroriser, insécuriser, affamer.
Dès les premiers jours, dans le baraquement réservé
à la quarantaine, j'assistai, impuissant et horrifié,
à un violent passage à tabac
d'un jeune Italien par les kapos. Il s'était rebiffé
sous une insulte. Aucun d'entre nous n'était intervenu pour
le défendre.
Quelque temps plus tard, ce fut la bastonnade
publique d'un évadé repris. Attaché sur un chevalet,
il reçut devant tous les déportés rassemblés
sur les places d'appel un nombre impressionnant de coups
de bâton. Comme le détenu chargé de
lui administrer la schlague ne frappait pas avec assez de conviction,
il fut à son tour étendu sur le chevalet et cinglé
de coups par les chefs SS présents. Il frappa ensuite le malheureux
avec violence. Chaque coup me déchirait le cœur.
Je ne distinguais plus la limite entre la terreur
physique, que ma volonté pouvait contrôler, et la terreur
mentale, face à laquelle j'étais désarmé.
Je découvrais avec effroi la complicité concrète,
consciente ou inconsciente, entre les bourreaux et les victimes. Je
sentais ma dimension humaine fondre et se réduire,
je ne vivais plus.
Pour la première fois, j'eus l'impression
d'un sursis, un sursis qui me serait accordé si j'acceptais
la soumission, si j'abandonnais mon autonomie, si j'abdiquais
ma qualité d'homme. J'éprouvais ce
sentiment diffus de honte
des enfants et des femmes battus, qui reviennent vers leur tortionnaire,
espérant qu'il a changé entre-temps.
Le mois de décembre
1943 me mit au contact de la mort.
Trois camarades, lorrains ou alsaciens, voisins de table et de châlit
furent fusillés dans la sablière. Pourquoi eux ? était-ce
le début d'une série d'exécutions ? Puis vint
Noël. Le commandant du camp rassembla toute la population concentrationnaire
face à une potence, installée
sur la première plate-forme d'appel, fit pendre un jeune Russe
et lança son célèbre : «
C'est ainsi que je vous pendrai tous ! ».
La terreur nous rendait muets,
l'ignorance du lendemain, qui engendrait l'insécurité
et nous déstabilisait, entrait dans la stratégie du
secret. À l'extérieur, on ne connaissait pas les conditions
de vie dans les camps de concentration. Les déportés
eux-mêmes ignoraient ce qui se déroulait dans leur environnement
immédiat.
Une des méthodes concentrationnaires, fidèle
en cela au machiavélique « diviser pour régner
», consistait à parcelliser les tâches pour
isoler les détenus et garantir le secret. Par exemple,
nous effectuions le transport de corps de l'extérieur du camp
jusqu'au bâtiment surmonté par la haute cheminée
du crématoire. Plusieurs
équipes en étaient chargées sur différentes
fractions du trajet, avec interdiction de regarder dans les civières
et de communiquer avec l'équipe suivante. Je ne sais pas si
ce fut le poids des civières ou celui du mystère qui
me fit paraître si longue la descente jusqu'au crématoire.
L'attente et l'incertitude
remplissaient nos journées. Les épuisantes
et abominables stations sur les places d'appel,
où nous piétinions dans nos sabots, grelottant de froid
et de faiblesse dans le brouillard hivernal des Vosges, duraient parfois
du lever du jour jusqu'à midi, car il n'était pas question
de laisser sortir du camp une équipe de travail avant dissipation
du brouillard.
L'ignorance de notre destin était
la règle. Il est vrai que notre désir et
nos possibilités de savoir, de comprendre, de percer les secrets
du système concentrationnaire étaient singulièrement
amoindris par le climat général de tension que nous
subissions pour éviter les coups et les blessures
que nos corps affaiblis par la dénutrition
n'auraient pu supporter. obsessionnelle à force d'être
lancinante, mordante, inlassable. La nuit, la douleur recroquevillait
mon corps ; bien que couché en chien de fusil pour contenir
les contractions de mon estomac, je me réveillais, irrémédiablement
tenaillé par la faim. Le
jour, les maigres rations alimentaires dispensées ne compensaient
pas les pertes de calories provoquées par un travail
harassant dans le froid.
J'avais été affecté au kommando
chargé d'aménager la route menant du camp à la
carrière où la SS installait une usine d'armement. C'était
un véritable travail de bagnard.
Construire des routes, alors que sable et pierres étaient gelés,
creuser des trous dans le rocher ou la terre gelée pour y planter
des poteaux électriques, transporter tout et rien, s'affairer
ou en donner l'impression pour éviter les
coups de pioche et de pied des kapos ou les
morsures des chiens de la garde SS : c'était là
notre lot quotidien. Ces activités menées à un
train d'enfer, sans aucun souci de rentabilité, visaient
uniquement notre épuisement physique. Il s'agissait
de sélectionner, par élimination physique, ceux qui
seraient dirigés vers la production industrielle de guerre.
Certains d'entre nous, épuisés, blessés,
malades, furent admis à l'infirmerie,
puis au baraquement où, dispensé de travail, le déporté
reprenait quelques forces avant de replonger dans le cercle infernal,
ou bien dépérissait. La maladie et les blessures graves
m'avaient épargné, la dénutrition et la fatigue
m'avaient diminué, mais non éliminé. J'étais
devenu cette chose - Stück
dans le jargon concentrationnaire - que l'enfer sécrétait,
un homme dégradé, humilié,
avili qu'allait absorber l'industrie de guerre. Nous étions,
loques humaines, à mi-chemin
entre l'extermination idéologique et l'exploitation économique.
Le Struthof avait rempli son rôle d'intermédiaire, de
centre de tri : il avait sacrifié
sur l'autel du crime, il avait sélectionné et éliminé,
il livrait à la production de guerre une main d'œuvre
conditionnée dans les délais les plus brefs : moins
de trois mois.
À la
fin du mois de janvier 1944,
je fis partie d'un de ces nombreux transports
vers des camps de concentration situés à l'intérieur
de l'Allemagne.
L'isolement que j'avais
vécu en prison avait été atténué
par un sentiment de sécurité que dégageaient
les murs massifs. L'enceinte infranchissable de barbelés
électriques du Struthof, avec ses miradors
équipés de mitrailleuses, coupait du monde de façon
totale et catégorique.
Les êtres hâves et
déguenillés du Struthof, dont certains avaient
basculé dans une grande misère physiologique, faisaient
partie d'un univers qui n'avait plus rien
de commun avec le monde des vivants.
Dépouillés de leur dignité humaine,
ayant perdu la considération d'autrui et l'estime de soi-même,
humiliés et offensés, les hommes souffraient, seuls
et en silence, dans un monde déshumanisé.
Les grandes humiliations, comme les profondes douleurs, se vivent
en solitaires.
Privés d'informations sur le monde en guerre,
sur nos familles, nos compagnons de lutte,
nous perdions la notion exacte du temps. J'ai longtemps
cru avoir passé six longs mois au Struthof. En fait, en consultant,
40 ans après la guerre, les registres d'entrées et de
sorties du camp, je découvris l'élasticité toute
subjective de nos unités de mesure.
Il est nécessaire de faire
la différence entre isolement et solitude : je souffrais,
certes, d'un sentiment d'abandon, mais aussi de l'impossibilité
de m'isoler, d'être seul avec moi-même. Uniformisés,
sans le moindre attribut personnel, interdits
d'intimité, il nous fallut nous habituer aux latrines
collectives, à la saleté commune, à la suffocante
promiscuité des châlits surpeuplés, à l'agressive
présence de l'autre, qui vous dérobait et auquel nous
dérobions l'air, l'espace, le sommeil, tout. Être seul,
se recueillir, évoquer le passé, bâtir l'avenir,
penser aux autres, était impossible, de jour comme de nuit.
Harcelés sans relâche sur les chantiers, réveillés
la nuit pour des appels, aussi inutiles qu'épuisants. Nous
étions en perpétuel contact ou conflit avec des codétenus
dont nous ne partagions pas les valeurs, tels ce condamné de
droit commun au triangle vert, ce proxénète au triangle
noir.
Quelle joie lorsqu'au Struthof,
en plein mois de janvier 1944, le ciel se déchirait
et que le soleil d'hiver inondait nos misérables
visages ! ce même soleil qui perçait les nuages
au-dessus du village ou de la ville de nos proches, de nos amis.
Et lorsqu'on avait la chance de faire équipe, dans
le kommando de travail, avec un camarade qui parlait le même
langage et avec qui on pouvait partager pensées et sentiments,
alors, la joie de vivre l'emportait.
C'était une victoire sur l'adversité. Je me souviens
de ce moment - j'en aurais voulu suspendre le vol - où, cachés
dans le trou que nous venions de creuser pour un poteau électrique,
couverts de neige et de boue, à l'abri de la hargne des kapos
et des chiens, un ami, sidérurgiste lorrain, démocrate
convaincu, m'initia à la réflexion politique.
La souffrance physique est supportable jusqu'à
un certain degré lorsqu'elle vous concerne ; assister à
celle d'un ami ou d'un être cher, sans pouvoir lui porter secours,
est terriblement destructeur. Vivre
la proximité permanente de la mort ébranle les plus
solides, entame l'espoir de vivre, fait croire à
l'inexorabilité d'une issue fatale. Pendre, exécuter
par fusillade, battre à mort, gazer, laisser mourir de maladie
ou d'inanition et de faim... c'est donner à la mort une actualité
omniprésente.
Tout était fondé
sur l'humiliation et la frustration. L'humiliation première,
la plus simple, était de nous mettre nus. Dans
les années 1940, la pudeur était grande.
Défiler nus devant les SS et les kapos, dans les locaux attenant
au crématoire, dès notre arrivée, était
ressenti comme une dégradation
; l'humiliation était plus vive que celle provoquée
par les insultes et les quolibets. Simone
VEIL, rescapée des camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen,
parle souvent de cette humiliation
dont les femmes déportées ont beaucoup souffert. à
cette humiliation ponctuelle, il faut ajouter la mortification
permanente, qui consistait à nous faire manger comme
des animaux et laper notre maigre pitance, à nous faire perdre
notre qualité d'homme.
Tout
travail, stupide et inutile, est humiliant. Monter à
dos d'homme de lourdes pierres jusqu'en haut d'un talus, pour les
redescendre de la même manière, fut l'exercice typique
en usage dans tous les camps.
Le jargon concentrationnaire utilisait le terme de musulman
pour désigner le détenu que les humiliations et les
privations avaient réduit à un
comportement apathique et résigné, proche de la mort.
Très affaibli dans un corps décharné, les yeux
vides, le regard incertain, la démarche mal assurée,
une couverture sur les épaules, il déambulait dans le
camp, frôlait les enceintes électrifiées. Même
les gardes SS sur les miradors ne tiraient pas sur lui. Il représentait
l'homme vaincu par les frustrations physiques, affectives et mentales.
Il avait perdu la combativité naturelle, il était tombé
dans une atonie sans issue, il n'avait plus d'autonomie. C'était
comme si son incapacité à réagir provenait d'une
blessure qui ne guérissait pas, d'une envie de s'arrêter
là, du désir inavoué
de mourir... Il était fatigué de lutter pour
satisfaire les besoins élémentaires de survie, las de
voler, d'affronter l'autre, de composer. S'adapter à une vie
relationnelle, où l'agressivité était poussée
à l'extrême, dépassait ses forces. Il n'éprouvait
plus ni haine, ni jalousie, il ne cherchait plus de responsables à
son état, plus de boucs émissaires à son malheur,
il ne comptait plus sur la solidarité.
Et nous le regardions, ce musulman. Nous ne volions pas
à son secours. Vide affectif, perte de toute sensibilité,
peur de sa propre image, autodéfense ?
Il n'y avait plus de place pour la pitié. C'était
le chacun pour soi, le rejet de l'autre. Notre dérive était
sans bornes. Les trous, où se blotissaient les hommes dans
la terre gelée, n'étaient que brèves et illusoires
échappées.
Primo
LEVI a parlé en poète de la souffrance de
l'homme, de ses lâchetés silencieuses, mais aussi de
son héroïsme banal.
La vie dans les camps était une juxtaposition d'actes de barbarie,
de brutalités, d'avilissement et de gestes d'amitié,
d'abnégation. Le Révérend
Père RIQUET raconta dans ses écrits l'inoubliable
prière à laquelle il invita 126 hommes nus,
dans un wagon à bestiaux où l'on mourait de faim et
de soif, où l'on ne pouvait ni se coucher ni même s'asseoir.
On imagine difficilement ce que peut représenter, pour un être
affamé, cette cuillerée de rutabaga qu'il prélève
dans sa gamelle pour un camarade plus éprouvé.
Un geste d'entraide devait en outre rester discret. Je
me souviens de ce nouveau venu au Struthof qui, après la sienne,
poussa la lourde brouette d'un prêtre belge, âgé
et usé par la détention. Ils furent nombreux à
lui conseiller d'éviter des manifestations de solidarité
de ce genre, de ne pas donner sans recevoir. Être traité
comme des bêtes mais ne pas se comporter comme telles : c'est
banal et héroïque.

Lucien HESS
|
Le
témoignage de Lucien HESS,
rédigé dès son retour de déportation,
est extrait du " Rapport sur
les travaux de l'année 1944-1945 de l'Académie
nationale de Reims " présenté
par
son secrétaire général,
René DRUART : « Monsieur
le Chanoine Hess a rédigé à votre intention
un mémoire de ses interrogatoires entrecoupés
des plus odieux sévices à la Kommandantur
de
Reims [ en réalité au siège
de la Gestapo, rue Jeanne d'Arc ] ,
puis de ce qu'il a non seulement enduré, mais vu aussi,
au camp de Natzwiler [ nom
alsacien de la commune où avait été implanté
par les nazis le camp de Natzweiler-Struthof ] ,
surnommé " l'enfer d'Alsace ", puis à
Dachau. Il nous est revenu avec un moral admirable, considérant
que seule une grâce divine l'avait arraché aux
cents périls de la mort ». |

Le
retour à Reims de
Lucien Hess, le 14 mai 1945
Le
rapport qui va suivre ne veut être que l'exposé
de faits vécus, dont je garantis l'authenticité
Le
camp de Natzviller
Le
camp de Natzviller, surnommé « l'Enfer
de l'Alsace » est situé au sommet d'un vallon
dans le déroulement d'un panorama splendide. Le camp est construit
en amphithéâtre avec une série de plate formes
reliées par des escaliers. Les baraques sont séparées
par des plans inclinés de gazon. Aspect artistique qui contraste
hypocritement avec la vie misérable des détenus. Le
car y parvient non sans difficultés.
Aussitôt l'entrée franchie, les cris
et les coups de pied des gardiens SS nous firent pressentir la sévérité
de la discipline. L'un deux devait frapper à coups
de crosse Monseigneur Piguet, évêque
de Clermont-Ferrand, qui arriva quelques jours plus tard.
Conduits sur une large place où étaient
différents bureaux d'inscriptions, nous
devons nous dépouiller entièrement de nos vêtements
et, dans cette complète nudité, passer devant différentes
tables pour décliner notre identité, déclarer
ce que nous possédons de précieux, voir nos biens mis
dans des sacs portant sur une étiquette
le numéro matricule qu'on nous donne ; un coup de
pied envoie rouler mon autel portatif et mes livres de piété
traités de « Choses du diable ».
Je
reçois le n° 22 808. À partir de
ce moment, nous ne sommes plus pour nos gardiens
des personnes humaines mais des êtres quelconques numérotés,
qui ne sont qu'une charge et un objet de rebut. Toujours
nus, nous sommes complètement rasés,
opération humiliante faite en public, sans le moindre ménagement
de pudeur. On nous rase sans doute par crainte de la vermine. On nous
fait passer aux douches. J'y rencontre un rémois,
M. Godbert, directeur du Pari Mutuel, dont le dos était
labouré de raies violettes, témoins d'une flagellation
subie l'avant-veille. Puis on nous donne une chemise,
le pyjama rayé accompagné d'une calotte ;
aux pieds nous aurons les fameuses claquettes
si peu pratiques pour gravir et descendre les nombreux escaliers du
camp que je préférais aller pieds nus.
Je suis affecté au bloc ou baraque 14. Chaque
bloc comprend plusieurs chambrées. Celles-ci se composent de
4 pièces, le dortoir, le réfectoire, le lavabo, les
cabinets, en tout, dans le bloc, environ 700 détenus de toutes
les régions de France - et puis des Russes, Polonais, Juifs,
etc. La majeure partie sont des membres de
la Résistance, des terroristes, des otages pris
en groupe dans les villages où le maquis a agi. Ainsi, venant
de Clermont-en-Argonne, le curé et 102 hommes.
La vie commune efface toutes
les différences sociales, classes, rangs, fonctions,
fortune. Nous côtoyons des généraux, des Préfets,
des banquiers, des chefs d'entreprise, des ouvriers, porteurs des
mêmes pyjamas, soumis au même régime. Celui-ci
comporte chaque jour 3 appels :
le matin à 5 heures, à midi, le soir, où tous
doivent être présents, immobiles,
tête découverte par tous les temps. Il y eut
parfois des pluies battantes. Le matin à 5 heures, à
750 mètres d'altitude, la température était très
fraîche. À midi, il arriva que le soleil brûlait,
et il n'y avait dans le camp ni ombre ni arbre. Ces
appels duraient au moins une demi-heure, plus si quelqu'un
manquait et qu'il fallait toujours trouver et amener.
Le
travail auquel je fus soumis consistait à porter
des pierres et des plaques de gazon pour construire des
fortins de défense contre l'arrivée possible des armées
alliées. Ce travail était rendu plus pénible
par la difficulté de la marche avec les claquettes ou pieds-nus.
Malade, je ne pus le continuer.
La
nourriture consistait en un peu de café
le matin, à midi un litre d'une soupe
indéfinissable accompagnée parfois de choucroute
crue, le soir un morceau de pain
avec de la margarine, parfois une
cuillerée de confiture.
Plus
de colis. Plus de nouvelles non plus, il fallait sans cesse
( ce me fut une souffrance très sensible au début )
entendre la hiérarchie du camp employer
la langue allemande. Il fallait comprendre sous peine de
bourrade. Enfin, pour moi, l'épreuve la plus grande fut la
privation de tout secours religieux, sauf les conversations
que je pouvais avoir avec les confrères. De plus, le spectacle
hallucinant de cette vie misérable. Du bloc, nous
voyions sans cesse descendre vers le four crématoire,
situé à l'extrémité inférieure
du camp, les civières soutenant les
cadavres des détenus morts pendant la nuit. Au début
de mon séjour, le four ne fonctionnait pas régulièrement,
mais au fur et à mesure de l'avance alliée, nous
vîmes des camions d'hommes et de femmes descendre le camp, depuis
la porte du sommet jusqu'à la sinistre baraque, et remonter
vides. Nous comprenions que ces malheureux étaient
pendus d'abord, dans une chambre mitoyenne au four, puis immédiatement
incinérés, comme en témoignait une fumée
plus épaisse. Le four fonctionna bientôt jour et nuit
et les flammes dépassaient la cheminée de 30 ou 40 centimètres.
Le
départ
La progression alliée inquiétait visiblement
les SS. Dans la nuit du 1er au 2 septembre,
il y eu un rassemblement général, une
descente en colonne vers la gare de Rothau. Mais à
mi-route, contre-ordre, retour au camp : réintégration
des blocs. Des nouvelles circulent, déformées par nos
imaginations avides. Nous nous figurons le départ impossible.
N'allons-nous pas être délivrés ?
Mais,
dans la nuit du 3 au 4 septembre,
nouveau rassemblement, nouveau départ. Nous allons cette fois-ci
jusqu'à la gare de Rothau et, dans la plus grande déception,
nous sommes embarqués dans des wagons
à bestiaux, par groupes de 45 à 50. Le train
s'ébranle et nous emmène vers
Strasbourg. C'est une nouvelle déception, d'y parvenir.
Nous croyions la ville entre les mains françaises, or la gare
est paisible, peu atteinte en ses bâtiments principaux. Les
nouvelles qui circulaient parmi nous étaient donc fausses.

Roger ROMAGNY
Né
à Reims en 1924, Roger
ROMAGNY appartenait au Groupe Melpomène.
Il a été arrêté à
Braux Saint Remy le
25 juillet 1944 par la police allemande, interné
à la prison de Châlons sur Marne,
déporté au camp de Natzweiller-Struthof,
le 19 août, puis transféré
à Dachau en
septembre 1944.
Son témoignage est extrait d'une autobiographie
dactylographiée, Ma Jeunesse,
rédigée au début des années 2000. |

Roger Romagny, au premier plan sur la moto,
photographié dans le maquis au sein du groupe Melpomène
À l'arrière plan, debout dans la voiture, Jacques Degrancourt

Roger
Romagny photographié à Châlons
quelques mois après son retour de déportation
Le
19 août 1944, après vingt-cinq jours dans
cette prison, nous sommes embarqués
dans deux cars (les noms figurent sur les pages suivantes).
L'escorte est impressionnante. Nous partons
en direction de l'Allemagne. Malgré tout ce que
nous venons de subir et malgré l'incertitude de notre sort,
ce sont les retrouvailles entre copains de maquis. Jacques
Degrancourt est dans un sale état.
En tant que chef de groupe, les Allemands l'ont torturé pour
le faire parler. Il a subi de nombreuses bastonnades. Puis, je découvre
dans des états plus ou moins bons, Jacques
Songy, Dédé,
André Ponce de
Léon, Formez,
Moulin, Mouton,
etc. Il y a également de nombreux prisonniers de la prison
de Reims, Goulard, l'abbé
Hess, Lundy, Lesieur…
Avant le départ, j'arrive à faire
passer à mes parents un petit mot par la vitre. J'ai su à
mon retour que le mot leur était bien parvenu.
Nous passons la frontière allemande à
Donon. Mes menottes sont enlevées
. Ouf ! Quel soulagement. Mes poignets sont bien entaillés,
les chairs sont à vif et mettront longtemps à guérir.
Nous poursuivons notre route jusqu'à la destination
finale, le camp de concentration du Struthof.

L'enceinte du camp
Nous
descendons des cars et dès que nous franchissons l'entrée,
nous sommes stupéfaits du spectacle
de désolation qui s'offre à nous. Il règne
une ambiance bizarre, un silence pesant a envahi les lieux, nous devinons
que la misère et la mort
sont le quotidien des gens qui sont enfermés ici. Effectivement,
nous apercevons quelques prisonniers dans leur costume rayé.
Ils sont dans un état pitoyable, ils sont maigres,
faméliques, la peur et
la détresse se lisent dans leurs yeux. Ils nous regardent comme
si nous étions des bêtes curieuses. Les premiers instants
de stupeur passés, nous comprenons rapidement ce qui nous attend.
Nous sommes conduits dans le bloc en bas à droite. Les ordres
arrivent « tous à poil ».
Puis, c'est l'immatriculation.
Je porte le n° 22835. Ensuite,
debout sur un tabouret, c'est le rasage complet,
puis la douche et la distribution
de vêtements rayés.
Une foi tous ces « formalités » faites, nous
nous dirigeons vers le bloc de vie concentrationnaire.
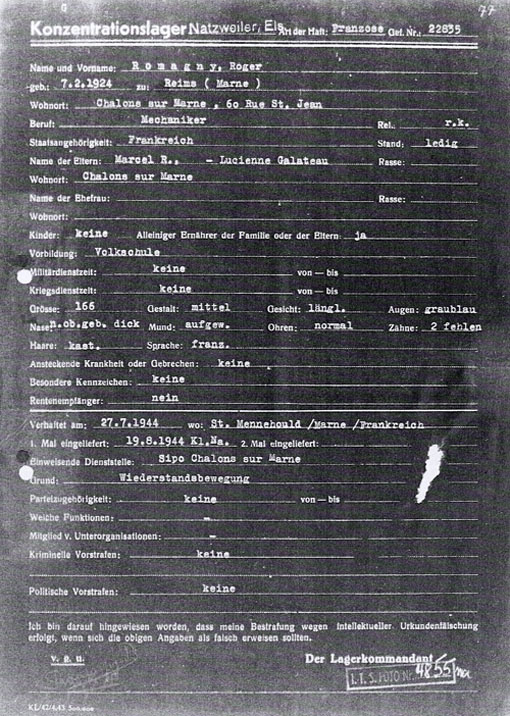
Les
jours passent, il faut se plier à la discipline
de fer qui règne à l'intérieur du
camp. Le seul moment de répit de la journée est la distribution
de la soupe. Cela nous permet d'absorber
un bol d'eau tiède et trouble. Il faut veiller à se
faire tondre les cheveux à ras, en permanence, sinon pas de
soupe ! Le soir, c'est l'épouillage,
à tour de rôle nous cherchons les poux sur les têtes
de nos voisins.
Ces conditions de vie sont très pénibles,
nous nous posons la question de savoir où tout cela va finir,
jusqu'où tout cela va nous emmener.
Pour
se rassurer ou pour faire semblant de se rassurer, pour surmonter
sa peur et ses craintes, chacun essaye de
se raccrocher à cet invisible et si fragile petit lien qui
relie encore à ces images de notre vie, de cette
vie que nous vivions il n'y a pas si longtemps, quand nous étions
encore près de nos familles et de nos proches. Le simple fait
d'y penser nous met énormément de baume au cœur,
nous nous imprégnons de ces images, de ce bonheur et à
chaque fois, nous sentons monter en nous une extraordinaire bouffée
de chaleur et de bien-être. C'est aussi pour cela qu'entre déportés,
nous aimons savoir d'où vient l'autre, comme si le fait de
retrouver quelqu'un de sa région pouvait nous rassurer en se
disant « je ne suis pas seul dans
cet enfer », comme si le fait de partager toutes
ces souffrances avec une personne avec laquelle il y aurait plus d'affinités
du fait de notre provenance commune, pouvait diviser par deux toutes
ces souffrances. Par le plus grand des hasards, je rencontre un autre
Châlonnais avec lequel nous nous racontons mutuellement en quelques
mots, notre parcours pour finir dans ce camp. Dans la conversation,
je lui dis que je m'appelle Roger Romagny…
Et après quelques instants de réflexion, il me dit qu'il
a connu un Romagny emprisonné
à la prison de Châlons sur Marne.
Il me décrit physiquement son compagnon de cellule… Il
n'y a pas de doute, grâce aux détails qu'il me donne,
je suis persuadé qu'il s'agit bien de mon frère Pierre.
Je suis très inquiet pour lui ! Il faisait partie du maquis
de l'Argonne qu'il avait rejoint pour ne pas partir au
STO. Je pense qu'il a dû être arrêté comme
beaucoup de résistants et je me fais beaucoup de souci pour
lui. Je suis très inquiet à son sujet et j'espère
pour lui qu'il n'a pas eu à subir le même sort que moi.
Les souffrances que j'endure, je ne veux en aucun cas qu'elles soient
partagées avec mon cher frère. Mais cette question me
tourmente et me revient sans cesse à l'esprit « qu'est-il
devenu ? ». Je pense aussi à mes chers parents.
Vont-ils perdre deux de leurs enfants dans cette tourmente, dans cette
tragédie de la Seconde Guerre mondiale ?

Vue générale du camp
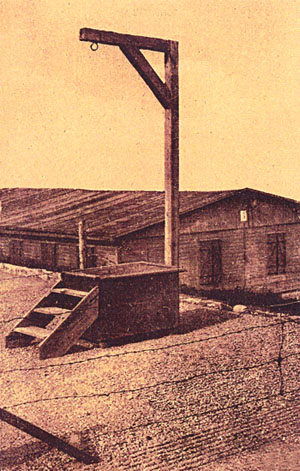
La potence
Notre
moral baisse de jour en jour, même pour les plus
forts d'entre nous. Nous sommes conscients que nous n'avons qu'une
seule issue, c'est de finir comme tous ces pauvres types autour de
nous, malades, affamés souffrant de détresse psychologique
et physique. Au bout de cette vie dans ce camp, il n'y a qu'une chose
qui nous attend à notre tour : la mort
pour nous aussi.
En
attendant, il faut tenir, une lueur
d'espoir anime quelques-uns d'entre nous, mais comment espérer
alors que nous n'avons même pas le minimum vital. Nous mangeons
très peu et nous crevons de faim.
J'ai même vu des prisonniers qui ramassaient des miettes de
pain avec une aiguille. D'autres sont maltraités, les coups
de crosse tombent pour un oui ou pour un non. Le Kapos sont brutaux,
ils font régner un véritable climat
de terreur.
Tout est bon pour humilier
les prisonniers et s'adonner à des pratiques barbares.
Pour un bout de pain qu'il a volé, ce malheureux subit une
punition qui doit servir à donner l'exemple. Il est debout
et tient à bout de bras un tabouret sur lequel a été
mis un morceau de pain. Le pauvre gars qui est déjà
bien affaibli fatigue rapidement mais dès que son bras commence
à baisser, un Kapo, qui se tient derrière lui, lui administre
des coups de bâton. Cela dure jusqu'à ce que ce prisonnier
meure d'épuisement et de coups. La vue de cette scène
est atroce à supporter.
L'apprentissage
de notre nouvelle vie de prisonniers se déroule ainsi, entre
brutalité, misère, discipline de fer et détresse.
Nous sommes à peu près certains que nous ne sortirons
jamais de cet enfer. Notre quotidien est rythmé par des obligations
toujours plus humiliantes, nous ne sommes plus qu'un troupeau
humain, nous avons perdu notre dignité d'homme.
Pendant des heures, nos gardiens nous obligent à rester debout,
en rang, sans bouger. Ils font l'appel plusieurs
fois de suite, leur seul but est de nous
briser physiquement et moralement ! Tout est fait pour
que chacun perde son identité, les latrines sont communes,
il n'est pas question d'intimité. Les quelques moments de répit
sont les promenades dans l'enceinte du camp. Mais gare à celui
qui n'enlève pas son calot au passage d'un SS… C'est la
schlague assurée !
Heureusement qu'il y a les
anciens pour nous réconforter et nous remonter le moral.
Ils subissent pourtant la même dureté que nous dans leurs
conditions de vie, mais ils se sont habitués ( si on peut s'habituer
) à ces conditions difficiles.
La
vue du crématoire n'est
pas là pour nous rassurer. Le four crématoire est en
dessous de notre bloc. Il brûle sans
arrêt, une fumée noirâtre et odorante
se dégage en permanence de la cheminée.
Plus loin, c'est la prison,
elle est isolée du camp. Des types sont derrière les
barbelés. Ils sont dans un état indescriptible, ils
sont si squelettiques que l'on
pourrait presque voir à travers leurs corps décharnés.
Ils font peur à voir, leurs yeux ressemblent à des orbites
sombres, vides de toute étincelle d'existence et on se demande
comment ils peuvent encore tenir debout ? La plupart d'entre eux sont
atteints du typhus. En les voyant
errer ainsi, ils nous font penser à des morts-vivants.
Effectivement, ces pauvres prisonniers n'attendent qu'une chose :
la mort qui les délivrerait de tant de souffrances… !

Le crématoire
et sa cheminée
Heureusement que nous avons
un véritable rayon de soleil en la personne d'un dénommé
Coquart, originaire de Reims. Il
arrive toujours à glaner, par-ci ou par-là, des nouvelles
extraordinaires. Nous savons par exemple que l'armée américaine
progresse rapidement. Effectivement, nous observons que les Allemands
sont nerveux depuis quelques temps. Ils assistent à la déroute
de leur armée qui est défaite sur tous les fronts. Nous
n'en sommes pas plus rassurés car nous
nous demandons ce qu'ils vont faire de nous. Comment cela
va-t-il se passer pour nous devant l'inexorable avancée des
Américains ? Nous sommes partagés entre l'espoir d'une
libération et la crainte de représailles
de la part de nos gardiens en cas de fuite précipitée.
Nos craintes sont fondées, les soldats allemands activent leur
sale besogne. Dans la nuit du 1er au 2 septembre
1944, plusieurs camions chargés de résistants,
se dirigent vers le crématoire. Ces
résistants sont exécutés et brûlés.
Il en est ainsi toute la nuit. Nous ne pouvons que deviner le drame
qui se joue à quelques mètres de nous, mais nous assistons
à ce spectacle lugubre de cette cheminée qui n'en peut
plus de cracher cette âcre fumée noire. Le four crématoire
fonctionne tellement cette nuit là, que des flammes s'échappent
en même temps que la fumée de la cheminée ( le
groupe Alliance venait d'être
anéanti, soit 107 résistants
exécutés ). On se demande sincèrement
si on va se réveiller et sortir de ce cauchemar ou si ces atrocités
sont bien réelles et peuvent exister… ?
Le lendemain, l'ordre nous est donné de nous
rassembler et de prendre avec nous une boîte de conserves. À
pied, nous sommes emmenés vers la gare de Rothau,
distante de huit kilomètres. Nous sommes escortés par
des SS accompagnés de leurs chiens. En cours de route, les
plus faibles tombent à terre. Aussitôt, ils sont roués
de coups par les sentinelles et mordus par les chiens. Les pauvres
se relèvent tant bien que mal trouvant suffisamment d'énergie
pour échapper à ces traitements inhumains. À
notre arrivée à la gare, nous apprenons qu'il n'y a
pas de train. Nous refaisons le chemin inverse et retour au camp.
Dans les blocs, les rumeurs les plus folles circulent et se répandent
rapidement. Nous entendons dire que nous ne pourrons plus partir et
que notre sort en est jeté, notre destin va s'arrêter
entre ces barbelés. Mais vers 2 heures du matin, nouveau départ
pour la gare. Cette fois-ci le train est là. Nous montons dans
des wagons à bestiaux et dans chaque wagon, il doit y avoir
un maximum de prisonniers.
Nous
sommes serrés comme des harengs en boîte, les uns contre
les autres. Il est impossible de bouger ni même de s'asseoir.
Dans un coin du wagon, il y a les chiottes mais pour s'y rendre c'est
une véritable difficulté. Il
règne une chaleur suffocante, nous manquons d'air.
Les plus faibles, ceux qui ont du mal à rester debout sont
maintenus par leurs camarades d'infortune. De temps en temps, le train
s'arrête, les SS jettent un coup d'œil dans les wagons
et font une inspection rapide. Le convoi reprend sa route, le train
roule pendant des heures et des heures, des kilomètres et des
kilomètres. Nous n'avons ni à
boire, ni à manger. Où nous emmène
t-on ainsi ? Combien d'entre nous vont mourir de faim, de soif ou
d'épuisement pendant ce trajet ?
Le 3 septembre 1944, nous arrivons
à destination, le camp de concentration de Dachau.

Jacques SONGY
|
Né
le 12 juin 1924 à Châlons-sur-Marne,
Jacques SONGY était membre
du Groupe Melpomède.
Arrêté par la Gestapo à
Mairy-sur-Marne , il a été incarcéré
à Châlons-sur-Marne et déporté
en août
1944 à Natzweiler
sous le matricule 22837, puis transféré à
Dachau.
Le
témoignage de Jacques
SONGY est extrait de
Fortes Impressions de Dachau,
un livre-témoignage illustré
de dessins de
André BINOIS,
publié en 1946. |

Jacques
SONGY au pied du mémorial de Natzweiler-Struthof en 1999
Quelques
semaines après mon retour de Dachau, en
mai 1945, j'écrivais ces Fortes
impressions, publiées
en 1946, toutes fraîches et parfois naïves,
issues des souvenirs marquants de l'expérience vécue
de ma vingtième année.
C'était le regard étonné d'un
jeune homme, parmi tant d'autres, sur l'univers concentrationnaire.
Étonné, mais aussi rempli d'une fougueuse
indignation après le retour, parce qu'il lui semblait que personne
n'avait rien compris à la Résistance et à la
Déportation.

Dessin
de André Binois
Quelques
heures plus tard, une centaine d'hommes nus et rasés, l'air
faussement détachés non loin d'une cabane triste, s'interrogeait
sur ce qu'ils venaient de vivre et sur ce
lieu entouré de barbelés ponctués de miradors.
D'autres cabanes tristes s'étageaient strictement sur la pente
de cette petite montagne, d'où l'on découvrait l'harmonieux
paysage des Vosges. Un lieu nommé NATZWEILER-STRUTHOF.
C'était inscrit en lettres gothiques au-dessus de l'entrée
du Camp.
Retrouver
ses camarades de maquis, de résistance, ses voisins de prison,
ses connaissances, ses « pays », se
regrouper, telles étaient les préoccupations
de ces hommes nus attendant les ordres des SS sous l'œil vide
de quelques types habillés d'étranges pyjamas rayés.
Quelques jours après nous avions ( presque )
tout compris.
Achtung ! Le SS passe devant notre block.
Rapidement nous enlevons notre casquette, figés. Soudain, il
s'arrête puis hurle. Ces vociférations
s'adressent à l'un d'entre nous, le plus grand ; il le fait
venir devant lui. Sans transition notre compagnon reçoit alors
d'énormes gifles qu'il encaisse
avec un flegme étonnant. Nous frémissons de honte et
de colère contenue.
Quand enfin, la brute s'éloigne, le chef
de chambre, un Luxembourgeois s'écrie : « La
prochaine fois, il faut enlever plus vite sa casquette : Mützen
ab ! Compris ? ».
La
dernière nuit. La dernière nuit passée
dans ce camp j'ai eu peur. Ceux qui se serraient contre moi pour regarder
à travers la fenêtre de la cabane ne disaient rien. Mais
je sentais leur inquiétude. Rien de pire que cette impression
d'insécurité collective… Des camions que nous distinguions
à peine descendaient vers le crématoire. Puis, on entendait
des cris, des appels
et quelques coups de feu…
Il a fallu s'éloigner de la fenêtre à cause du
chef de chambre et retourner sur les paillasses. On percevait encore
des grondements de moteurs, des ordres lancés…
Personne ne soufflait mot dans la chambre. On aurait
voulu ne rien comprendre, ne rien savoir...
[ Dans
la nuit du 1er au 2 septembre 1944, 107
membres du réseau Alliance
ont été amenés de Schirmeck
au camp de Natzweiler-Struthof.
Ils y furent exécutés par les
SS dans l'entrée du crématoire, installé
sur la dernière plate-forme du camp ].